Avec le Connétable Louis du
Luxembourg, beau-frère du roi de France, qui avait, à l'ombre des forteresses
de Ham , Péronne, Marle, Coucy, voulu régénérer une province du Vermandois
élargie entre les presse-papiers des deux premières puissances du monde,
disparaissait aussi la dernière tentative d'une armée féodale en France. Un peu
à la mode suisse, le citoyen portait alors par délégation des armes et s'entrainait toute la vie durant. Un
fort sentiment de citoyenneté devait habiter la plus modeste chaumière et le
simple soldat savait d'instinct pour qui et pour quoi il combattait.L'interdiction des troupes
armées autres que les troupes royales changea complètement la donne : la vaillance ne compte plus et la force rustique
de nos paysans ne suffit plus sur ce terrain de sport. Un mercenaire s'avère
plus rentable. D'abord, il offre sa force de travail avec d'authentiques
diplômes techniques. Suisses, Italiens, ils connaissent les dernières armes à
feu. Ils s'enrôlent avec leurs armes d'ailleurs. De plus, en cas de défaite,
pas de rançon à payer !
L'armée royale va donc rapidement comme nombre
d'armées européennes devenir une troupe bigarrée où les cadets de familles
nobles à cheval commanderont à des brisquards étonnement aguerris et
parfaitement insensibles. Une seule chose comptera pour ces derniers : la solde
et la pinte.
Les guerres de la fin de
l'ancien régime étaient par rapport à celles de la période antérieure affaires
de pro et non plus d' amateurs : beaucoup plus de spectateurs avides de belles
reproductions sur toiles mais beaucoup moins de chaleurs dans les tribunes et
souvent des parties truquées ou sans véritable enjeu.
Nos livres d'histoire n'éclairent guère sur la part de "
désinformation", de flatteries à
l'opinion publique et sur le sentiment réel des combattants des conflits de
cette époque. Louis XIV reconnaîtra dans ses mémoires son "faible" pour
ces campagnes qui n'avaient pas d'autre objet que sa propre gloire. De ces
quelques siècles de batailles de professionnels, la France retirera un
encadrement militaire particulièrement capable qui, sous le commandement de Napoléon et avec l'adhésion du peuple retrouvée, soumettra l'Europe sans
rencontrer de véritable obstacle........ à la hussarde, dira-t-on.
L'expression de "
guerre en dentelles " vient aussi de cette époque où la vie de mercenaires
ne comptait pas, alors que, par contre,
le geste élégant du mouchoir de taffetas jeté négligemment par un
capitaine chamarré, pour donner l'ordre
de la curée, donnait toute la valeur au combat .
L'esthétique sublimait la
technique militaire et occultait le sang grâce aux ors des costumes . La
carrière militaire confinait aux métiers d'art . Ce raccourci condense dans le temps un phénomène qui dura près d'un
siècle mais veut surtout éclairer la mutation profonde que va traverser
l'opinion du peuple sur les gens en armes.Après les manoeuvres habiles
de Louis XI, qui n'aimait pas plus la guerre que les connétables, les guerres
d'Italie emboitèrent le pas à la"Paix Perpétuelle" signée avec les
villes Suisses par François Ier pour
les aider à résister à ces Habsbourg, qui venaient de saisir la couronne impériale..
Ce traité Franco-Suisse
permettait un recrutement massif de
jeunes mercenaires, capitaines de
guerre, condottieres qui vont venir
renforcer nos troupes en leur apportant une technicité et un panache inégalés en
même temps qu'une fragilité totale : un mercenaire ne va-il pas toujours au
plus offrant ?
Bien que présumé
incorruptible, un Suisse a toujours le coeur en chocolat et fond à la première
proposition chaleureuse ! .Les rois de France avaient
préféré une armée de parade et de chair à canon à coût modique plutôt qu'une armée nationale et avaient pris un risque sérieux ; affronter
tous ceux, dont les coffres étaient mieux remplis en ducats, pièces et terres à
céder, pouvaient avoir des effets
pervers immédiats. Ces particularités des conflits de ce temps se devaient
d'être rappelées ici car l'opinion publique va en moins d'un siècle subir en
matière militaire un retournement complet. La guerre ne sera plus l'affaire de
tous, l'argent devient le commanditaire de la mort, l'espionnage et le débauchage
deviennent des armes permanentes dans des guerres qui ne s'arrêtent plus.
Toutefois derrière le
vacarme des combats, les cris et les terreurs, la férocité des combats
sera moins authentique et le petit
peuple participera plutôt comme
supporters dans les tribunes que comme pilier dans la mêlée.
Alors qu' en 1486 , Louis le
Connétable de Ham fut étêtée pour avoir tenté de donner une milice au
Vermandois. En 1523, un de ses successeurs, Connétable également et parent
éloigné du mari chéri de Marie du Luxembourg passera simplement à l'ennemi et
viendra servir Charles Quint. Ce Charles III de Bourbon Monpensier combattit
ainsi les Français sans état d'âme, n'était-il pas comme le gros des troupes un
cadre polyvalent, apatride et à grosse valeur ajoutée ?
A cette partie de bras de
fer avec les mains fermées sur de grosses pièces d'or, les vaillants rois français avaient le bras un peu court.
Louis XII avait compris qu'il fallait assurer ses arrières et était venu à
Cambrai, terre d'empire pour y signer en 1508, un pacte avec l'empereur
d'Allemagne Maximilien et obtenir un peu de tranquillité. François Ier n'eut
plus droit à ce parrainage, aussi, la victoire de Marignan, dont il est inutile
de préciser la date, n' empêcha pas en 1525 la défaite de Pavie. Marignan avait
permis un séjour de quelques années dans les belles villes italiennes. Pavie
remettait tout en question puisque François Ier tomba aux mains du connétable
félon Bourbon . Fait prisonnier, sa libération fut payée, comme c'était l'usage
au prix fort. Les Flandres et l'Artois ainsi que la Bourgogne passaient à
Charles Quint. C'était le traité de Madrid qui donnait en prime le Milanais au
vaillant Bourbon et obligeait les deux fils de François Ier à séjourner en
otage à la cour d'Espagne.
L'humiliation de François
fut telle que Calvin lui dédia son ouvrage principal dans l'espoir de le
convertir : l'appui militaire inconditionnel des réformés était tout à fait
susceptible de faire basculer le fléau de la balance et la proposition dut fortement
embarrassée. Aussi pour démêler l'inextricable écheveau, il fut fait appel aux
spécialistes des chaussettes à repriser. Marguerite de Bourgogne, grand mère de
Charles Quint était encore vivante et
Louise de Savoie, mère de François Ier, aussi. Pour rapatrier les deux petits
otages, les reines-mères se retrouvèrent à Cambrai où les bonbons sont bons,
les laines superbes et les pays proches pleins de souvenirs divers.
Le second traité de Cambrai,
appelé aussi " la paix des dames " reprisa le traité de Madrid et la
France récupéra la Bourgogne, Boulogne-sur-Mer et les villes de la Somme,
perdue depuis Pecquigny: Ham et Péronne redevenaient françaises.
Charles Quint qui portait un
peu de sang de la famille du Luxembourg dans les veines faisaient un cadeau à
son royal cousin en lui restituant le Vermandois mais il fallait bien obéir à
grand mère !
Ce monarque si puissant
était un fils de la Bourgogne où depuis toujours la mère possédait l'autorité
suprême et présentait les caractéristiques de l'Européen idéal : né à Gand, il
parlait aux hommes en Français, aux chevaux en Allemand et à Dieu en Espagnol. Sa polyglotie reflétait
naturellement l'esprit et la spécificité des peuples et sa cours ne trouvait
pas motif d'orgueil et de fierté d'être nécessairement trilingue. N'était-ce
pas l'article de base de la construction européenne ? Ni l' Esperanto, ni
l'Anglais qu'il pratiquait aussi, ne figuraient aux rang des idiomes de premier
rang .
Depuis 1525, notre roi
mangeait des couleuvres et de la soupe à la grimace dans un pays coincé entre
l'Angleterre d'Henri VIII qui osera claquer la porte au nez du Pape pour des
histoires de femmes et Charles Quint qui contrôlait le soleil vingt quatre heures sur vingt quatre, ayant
des domaines dans chaque fuseau horaire. Comment sortir la tête de
l'eau ?
Faute des moyens qui
permettent d'acheter des armées, François Ier va entamer une politique
audacieuse : les rois de France avaient été les suzerains protecteurs des
croisades et lorsque le comté des chevaliers croisés s'effondrera, les amitiés
nouées avec les fils du prophète placeront les catholiques d'Orient sous la
protection des rois de France. Le pape Jean Paul II lors d'une homélie au
Bourget avait troublé les fidèles par sa question : France, qu'as-tu fait de ta
promesse ?
Il y avait, entre autre,
aussi le rappel de nos engagements envers le Liban, le peuple Arménien et les chrétiens des pays musulmans.
François Ier assumait,
malgré les difficultés, cette obligation qui lui vaudra l'amitié du grand Pacha Turc. Ce dernier revendiquait
aussi une place au jeu de marelle de l'Europe. Ses troupes s'étaient infiltrées
jusqu'en Hongrie et, partout en Méditerranée, sillonaient au gré des vents des
corsaires habiles improprement qualifiés de pirates barbaresques pour nos éditorialistes.
Puisque le Bourbon venait de
recevoir le Milanais qui s'étendait alors jusqu'en Provence, François Ier
recommanda aux pirates turques des débarquements sur notre côte d'Azur. Le stratagème
fut-il organisé par le monarque français ou résulta-t-il du vieux droit
d'aubaine sur tout ce qui traîne près des felouques?
L'annonce, en tout cas, de pillages par les Turcs, frères de
lait de chèvre des maures, se répandit dans toutes les chancelleries et la
rumeur incrimina le roi de France. Comme il n'est prêté qu'aux riches, les
troupes de mercenaires qui attendaient la couleuvrine au pieds et l'épée au
fourreau, jugèrent l'insinuation suffisante pour aller ferrailler. Les plus scandalisés et ,
qui sait, peut être même les fomenteurs de toute la cabale furent les premiers calvinistes qui savaient
déjà qu'il fallait se battre pour la vraie foi. Cet arrière plan de rumeurs
et d' insinuations, ainsi que de nombreux motifs inavouables offrit l'opportunité
aux troupes du Comte de Nassau ( ascendant direct de Guillaume d'Orange qui
fondera les Pays Bas comme puissance autonome) de fondre sur la belle ville de
Péronne. C'était le 10 Août 1536. Les douceurs de la saison et la proximité de
l'objectif donnaient à la campagne qui regroupait des Flamands, Allemands et
des troupes du Hainaut, un air de promenade de santé.
Mais Péronne n'avait pas
été choisie comme l'une des places
fortes principales de notre pays sans bonne raison. Non seulement, les bras de
la Somme l'isolait au milieu de l'eau, mais la ville venait juste de recevoir
de nouveaux remparts avec des échauguettes, des tours et des fortins. La
bataille se commua en siège ponctué de nombreux tirs d'artillerie : un feu
d'artifice somptueux avec quelques assauts en super cinémascope.
Les bourgeois et les paysans
réfugiés à l'intérieur des fortifications prirent résolument le parti de se
défendre contre des allégations invérifiables et partant suspects et , femmes
et enfants, tous résistèrent .
Malgré un tir approximatif mais soutenu d'artillerie, qui
endommagea la Grosse Tour construite par Philippe Auguste, la ville résista 32
jours. Le 12 Septembre, les assaillants scrutèrent le ciel et jugèrent bon de
rentrer.L'acte patriotique des Péronnais
stopa net les vélléités des "
ferrailleurs " du Nord.
François Ier remercia la
ville et ses habitants en accordant une charte de libertés et autorisa l'ajout
au blason de la cité d'une couronne fleurdelisée.
La ville prit également à
cette date sa devise:
" Urbs Nescia Vinci"
Ville jamais vaincue.
L'Hôtel de ville s'orna
d'une salamandre, qui était l'emblème de François Ier.Toutes ces illustrations
montraient la couleur à tous ceux qui seraient tentés de récidiver
.
Cette défaite fera réfléchir
les chefs malheureux. Le comte de Nassau se retirera sur ses terres où une
histoire particulière était en germe.
Charles Quint, lui aussi, trouva la potion amère et décida de quitter le monde.
Pourquoi donc continuer à se préoccuper de toutes ces provinces nordiques où la
foi se désagrège et où des petites villes résistent au plus puissant des
monarques de la terre ?
Charles Quint confia le
Saint Empire à son frère et l'Espagne, l'Amérique et toutes ses provinces bourguignonnes et flamandes à son fils
Philippe II et se retira , au fond d'un monastère, pour entamer,en espagnol, un dialogue muet avec l'Eternel.
Le jeune hidalgo Philippe partait dans la vie avec un bel
héritage, la bénédiction papale, un parrain empereur d'Allemagne et une femme
rousse : Marie Tudor, la soeur du roi d'Angleterre. Sur la carte d' Europe, le
domaine de François Ier faisait désordre au milieu des domaines de la famille,
sans compter que ce pays vaniteux entretenait en son sein un mouvement
hérétique qui fragilisait le pouvoir du tonton Ferdinand, Kaiser du Reich. Une belle opération devait absolument
effacer l' affront de Péronne et sanctionner
l'alliance de François avec Soleiman. Les Français, ressentant toute la
pression du monde coalisé contre eux, retirèrent les troupes en campagne dans
le Piémont avec l'aide de nos amis suisses pour renforcer la ligne de front de
la Basse Champagne. Craignant pour Paris, François Ier signa un traité à Crépy
en Laonnois par lequel il abandonnait
ses prétentions sur l'Italie en obtenant toutefois que le Milanais soit confié
à Charles d'Orléans, fiancé à une infante d'Espagne. Ce dernier mourut
précipitamment et le traité devint caduc. Il fallait en finir avec ce roitelet
français !
L'opération semblait toute
indiquée puisque François Ier venait de trépasser laissant la place à Henri II.
Ce fils cadet n'était pas destiné à régner mais la providence en disposait
différemment et brouillait les cartes car il était marié à une Médicis.
L'Italie du Nord risquait, à nouveau,
de tomber du mauvais côté, d'autant que Charles Quint venait de donner la
gérance du monde à son fils Philippe II. Le nouveau monarque se
devait d'introduire son règne par un coup d'éclat. Ainsi, Philippe II et son
armée, sous le commandement du duc de Savoie, partie très prenante dans la
bouillabaisse milanaise, et renforcée d'éléments d'outre manche, mit le siège à
Saint-Quentin en 1557.
Face à cette armada,
Coligny, amiral et grand protestant , n'avait que quelques troupes aguerris et
les manants et bourgeois de la ville. Lui même séjournait à Ham plus souvent
qu'au chef-lieu.Pour préparer le terrain du
combat qui devait apporter gloire au nouveau roi d'Espagne, un ingénieur
anglais serait venu près d'un an auparavant reconnaître les fortifications de
la ville. Ce chapitre d'espionnage si courant et bénin dans l'art des batailles
occupe une importance extrême dans l'histoire du Vermandois comme du monde.
L'artillerie de Péronne,
vingt années auparavant, avait juste endommagé la tour de Philippe Auguste
mais, trop imprécise, n'avait pas fait tomber les remparts et ouvert la ville.
L'espion anglais avait été vu autour des fortifications, mais nos concitoyens
crurent que ses balades sur les plateaux alentour, ne relevait que de
l'entraînement quotidien au jogging. L'anglais, de fait,avait tout repéré car il était, sans doute,
un des tous premiers à avoir approfondi les travaux de
Nicolas Tartaglia (
1499.1557), mathématicien né à Brescia qui venait de divulguer les formules de
la balistique.....
Nos citoyens ne pouvaient
savoir ce qui les attendait. Courageusement ils se résolurent à s'opposer à
l'envahisseur, en bouclant la ville. L'ennemi s'installa tout autour et le
prince du Piémont qui subventionnait les recherches du mathématicien planta sa
tente à Rocourt.Gaspard de Coligny
remontant de Ham put s'introduire dans la ville avec 200 à 300 hommes. Le gros
des troupes fleurdelisées étaient encore loin avec 20000 hommes sous le
commandement du maréchal de Montmorency.
La présence de l'amiral
conforta les habitants et facilita l'organisation, avec les instances de la
ville et une forte adhésion populaire, les défenses et les subsistances. Pour
tenir, il fallait aussi faire de la diversion.
Une sera tentée au faubourg d'Isle et une autre le lendemain, sans succès. Deux compagnies vont être rapidement levées parmi les habitants
du pays sachant porter les armes par Caulaincourt et le baron d'Amerval.
Le renfort tarde et aussitôt
la position et les problèmes de la colonne sont vendus aux
Flamo-anglo-espagnolo-bourguignons. Le gros de cette troupe sera bloqué par des arquebusiers postés sur le
chemin de Savy. Le même jour, 12000
anglais viennent renforcer le dispositif, ce qui permet de concentrer la
batterie d'artillerie sur le faubourg d'Isle et le bas de la ville..
Le péril devient imminent et
il faut à nouveau une manoeuvre de diversion. Coligny supplie le Connétable de
Montmorency de traverser la Somme au travers des marais de Rouvroy. L'infiltration
furtive n'est pas encore enseignée dans les Etats-Majors et de Montmorency
amènera ses cavaliers directement vers le Faubourg d'Isle, bien placée sous le
feu précis de l'artillerie ennemie . Pendant ce cheminement, la cavalerie
espagnoles profitera de la chaussée de Rouvroy pour traverser la Somme. On dit
que le prince de Condé aurait fait savoir au Connétable que l'ennemi abordait
son flanc gauche.
"- Avant que vous ne
fûtes au monde, je commandais déjà les armées. Vous êtes trop jeune pour me
dire ce que j'ai à faire ! " répondit de Montmorency.
L'armée française avait
aussi disposé quelques pièces d'artillerie en direction du Faubourg d'Isle pour
faire une brèche dans le dispositif d'encerclement.
Et, les français attaquent !
Les soldats ennemies postées sont en apparence très vulnérables car pris en
étau. Seulement, l'artillerie du duc de Piémont sitôt mis en branle s'avère
d'une étourdissante efficacité sur tous les remparts même sur ceux qui sont de
l'autre côté de son champ de tir tendu, alors que les boulets français se
dirigent droit sur les mêmes remparts . Les fantassins ennemis attendront
enfouis la charge de cavalerie qui n'aura pas lieu car la cavalerie espagnole
attaquera sur le flanc. Non pas pour étriller les cavaliers français mais pour
les fixer un temps, le temps pour l'artillerie de changer ses azimuts et de
pilonner la cavalerie.
Le duc de Nevers arriva,
avec ses fidèles, à contenir l'ennemi pour le contourner à Grugies, permettant
au gros de nos troupes de battre en retraite sur Essigny.La cavalerie était vaincue.
C'était le 10 Août 1557.
Mais les assiégés
demeuraient derrière des murailles encore présentes .Très vaillamment, ils
reprendront la tâche de consolider, remonter, réoccuper. Mais Philippe II,
alerté par la belle victoire sur la cavalerie, arrive dès le lendemain de
Cambrai. Cette venue avait valeur de commandement de se saisir de la ville !
Les boulets recommenceront
de tomber avec ce qu'il faut de
précision pour effrayer les habitants,
ouvrir la murailles, briser autant que la puissance du feu et de la balistique
le permettait. Toute la fine fleur du Vermandois sera exterminée, en compagnie
du duc d'Enghien, du vicomte de Rennes, et de la quasi totalité de la noblesse
picarde. Ceux qui gardèrent la vie, laissérent des gages, comme ce chevalier
d'Amerval qui perdit sa virilité et sera, pour le bon plaisir de Henri IV,
l'époux de sa favorite Gabrielle . La
ville, après la destruction froide des boulets, sera livrée au pillage et des
incendies achèveront l'oeuvre funeste. Cinq cents bourgeois périrent dans la
ville livrée au pillage et à la curée.Quand Philippe II, après ses troupes, rentra dans Saint-Quentin, le
jeune homme fut consterné.
Les abbayes étaient
détruites, les églises avaient été profanées, les reliques des saints brisées
et enlevées. L'indignation monta au front de jeune roi d'Espagne lorsqu'il
aperçut l'église dédiée à Saint Laurent complètement détruite.Ce champ de ruine devait
porter gloire à la victoire de Philippe, le jour de la Saint Laurent !
Les morts de Saint Quentin,
ne venaient-ils pas de revivre la fin volontaire de Laurent, impuissants sur le
grill et sous le feu ?
Le règne du nouveau roi
venait d'être béni par Dieu qui est toujours du côté des vainqueurs, et
pourtant la foi de l'Espagnol fut ébranlée. Ainsi, en marquant sa brillante
entrée dans la vie active par la construction du palais de l'Escurial qui est à
l'Espagne ce que notre château de Versailles est pour nous, Philippe gravera
dans la pierre son tourment : la gloire, certes, ce sont les grands qui la
récolte mais le mérite ne revient-il pas à ceux qui paient leur résistance de
leur vie ?
Notre région n'a aucune
place dans les Panthéons de France mais nous pouvons être fiers d'avoir résisté
à l'Espagnol car il a rendu à la vaillance de nos concitoyens le plus
magnifique éloge qu' il soit possible de faire. Un autre message fut
transcrit dans la pierre que toute l'intelligentsia rangera parmi les croyances
de l'obscurantisme religieux : Laurent, comme les martyrs de Saint-Quentin
démontraient l'inutilité du perfectionnement des armes et des répressions. Même
la balistique ne pouvait tuer l'âme !
Philippe arriva assez vite à
la conclusion que la guerre, avec les moyens de l'armement nouveau, était d'un
prix trop lourd pour le peuple. Comme la politique lui commandait, par ailleurs
de se méfier des anglais et aussi des allemands qui grognaient dans son dos, Il
préféra signer la paix de Cateau Cambrésis en 1559 par lequel la guerre
d'Italie était arrêtée, les évêchés de Metz, Toul, Verdun donnés à la France,
Saint-Quentin restituée et Calais acheté.
Pendant deux années, le
chef-lieu fut donc sous total contrôle espagnol. L'aide pour rebâtir fut réelle
mais insuffisante pour faire revenir une population qui venait de découvrir l'horreur
de la guerre moderne.
Parmi les sacrifiés de cette
bataille, il faut aussi parler des quarante garçons nobles, pris en otage et
élevés à la cour espagnole, selon de vieilles traditions de guerre. La
chronique espagnole raconte que ceux-ci se rendirent célèbres par leur bravoure
aux "Indes ", il s'agit bien sûr de l'Amérique latine où de
nombreuses familles entretiennent le souvenir de leur ascendance européenne?
La belle défense de la cité
fut honorée par deux ouvrages sculptés:
par des vers latins
gravés sur la façade de l'Hôtel de ville ;
" Bellatrix, I, Roma ! tuos nunc objice
muros !
Plus defensa manu, plus nostro hoec tincta
cruore
Moenia laudis habent : Furit hostis et
imminet urbi ;
Civis murus erat, satis est sihi civica
virtus.
Urbs, memor audacis facti, dat marmore in
ista
Pro patria coesos aeternum vivere cives.
"
"
Cesse de nous vanter tes murs et tes batailles,
viens admirer ces vaillantes murailles,
ces hardis citoyens qui, dans le
Champ-de-Mars,
Servent à leurs cités d'invincibles remparts
Où la seule valeur, sans murs pour se
défendre,
sait braver mille morts plutôt que de se
rendre.
Leur ville, pour marquer qu'un grand coeur
vit toujours,
Lorsque pour la Patrie, il immole ses jours,
Sur ce marbre parlant, une gloire immortelle
! "
* par un beau monument qui ornait la place
centrale de Saint Quentin.
Ce n'était pas un monument
pour les âmes simples, ni pour les adeptes des lendemains qui chantent, ni pour
les partisans du pacifisme. Une municipalité de gauche où de droite l'a déplacé
dans les années du socialisme. Remplacé par un grand vide, il n'invite plus les
promeneurs ou les désoeuvrés à une puissante réflexion. Pourtant, à sa manière,
cette statue a autant d'importance que l'Escurial qui est le monument le plus
visité d'Espagne.




Le traité de
Cateau-Cambrésis
Jeanne d'Albret et Henri IV.
La victoire de
Saint-Quentin, du fait des fumées des canons,laissa un goût âcre et amer au fond de la gorge du jeune Philippe II. En
remerciement, il combla d'honneur Philibert-Emmanuel de Savoie, lequel fit de
même avec ses troupes, en oubliant toutefois de citer Tartaglia : l'auteur de
"Quesiti et Inventioni Diverse" et père du tir efficace . Puis le roi
d'Espagne jugea bon de stabiliser la ligne d'affrontement, tout en laissant aux
Anglais le soin d'arrondir les terres d'Artois occupées, et se retira dans son
palais de l'Escurial.Du côté français, Henri II
avait atteint 28 ans, lorsque survint la mort de son père, et avait toujours été bercé de récits de victoires
sur la terre italienne. La campagne fut si parfaite qu'Henri se retrouva affublé
d'une compagne directement tirée de ce roman-photos : Catherine de Médicis.
Dans le lit du roi de France veillaient donc l'agent recouvreur des banquiers
florentins et la nièce des papes. Singulière garde, qui mettait à l'abri à la cour tous les ultramontains
et à l'écart des mondanités les gens du Nord de la Loire.
Le roi trouva, pour seule
échappatoire, les bras de Diane de Poitiers, ce qui accrut encore le caractère
acariâtre et l'humeur revêche de celle qui trônait au Palais du Louvre.
Une famille, pourtant, de
notre voisinage va pénétrer dans le sérail : les Guise.
C'était la branche cadette
des ducs de Lorraine, revendicant sa descendance du grand Charlemagne, qui gardait le titre de Guise comme plus
beau fleuron de son armorial. N'est-ce pas depuis toujours le verrou des
sources de l'Oise et de la Sambre ? Passage obligé, dernier port de l'Oise, sa
fortune s'était érigée sur une forme légalisée du grand banditisme : les droits
d'embarquement, de débarquement, l'octroi et les droits de douanes.
La famille, outre l'esprit propre à la situation du
fief, avait subit l'influence de Naples et de la Sicile du fait de ses liens
avec la famille d'Anjou. Elle va être au coeur des drames de notre pays, tant
par la gravité des faits que par la manière peu chevaleresque de leurs
exécutions. Une odeur de vêpres siciliennes, crimes sauvages et parfums
d'encens, entourera leurs actes et donnera un aspect sinistre à la monarchie
pendant presque quarante années. L'entrée des Guise " en
cour " fut le résultat du comportement courageux de Claude, Ier duc du nom
, en Italie au côté de François Ier contre Charles Quint. Avec son frère
Cardinal, il conforta la position de l'organisation mafieuse à la capitale. François, le cadet, dit le
balafré, à la suite d'une estafilade gagnée aux pieds des remparts de Boulogne
se comporta valeureusement à la bataille de Calais en 1558. La prise de la
ville, pied à terre des Anglais sur le continent , adossée à la mer et faisant
front à de vastes zones marécageuses, ne pouvait être la victoire d'un soldat
vaillant, seul. L'armée comprenait aussi, Coligny, le connétable Anne de Montmorency, Antoine de Bourbon,
tous guerriers chevronnés avec une réelle autorité sur les troupes, bien plus
considérables que le jeune capitaine. Avant que d'accorder à l'un ou l'autre la
paternité de la victoire, il importait pour le camp français de tirer les
marrons du feu. Henri II présenta un projet de traité que les partis s'empressèrent
d'accepter et de signer à Cateau-Cambrésis.
Ce village proche servit
donc de cadre à la rencontre des envoyés Français et Espagnols. Il y fut conclu
le retour de Saint-Quentin, Ham, Le Catelet à la France contre la cession de 98
places dites "considérables" et le versement de 500 000 écus aux
Anglais pour Calais.
Le traité fut longtemps
considéré comme désavantageux pour le pays par nos premiers historiens. Le rapport des nombres, 3
contre 98, laisse croire à un marché de dupes et pourtant, il faut bien
admettre que tels étaient les poids réels de ces trois cités pour le roi de
France. Les places fortes cédées en
Milanais, Piémont, Montferrat, Corse, n'avaient jamais eu et n'auraient jamais l'importance de notre région dans la destinée du monde !
Peu de temps après, pour
célébrer les retours de Calais et du Vermandois au domaine, le roi invite ses
principaux chevaliers à une Jardin-partie, loin de Paris, afin que la présence de Diane et les réjouissances
gaillardes ne défraient pas trop une chronique malveillante et tatillonne.
Ces rencontres festives
d'anciens combattants incluent, par tradition, un simulacre de tournoi des grands chefs . Henri II est donc opposé au
connétable, c'est l'ordre des choses.Et voilà que l'affaire tourne mal, malgré la différence d'âge qui
devait mettre Henri dans sa quarantième année à l'abri des coups du vieillard,
la lance du connétable traverse la visière du heaume royal et transperce.
Catherine de Médicis devient
régente du jour au lendemain et, à la manière des Italiens qui changent de
gouvernement tous les quinze jours, Catherine va bouleverser la cour et
l'administration. Montmorency est renvoyé, Diane exilée, les affaires
militaires sont confiées à François de Guise, et les affaires civiles à son
frère Cardinal.La nomination valait pour
François le bénéfice de la récupération du titre de vainqueur de Calais, au
grand dam d'Antoine de Bourbon, qui pensait avoir, aussi, mérité une
récompense. Roi de Navarre, ayant servi courageusement et victorieusement à
Calais, il escomptait la récupération de la Navarre espagnole. Après le traité
qui l'avait spolié et, voyant le Balafré préféré, Antoine nourrira un sentiment de frustration à
l'encontre de l'Italienne, et même de la Papauté et rejoindra la religion de
son épouse Jeanne d'Albret.
Jeanne et Antoine de Bourbon
portaient les héritages de quatre des plus importantes familles de France :
Jeanne avait mis dans la corbeille
les fiefs d'Ariège, hérités du légendaire Gaston Phoebus, la Navarre avec un
titre de roi et ceux d'Albret en
Aquitaine, Normandie, Avesnes, La Fère, Marle etc, etc ...
Antoine était seigneur du
Bourbonnais, de Vendôme, descendant d'un frère de Saint Louis et donc de sang
royal, Son père, mort à Amiens, avait récupéré, par alliance les biens de la famille
d'Alençon, et avait été gouverneur de Picardie. Son oncle François, devenu
Comte de Saint-Pol, avait recueilli les
possessions de la famille du Luxembourg, si bien que nombreux furent les
Bourbons nés à Ham. Son frère Louis, prince de Condé, époux d'Eléonore de Roye
puis de Melle de Longueville fut le
chef militaire des protestants "Doux le péril pour Christ et
patrie".
Le regroupement de cartes
maîtresses dans les mains du jeune couple ne pouvait que porter ombrage à
l'autre clan qui tyrannisait les couloirs du Louvre et , au delà, toutes les
allées du pouvoir. La reine et les Guise n'avaient décrété qu'une chose :
détruire le couple.
Parler des Guise oblige à
évoquer aussi les autres membres de la tribu : François le Balafré, le cardinal
Charles, l'oncle Jean et Louis le célèbre " diplomate des
bouteilles"et aussi Marie Stuart .Singulière et attachante
Marie qui, en France comme en Angleterre, portait tous les stigmates d'une
victime désignée pour la tragédie grecque et qui mériterait le titre de
citoyenne d'honneur de notre contrée.
La ville de Saint-Quentin,
de la mort de François II en 1560
jusqu'à la décapitation de la Reine
d'Ecosse en 1587, contribua directement à ses revenus ; le roi avait, en effet,
choisi sa bonne ville pour constituer
le douaire ( la pension de veuvage), de
la reine de France retournée sur son île.
Quel était, donc, le lien
que unissait Marie Stuart et notre région ?
Pour accepter d'assurer la
retraite de cette étrangère, il fallait que nos concitoyens se sentent très
proches d'elle ! C'était, il est vrai, un ferment de paix qui bloquait les hostilités entre les deux familles
de Guise et de Bourbon. En effet, Marie était la fille du roi d'Ecosse et de
Marie de Guise (ou de Lorraine pour le titre), elle même fille de Claude de Guise et d'Antoinette de
Bourbon. Cette dernière, fille de
François de Bourbon et de Marie du Luxembourg , notre mère des pauvres, était
née à Ham. Son portrait est toujours visible au Palais de Versailles. Le prénom
de Marie se transmettait avec régularité dans la famille et Marie Stuart en fut
doté.
Un équilibre semblait devoir s'établir entre les deux grandes
familles issues de nos cités rivales de Ham et Guise : les Guise tenait le
Gouvernement et Antoine de Bourbon était le Lieutenant-Général du royaume. Mais
le dauphin François II époux de Marie Stuart meurt en 1560, entraînant la
prolongation de la régence pour attendre la majorité de Charles IX. La perspective de récupérer
la Navarre espagnole s'éloigne encore et Antoine prend ouvertement le parti des
Huguenots dont Jeanne d'Albret, sa femme, est l'une des principales
défenderesses. A l'instar des provinces allemandes où le principe " Cujus
regio, ejus religio ", tel prince, telle religion, fait adhérer rapidement
des populations entières à la nouvelle foi, la France voit le protestantisme
multiplier ses paroisses et le nombre de ses ouailles en quelques décennies.
Le concile de Trente, organisé par un pape père d'une importante
progéniture, n'ayant pas condamné formellement les indulgences plénières
vendues pour la construction de Saint Pierre de Rome, l'Eglise n'a pas encore
récupérée un souffle nouveau et n'est pas arrivée à retenir en son cénacle :
l'Angleterre, la Suisse, les Pays Bas et tout le Nord de l'Allemagne. La
dernière circonstance aggravante vient de la nouvelle technologie de
l'imprimerie ; comme la presse tourne exclusivement pour la nouvelle Eglise,
toutes les élites des provinces rejoignent le mouvement. Les abbés des provinces,
nobles pour la plupart, voient se tarir rapidement leurs revenus et concluent une alliance objective avec les
troupes royales sous le commandement des Guise. Des exactions nombreuses ont
lieu qui exaspèrent et choquent les consciences.
La conjuration d'Amboise en
1560, fut une des premières fractures profondes qui va déchirer le pays, pour
longtemps. La vérité demeure incertaine dans cette affaire sanglante dont seule
la couleur du sang a laissé des traces dans l'histoire. François II, Marie et
la régente séjournaient à Blois. A Nantes, Georges Bari de la Renaudie, et une
centaine de chevaliers huguenots conviennent de partir pour, devant les
monarques, présenter une requête en destitution des Guise et demander la nomination à sa place du Prince de Condé, neveu d'
Antoine de Bourbon. Entre temps, la cour part en Week-end à Amboise et la
troupe, car il fallait aviser le Prince de Condé, prudemment éloigné du terrain
d'opération mais prêt pour une cavalcade glorieuse, perd une journée et se fait
repérer. Avant même d'atteindre le château, les conjurés sont passés à l'épée,
puis seront pendus aux fenêtres du château, par pure bestialité.
L' histoire rapporte que de
la Renaudie s'exprima ainsi après la lecture de la sentence qui l'obligeait à
poser sa tête sur le billot pour crime de lèse-majesté:& quot; Je suis innocent de ce crime, car je n'ai rien entrepris
contre le roi, ni contre sa mère, ni contre son épouse et ses parents qui sont
compris sous le crime de lèze-majesté. J'ai pris les armes contre les princes
de Guise, qui sont étrangers, et qui usurpent l'administration publique contre
les lois du royaume. Si c'est là un crime de lèze-majesté, il fallait
premièrement les déclarer rois. C'est à ceux qui viendront après moi de prendre
garde qu'ils n'affectent de le devenir ; car pour moi la mort me va délivrer de
cette crainte."
Le sacrifice des pendus
d'Amboise sera suivi de plus de 1200 exécutions dans les provinces de l'Ouest,
Sud-Ouest ; essentiellement des nobles plus ou moins liés aux conjurés.
Dès Janvier 1561, une
tentative de conciliation est organisée à Poissy entre protestants et catholiques. Le colloque sera un échec,
malgré le superbe tableau qui sera peint à l'occasion de cette réunion, nous
laissant un portrait exact des acteurs de la tragédie, toute la cour de l'époque
autour de la grande Catherine. La fissure, née entre les
grandes familles, va se prolonger au sein même du peuple en 1562, lorsque
François de Guise va donner l'ordre à ses archers d'exterminer 60 Huguenots
réunis dans une chaumière à Wassy, près
de Bar, pour la prière. La guerre civile est, dès lors, enclenchée.
Elle fut qualifiée de guerre
de religion ! Par nature, un conflit au coeur de la même croyance exclut les
dissidents du pardon qui ne peut être
accordé qu'à ceux qui restent, se soumettent et implorent. Si les guerres
civiles sont douloureuses et
malheureuses , les guerres de religion font plus ; elles sont tragiques et
impitoyables.
C'est une lutte sans merci,
ni pitié qui va bientôt endolorir la Chrétienté, introduisant une combinaison
qui mènera à la guerre totale : ni salut, ni pitié pour les ennemis de
notre idéologie. Nieztche en formulera
l'équation bien avant l'expérimentation du vingtième siècle.
En France d'abord, puis en
Allemagne avec la guerre de trente ans, l'horreur fit donc son apparition au
sein d'un continent qui avait mille raisons, en ce seizième siècle, de profiter
de la vie. Notre civilisation approchera la catastrophe pour des motifs de fond
bien futiles: Catherine n'avait pas pardonné à Diane de Poitiers, Ham et Guise
n'étaient pas arrivés à s'entendre !
Le poids de ces haines
ordinaires pèsera, en final, bien plus que le problème des indulgences et de la
virginité mais, pour la mobilisation des petits d'un côté comme de l'autre, il
fallait un bel habillage servant d'alibi . Mettre Dieu de son côté, n'était-elle
pas cette astuce utilisée depuis la nuit des temps pour convaincre le couard de
devenir un héros ?
Les mouvements de troupes,
qui engagèrent les Catholiques contre les Protestants et réciproquement,
sillonèrent toute le France et donc
aussi notre sol. Les relater occuperait de longues pages : huit guerres
successives, trente-six années de troubles continus à décrire et d'énormes recherches à faire car les rares documents
ont été détruits ou emportés au loin. De plus, l'exode des protestants plongera
nombre de faits dans l'oubli.
Il est encore difficile
d'apprécier avec exactitude les forces en présence. En Picardie, Coligny, le
prince de Condé, la comtesse de Roye, la famille d'Hangest de Noyon, de
nombreux échevins à Montdidier, Amiens, et la grande majorité de la noblesse de robe sont connus pour
avoir "épousé la réforme".
La vallée de l'Oise et ses
nombreuses petites industries naissantes, la Fère, les villages de Beaurevoir,
le Catelet, Annois, seront visités par des pasteurs formés à Genève. Protégés
par des sauf-conduits venant des principaux personnages de la région, et
n'ayant pour le culte besoin que d'une humble maisonnette, même au fond des
bois, leur apostolat rassembla vite les plus entreprenants et les plus
courageux.Pour endiguer la marée,
l'Edit de Tolérance, promulgué à Amboise en 1562, plaça quelques vannes et
érigea des digues : le roi tolérait....
mais seulement dans les familles nobles, sur les domaines des seigneurs ayant
droit de haute-justice et dans une
ville par bailliage.
Déjà, le Vermandois
dépassait la norme !
Cette caractéristique se
doublera d'une décision d'une mère inquiète Jeanne d'Albret qui aime son mari picard pourrait le rejoindre avec le
petit Henri mais prend peur après
l'abomination de Wassy et reste au château de Pau. Catherine de Médicis utilise
d'ailleurs pour retenir Antoine au Nord de Paris un commando d' odalisques
célèbres et Jeanne n'est pas de nature à s'abaisser devant un mari inconstant .
Placés aux premières loges
du spectacle d'une haine ordinaire maquillée en combat sur l'Olympe, les
habitants de Saint-Quentin prirent la mesure de la situation et firent preuve
d'une sagesse exemplaire : dès 1562, les échevins expulsèrent les nombreux
prédicants dépêchés par Genève.
Certes, ceux ci ne s'éloignèrent
guère mais durent se rabattre sur des communautés moins importantes.
L'équilibre trouvée spontanément sera le salut des huguenots. En 1567, les
chevauchés du Prince de Condé jusqu'à Paris se traduiront par des représailles
matérielles multiples : d'innombrables temples brûlés et encore quelques
prédicants remerciés mais sans versement de sang. Cinq années après, alors que
la Saint Barthélémy déboucha sur un génocide ignoble dans de nombreuses villes
de France, le Vermandois se distingua par son humanité et sa tolérance. Les
protestants y seront épargnés.
La mesure de nos concitoyens
dans le massacre organisé par les Guise venait aussi d'une claire vision de la
situation : Coligny et son armée de soldats huguenots était sollicité par les
flamands pour combattre ensemble les espagnols. Avec Charles IX, marié à
Elisabeth d'Autriche, un royaume calviniste pouvait être aisément édifié dans
cette province riche et contribué ainsi à redorer le blason de son promoteur . Pour le Vermandois, entre le
statu-quo espagnol ou un royaume nouveau aux frontières nord, le choix logique
tint autant compte des risques intérieurs qu'extérieurs. Eliminer des
concitoyens paisibles n'offrait décidément aucune autre perspective que des représailles interminables du Sud ou
du Nord, voire des deux à la fois !
Un autre personnage, dans ce
monde complexe, joua un rôle essentiel.
On ne sera pas étonné d'apprendre que lui aussi naquit à Ham puisqu' il était
le propre frère d'Antoine de Bourbon et donc oncle d'Henri IV. Il s'appelait
Charles avec fonction de Cardinal, archevêque de Rouen. Beaucoup
d'analystes ont prétendu que c'était un
falot influençable, utilisé par les Guise contre les intérêts de sa propre
famille.
Pourtant, si la dynastie des
Bourbons règne toujours, le Cardinal dut aussi apporter,par des voies tortueuses et mystérieuses,
une pierre à l'édifice final. Catholique, par subsistance
et aussi par conviction, Charles n'
adopta le parti des ultras et rejoignit la Ligue que longtemps après les
massacres et pour un motif plus simple:
descendant de Saint Louis, de sang royal, parmi les premiers dans l'ordre de
dévolution, l'idée d'un roi qui ne
serait pas catholique romain lui était insupportable.
En 1576, une nouvelle trêve,
dite de Loches, venait d'autoriser le culte dans les villes closes et d'accorder
des places supplémentaires aux réformés ; le prince de Condé récupérait ainsi
sa place de gouverneur de Picardie qui revenait à sa famille et les places de
sûreté qui en dépendaient. Le lobby protestant avait oeuvré pour faire de
Péronne un place huguenote. Des rumeurs circulèrent même que Paris avait donné
son accord.
Péronne a, alors, un gouverneur de place du nom de Jacques
d'Humières, émule de Charles de Bourbon et descendant des seigneurs de Monchy et Becquencourt, qui refuse de
rendre la citadelle et appelle les nobles à une " sainte et catholique
union ... pour établir la Loi de Dieu en son entier, remettre et retenir le
saint service d'iceluy sous la forme et manière de son Eglise catholique, apostolique
et romaine. "
La ligue naît ainsi, à
Péronne, sous l'inspiration que les places fortes ne peuvent appartenir
qu'au roi et non aux factions et sous
l' influence aussi de l'esprit de la
contre réforme ; l'effectif est maigre au départ et il faudra attendre la mort
en 1584 du duc d'Alençon, seul prétendant à la couronne mâle et catholique,
pour qu' il grossisse et que la ligue dépasse les contours d'une "cosa
nostra" mafieuse.Les batailles d'avant cette
date seront le plus souvent à l'avantage des huguenots.
Dans notre région, alors que
catholiques et protestants discutaient à Nérac l'octroi de nouvelles places de
sécurité, les Guise assiègèrent les troupes du Prince de Condé qui stationnait
à La Fère. Ce dernier étant victorieux, il fallut recommencer l'année suivante.
Ce siège est resté célèbre sous l'appellation de "siège de Velours"
car Henri III profita de la proximité de Paris pour inviter ses "
mignons" à venir voir la boucherie tout en parlant chiffons. La cour
d'alors avait des airs de communauté "gay" qui accroissaient encore
le mépris des austères confédérés.
Les escarmouches partout continuent d'enflammer la pays du nord au
midi et la haine conduit rapidement aux règlements de compte directs : le
paroxysme fut atteint en 1588 à Blois avec l'assassinat des deux chefs haïs :
le duc de Guise et le Cardinal de Lorraine .
Les délégués des villes
picardes aux Etats généraux furent suspectés et emprisonnés. Preuve que la Ligue n'était plus l'appareil
des Guise, les picards rallieront en plus grand nombre le mouvement et seront à
l'origine de la création des Etats de Picardie, ébauche d' une autonomie
régionale. On dit que Saint-Quentin ne se rallia pas au mouvement, manifestant
ainsi sa fidélité indéfectible au roi.Cette incartade valut à la
ville une visite d'intimidation. Le
gouverneur de Cambrai, proche des Espagnols et de la ligue s'empara de Bohain
et Beaurevoir et fit barrer par ses soldats les chemins d'accès de
Saint-Quentin vers les villages
voisins. A ce combat en chemins creux, Montluc de Cambrai perdit tant d'hommes
qu'il préféra se retirer après trois semaines d'efforts inutiles.
La fidélité de la bonne ville au Roi Henri III, malgré
la tentation autonomiste des partisans du chef des armées Henri de Guise, fut
certainement un élément déterminant dans la décision du roi de provoquer
l'assassinat de deux parrains de la mafia. Sans ces deux personnages, la ligue n'était pas décapitée, bien
que sérieusement amoindrie : le Cardinal de Bourbon maintenait le mouvement, à sa disposition, pour l'heure fatidique, laquelle approchait
inexorablement.
Le cinéma cru et direct de
notre temps a rendu concret , dans le film adapté du roman d'Alexandre Dumas :
la Reine Margot, l'image du roi malade suant des gouttes de sang. La thérapie
des saignées et la méfiance de la cour à l'endroit des médecins protestants et
juifs accéléreront un processus fatal.
La monarchie, avec l'agonie
d'Henri III, devait arriver, vite, à
son rendez-vous avec le destin. Bien que programmée par tous, l'issue fut anticipée
par le coup de poignard du moine
Clément qui acheva le dernier des Valois.Les Français apprirent la
nouvelle avec consternation. Nul n'ignorait que, sans héritier direct, la
dévolution risquait de prendre le chemin des dames ou alors la voie du protestantisme.
La Ligue s'empressa donc de nommer roi, lors d'une réunion précipitée au
Château de Péronne, le Cardinal de Bourbon, sous le titre royal de Charles X.
On ajouta après par dérision: le roi de Péronne.
Dans cette course, le roi
d'Espagne se rappela que sa fille Isabelle était petite-fille d'Henri II et
donc en première place sur la liste.Pour Henri IV, roi de
Navarre, il fallait jouer serré. Il déclara que Paris , que ses troupes
assiégeaient, valait "bien une messe", se convertit au catholicisme
en présence de son oncle et fit mettre
immédiatement ce dernier aux fers.
Ce fantastique retournement
de situation ne dut rien à la génération spontanée. Le rôle de Charles de
Bourbon fut certainement déterminant dans la décision de Henri, de même que la
fidélité des habitants du Vermandois. En effet, les milices du
Vermandois, après avoir résisté au seigneur de Cambrai, Montluc vinrent
naturellement aider le duc de Longueville, gouverneur de Picardie, en prise
avec les ligueurs . Instruits par la bataille de Saint-Quentin, nos canonniers
firent merveille et l'une des pièces recut le nom de Chasse-Ligue. .Avec de pareils soutiens,
Henri IV pouvait entamer sa montée à Paris.
Rapidement le mayeur Louis
Doligny de Saint-Quentin confirmera sa loyauté en levant une nouvelle milice
pour le Duc de Longueville, fidèle du nouveau Roi Bourbon. Le commandement fut
confié à d'Achery, ayant sous ses ordres de Saint Simon et de Chaulnes,
seigneur du Vermandois. Nos concitoyens ne tarderont
pas à servir et se comporteront très
glorieusement à la Bataille d'Ivry. " Si vous perdez vos enseignes,
ralliez vous à mon panache blanc". Tous les Français connaissent la
harangue, peu voit derrière la formule autre chose qu'un effet de chapeau. Il fallait à ces troupes venues de
loin au Sud et de loin au Nord, parlant des langues différentes, incapables de
reconnaître les flammes, drapeaux, blasons, un signe fort d'unité de
commandement et de volonté. Henri IV trouva sans doute
bien anodins les mots utilisés pour la circonstance. Ceux-ci ont,
pourtant, ravi des générations et des
générations et constituent toujours le cri de ralliement le plus fort de notre
nation.
A nouvel affront et
victoire, nouvelles représailles !
Le duc de Parme, avec ses
troupes cantonnées vers Cambrai, pense pouvoir rééditer la victoire de la Saint
Laurent et effacer le demi échec de Montluc, et pénètre alors jusqu'à Neuville-Saint-Amant . Un minimum de bons sens faisait défaut à ce prince.
Depuis la mort des Guise, le
rôle modérateur du Cardinal et la déclaration d'Henri que " Paris vaut
bien une messe", la guerre de Religion venait d'être reléguée au statut de
guerre civile ordinaire : La France n'a
donc plus de leçon à recevoir de personne et l'Espagnol/Italien devient "
persona non grata ". Comme les milices sont loin, c'est d'Humières, père
fondateur de la Ligue, qui déplacera ses troupes de Péronne pour arrêter
l'intru qui fut longtemps son allié contre le parti Huguenot.Les bateaux qui descendaient
l'Oise et la Somme répandirent sur toutes les rives du pays de France la
nouvelle de l'outrecuidance de l'étranger et, sans le dire, chacun comprit
l'urgence d'en finir avec les divisions internes funestes et souvent idiotes.
Saint-Quentin et le
Vermandois avaient servi les rois avec constance, courage et sagesse et
méritaient, à nouveau, un témoignage de satisfaction. Sitôt souverain à Paris
et roy consacré, il fit avaliser par le parlement de Paris, la "Loi
Salique" qui est donc très récente dans nos textes officiels . Les gens de
France, se souvenant encore des Anglais à Paris, et ne souhaitant pas du tout
le retour de la guerre de cent ans, votèrent la loi avec une large unanimité.
Ceci fait, le nouveau roi mit en tête de son ordre du jour de venir saluer ses courageux miliciens afin de les récompenser
pour leur attachement et leur
dévouement;
L'escorte royale fut ainsi
reçue le 5/12/1590. Aux portes de la ville, le
mayeur attendait le bon roi Henri pour lui remettre les clefs de la ville selon
l'usage des villes "closes". Henri gaillard et tonitruant
s'écria:
"Vive Dieu, mes amis ;
Gardez vos clés, elles sont en trop bonnes mains ! Servez-moi toujours comme
vous l'avez fait pour le feu roi. "
Après avoir remonté la rue
d'Isle à cheval, il fut reçu à l'Hôtel de Ville , aux sons des cloches et
carillons et de douze coups d'arquebuse, puis la cité lui fit faire le tour de
ses ouvrages tant de pierre que d'industrie et d'artisanat. Comme la ville versait aux
rois diverses finances, celles ci furent affectées à un banquet et à un bal. La première de ces réunions
fut offerte par le syndic des corporations. Le mayeur, en serviteur soucieux,
voulut goûter les vins et les mets avant de les présenter au roi ,
-" Je suis avec mes
amis, je n'ai rien à appréhender d'eux." dit le roi.
Cette réplique, très
fréquente dans notre histoire, n'a pas ici cet air galvaudé et convenu que nous
sommes prompt à lui attribuer.
Les pratiques malsaines des
Guise restaient vivaces dans les mémoires et l'affirmation de l'amitié des
bourgeois de Saint-Quentin, qui ramenait
en pleine lumière le long parcours des Luxembourg, Bourbons, Albret sur les
terres du Vermandois, était fondée comme aucune ne pouvait l'être.Le bal, qui suivit, fut
offert par le roi de France. La musique de ce temps nous est connu est nous
surprend toujours par ses rythmes et ses sonorités : rien n'y est triste même
quand l'amoureuse chante "mon ami me délaisse, au gué, vive la
rose...." et la danse n'exalte que le
plaisir de vivre . La vision du roi dansant des "bransles et farandoles
" demeure inséparable du souvenir inconscient que ce monarque a imprimé
sur ses sujets. Il aimait la danse, il
aimait son cheval, son pays et les femmes et par dessus tout c'était un fils de
chez nous qui, à l'instar du fils prodigue, avait abandonné des idées partisanes
pour retrouver tous les siens.
Dans l'espace de dix années
, Henri IV revint fréquemment dans notre région, et visita officiellement cinq
fois Saint-Quentin. Il confirma les chartes anciennes et accorda des exemptions
nouvelles et des privilèges avantageux .Pour Henri, qui ne passa que
peu de jour de sa vie sans monter sur la selle de son cheval, notre région était proche et une des plus belles histoires d'amour de
l'histoire de France, qu'il nous faut évoquer comme un moment de bonheur,
l'en rapprocha encore plus : Ce petit
bonheur, vous l'avez deviné, s'appelait ; Gabrielle d'Estrées .

La Fère, Gabrielle
Comme chacun de nos villages, celui d'Estrées
présente, au centre d'un terroir riche, un visage anodin et monotone. Son nom
appelle de vagues réminiscences mais nul monument ne permet de fixer une
imagination historique en quête de repères et, comme partout alentour, l'oubli a chassé au loin l'honneur d'être
d'ici plutôt que d'ailleurs. La famille d'Estrées , issue de ce sol, occupe
pourtant une place importante dans l'histoire de notre nation. La volonté
farouche de nos citoyens d'alors à vouloir être français plutôt qu'anglais,
allemands, bourguignons et autres, en dépit de la facilité du choix et des
avantages offerts, amena, dès la constitution de régiments royaux, plusieurs etits seigneurs de la contrée à se faire remarquer de la cour royale.
De plus, les grandes batailles récentes avaient contribué à la promotion des
seigneurs du "cru" qui avaient fait le bon choix. La famille
d'Estrées, bien que l'existence du village remontât à la colonisation romaine
qui lui a légué le nom d'étape sur la "strada", ne commença à figurer
dans les chroniques qu'à partir du milieu du quinzième siècle. D'actes
courageux en mariages prestigieux, la lignée passera du rang de bailli ( un
fonctionnaire) à celui de seigneur de Péronne, d'apparentée aux Montmorency à
proche des Bourbons. Evolution
naturelle à l'échelle du microcosme du Vermandois, où il était inéluctable que
les familles " bien assises" soient appelées à gérer ensemble les
grands enjeux des temps.
Après avoir essaimé de l'Arrouaise jusqu' à
Noyon, Laon et le Valois, les Estrées finirent par former une fratrie
considérable qui occupait les seconds postes derrière les familles royales et
les familles ducales. Jean d'Estrées
obtint d'Henri II la charge de maître et capitaine général de l'artillerie.
Notre région, héritière de la sidérurgie du fer, du savoir-faire des frères Bureau
et premier champ d'expérimention de l'arme nouvelle contre ses forteresses
réputées imprenables, se voyait
reconnaître une tragique compétence : l'artillerie.
L'arme, jusqu'à la théorie de la dissuasion,
a toujours été honnie en France. L'Etat centraliste a été, encore plus que les
autres, victime de cette idée reçue et il est heureux que la monarchie ait eu
le génie de garder des milices de place, sous un commandement unifié, car ce
sont ces troupes de province qui, à Valmy, seront les remparts de Paris et
sauveront la République. Au cours du conflit qui divisa le pays
entre Catholiques et Protestants, la
famille n'abjura pas, et se comporta comme la plupart des natifs du pays,
naviguant entre une admiration pour le courage des communautés protestantes, le
souci de l'unité nationale face aux puissances du Nord, et la fidélité aux
saints de la région qui ne méritaient pas l'exclusion de nos prières. Au cours
des tribulations de la période, la famille avait eu à subir les aléas du
pouvoir et sortait élimée et amoindrie ; celui-là avait été chassé de sa
seigneurie par les catholiques; tel autre avait perdu une charge récupérée par un huguenot,
sans chaque fois tomber dans le champ des revanchards. Lorsque le
prince de Condé récupéra le titre de gouverneur de Picardie et la seigneurie de
Péronne, la famille fut de celles qui rejoignirent la ligue pour réclamer
l'autonomie de la Picardie.
Antoine d'Estrées, fils de Jean, devait
hériter du titre de capitaine de l'artillerie à la mort de celui-ci en 1567,
mais c'est l'année où justement le prince de Condé assiège Paris et où le
connétable de Montmorency meurt. Les troubles du haut commandement écarteront
le jeune homme de ses droits et Antoine s'abstiendra de combattre sans demande
expresse du roi. Les séjours dans ses domaines devinrent plus fréquents. Il
avait épousé Françoise Babou, la fille du supérieur d'alors de son père, maître
de l'artillerie de François Ier, et en bon artilleur eut plusieurs enfants.
Avec sa nombreuse famille, il s'installa à
Coeuvres, dans la proximité de Soissons. Henri IV, sans doute, de retour de la fête à
Saint-Quentin, après son sacre où
Antoine dut proposer au roi , non encore sacré, l'hospitalité d'une nuit sur la
route de Paris, fit escale dans ce château. Agé de près de 37 ans, toujours par
monts et par vaux, depuis longtemps séparé de la reine Margot, le béarnais est
encore un coeur d'artichaut ému par la
moindre jarretelle quand l' ex grand-maître de l'artillerie lui présente sa
petite famille et la petite dernière Gabrielle.
Elevée un peu comme Henri IV, loin de la
cour, sauvageonne mais cultivée, sensible et irrésistiblement belle, elle a de
plus les brandices de son âge :
elle n'a que seize ans .
Le bon roi était encore, à cette date, un roi
factieux, porté par un mouvement populaire plus fort que les querelles de
clochers, cependant fragile et sans descendance. Bien que les liaisons du roi
soient déjà innombrables, Gabrielle apporte quelque chose en plus. Fille d'un pays fidèle, viscéralement, à la
personne du roi, simple et fraîche, elle eut la grande sagesse de résister aux
premières avances du roi. C'était obliger un Béarnais à s'obstiner. Henri
devint fou amoureux d'elle et accepta d'entendre la fière et pure jeune fille :
sa famille et surtout son père avaient des griefs contre le roi ; le prince de
Condé , oncle du roi, en était la cause et de plus l'action de celui-ci n'était
pas le meilleur ferment de paix pour une région toute prête à se dévouer
totalement. Henri IV a-t-il été, comme d'autres, aveuglé
par l'amour ?
Certainement ! bien que
singulièrement ses premières conquêtes ne l'aient jamais trahi ( les dernières
Marie de Médicis et Mlle de Verneuil armeront le bras de Ravaillac).
Ce qu'il devait aimer le plus chez les belles
devait être leur bon sens ! Henri IV prit donc la décision de rétablir Antoine
d'Estrées dans ses droits ainsi que tous les membres de sa famille. C'était
aussi un message clair à l'endroit de toute la noblesse et de la bourgeoisie de
la région : le roi récompensera la fidélité à la France et mettra fin aux excès
de rivalité entre les chapelles.
Gabrielle et Henri devinrent finalement
amants. Malgré la presse à scandale, Gabrielle fut reconnue comme l'épouse du
roi. Henri IV qui avait gagné dans cette alliance le coeur d'une région et une
mère pour des enfants avait encore quelques étapes à franchir pour être celui
qu'il voulait être. Son cas de figure était unique dans l'histoire et personne
ne pouvait encore dire comment un monarque pouvait régner sur une nation
pluricultuelle.Tout ira pourtant très vite.
Ayant pris Paris, il abjure sa religion.
En 1594, il est sacré à Chartres, fait
avaliser la "loi Salique" par le parlement.
Il rend une nouvelle visite à sa bonne ville
de Saint-Quentin, où il est reçu par Jean d'Y, chef de la famille dont le sceau
orne l'Hôtel de ville. C'était encore un voyage de lune de miel, la tendre
Gabrielle était du cortège avec, chez nous, rang de reine et de fille du
pays. L'année suivante, il obtient l'absolution du
Pape.
La ligue est dissoute. Lentement, le roi va
faire disparaître les foyers résiduels de cette opposition, puis en 1598,
édictera l'Edit de Nantes.Outre Gabrielle, la raison des quatre autres
visites que fit le roi en notre région fut donc liée aux derniers soubresauts
du mouvement papiste.
Dès 1596, alors que Sully, fils d'Artois a
été commis aux finances, que les régions bourguignonnes ont été purgées des
derniers ligueurs, le pays est pratiquement pacifié à l'exception de poches en
Picardie et Champagne. Comme Henri chevauche fréquemment du côté de
Soissons et Compiègne, il installe la belle Gabrielle à Coucy où celle-ci
séjournera pour sa première maternité. D'escarmouches en poursuites, les
troupes royales amènent les rebelles, à moins que les ligueurs n'aient fait le
choix délibérément d'être hors de portée des canons, vers la place de La Fère.
Ceux ci pensaient sans doute en faire le
recueil des batailles à venir. Henri a le temps, Gabrielle attend. Il laisse
les derniers ligueurs rejoindre la coalition et renforcer leur sanctuaire.
L'attentisme de Henri est évidemment mis sur
le compte de ce roi volage et mécréant mais peu connaissent la détermination
d'Henri IV. S'il a si bien écouté les femmes, c'est que ce grand roi a été
élevé par sa mère. Jeanne d'Albret avait instruit, très jeune, son fils de
l'importance de cette place pour la Navarre et des nombreuses fidélités que
comptait la famille chez les gens humbles du bourg et des communes avoisinantes
.La Fère avait été un apanage de sa mère et
des opposants l'occupaient ! Bien renseigné par les Estrées et d'autres,
Henri savait que la ville disposait d'un réseau d'écluses et de digues destiné
à éviter l'inondation de la vallée lors
des crues périodiques de la rivière. Il décida d'utiliser ces barrages à
rebours et, en les fermant, provoqua l'inondation de la vallée et l'isolement
de la cité sur son îlot.
Les troupes royales auraient pu, très
certainement, prendre la ville militairement, en peu de temps ; l'artillerie,
même à cette distance, était déjà redoutable. Henri IV fit durer le siège sept
mois, presqu'une gestation , tenant en haleine l'opinion publique et mettant
tous les récalcitrants le dos au mur. La reprise du conflit sur un autre front
aurait signé la condamnation de La Fère, Marle et Guise . L'ardeur des ligueurs
s'émoussa partout, tant dans la ville isolée que dans les autres provinces.>L'histoire , qui a embelli beaucoup de faits
et gestes du légendaire "roi Henri" parla d'une victoire à la suite d'une bataille navale. Des gravures
furent même faites où l'on voit de petites barques porter plusieurs ponts, des
mâts et voilures de galions. Ce fut, il est certain, le début de carrières de
marins quand seront cités les noms illustres de d'Abbovile et de Colas qui
participèrent à l'abordage. Les petites
gens de tous villages de la vallée et de la région jusqu'aux rives de la Somme
fournirent certainement sans barguigner toutes les petites embarcations de
chaland et de pêche. La bataille fut un triomphe et le jeune père put à nouveau
aller jusqu'aux frontières Nord du pays rendre visite à ses chers sujets.
L'Europe des Espagnols voyait le regain de popularité du français comme
l'obstacle majeur au retour d'Isabelle, l'héritière du trône. Aussi, en 1597,
un coup de main est tenté en direction d'Amiens. par l'armée espagnole postée
en Artois et Cambrésis. Une autre incursion, sous le commandement du Général
Fuentès viendra rôder sous les remparts de Péronne quatre jours. La ville d'Amiens, déjà aux mains des
ligueurs alors que toute la corporation de l'industrie du velours était
protestante, nécessite une intervention urgente.
N'est-elle pas la seule place forte fragile sur la ligne de front ?
Avec l'aide des Condé, Coligny, Sully, Estrées, tous picards, Amiens sera
assiégé et tombera après un long encerclement. Une fois la place reconquise, les fonctions de mayeur et d'échevin
seront supprimées. Le roi, qui ne connaît
que trop les divisions entre les familles nobles de la région, qui ne peut
choisir entre les Condé et les Estrées, ni favoriser ses compagnons
protestants, érigera toute la région en généralité dépendant directement du
pouvoir royal. La Picardie que nous connaissons aujourd'hui fut donc portée sur
les fonds baptismaux par Henri IV.
Pour
asseoir encore son pouvoir, comme le père de Gabrielle venait de décéder, il
confia la charge de grand-maître de l'artillerie au fidèle Sully, fils de
l'Artois et donnera en compensation à sa dulcinée des titres. Celle qui était à
la cour, madame d'Amerval, car Henri s'était arrangé pour lui faire donner un
statut de dame en lui donnant pour époux, un vieux soldat " impuissant aux
choses de mariage" par suite de blessure de guerre ( Saint-Quentin en
1557) , reçut en compensation et pour preuve de l'amour du roi, les titres de
marquise de Monceaux et de duchesse de Beaufort. Les deux bâtards du roi ne furent pas en reste, il
seront nommés duc et seigneur de Vendôme, qui était l'un des plus beaux fiefs
de la Navarre.
Si la bataille de La Fère avait mis en présence des forces
franco-françaises, celle d'Amiens incluait des troupes d'une puissance
étrangère, en trop petit nombre certes pour constituer un "casus
belli" mais l'avertissement était clair. Prenez garde, l'Espagnol ne vous
aime pas ! Henri aimait trop la vie pour supporter ce
sentiment. Comme un nouveau défi, il partira à la conquête de ce peuple voisin,
à sa manière, avec bonhommie et du temps. On mesure trois siècles après combien
sa réussite fut éclatante en rappelant que le roi d'Espagne, Juan Carlos, est son descendant direct.
Il reviendra donc dans notre région pour
aller signer le traité de Vervins qui confirmait celui de Cateau Cambrésis. Pour consolider une paix, la vieille usance
imposait une alliance devant dieu et son Eglise. L'idée germa d'un mariage qui
aurait bien arrangé les choses.
Mais le roi vit le parfait amour avec celle
que le peintre Clouet a immortalisé en buste nue et dont la beauté rayonne
toujours. Après les séjours parfois furtifs et parfois prolongés dans les
belles demeures qui saupoudraient la région et dont très peu ont été relevées
de leurs ruines, Gabrielle s'installa
avec ses trois enfants dans les belles résidences du bord de Loire. C'est de là
bas que vint le cliché du roi jouant avec ses enfants à quatre pattes ; l'image
donnait toute puissance à la locution d'un roi bon-enfant. Le peuple était
d'autant plus ému que tout le monde savait que Gabrielle n'était pas de sang
royal. Le coeur heureux, le roi et son
administration firent en peu de temps des réformes d'importance. L'Edit de
Nantes rendit aux protestants leurs droits civiques et assura partout une quasi
liberté de culte. Les finances furent restaurées, même si la méthode prêtait le
flanc à la critique.Nos régions qui avaient combattu directement
avec des milices levées au sein du peuple refusaient d'acquitter la taille qui
justement servait à l'entretien de la troupe royale. La requête fut reçue et 20
millions d'arriérés de taille furent remis.
Pour assurer des recettes, l'Edit de la
Paulette rendit possible l'achat des charges sur 60 années, ouvrant à des
fonctions héréditaires toute une classe nouvelle ; la noblesse de robe. Un sang
neuf pénétrait dans les antichambres de la haute administration avec des effets
bénéfiques : rentrées financières, professionnalisme accru, couverture
nationale, pépinière cultivée, décentralisation , mais avec également un effet
pervers redoutable alors même que le monde s'élargissait : la France deviendra
le pays des petits privilèges, des statuts, de la sclérose administrative.
Un inventaire complet des maléfices de cette
loi amènerait à faire réfléchir toute notre administration qui, depuis
longtemps, a " perdu la circulaire et ne sait plus faire" , des Trésoriers Payeurs Généraux, héritiers
des fermiers généraux, des notaires, des huissiers, des avocats et de tous les fonctionnaires. Ces derniers
rappellent d'ailleurs tous les jours aux usagers qu'ils possèdent leur poste à
vie et que leurs enfants disposent de tous les avantages acquis pour occuper
les places après eux.Celui qui avait réunifié la France autour de son roi ne se
doutait pas de cette déviation et l'eut, sans doute, corrigée.La réussite économique compléta le triptyque
de la paix et des bonnes finances.
Dans ce monde de félicité, le malheur
commence à s'abattre quand Gabrielle meurt en couche, enceinte de son
quatrième. Henri, qui hésite à organiser, par bon mariage, une ligne de
résistance contre l'Espagnol pour rebondir plus tard, et qui a
même introduit une procédure pour épouser légalement Gabrielle, est cruellement
atteint.
"
La racine de mon amour est mort, elle
ne rejectera plus.
"
La formulation esquisse merveilleusement la
part d'amour charnel qui unissait les deux êtres. Celui qui sacrifia une Messe
pour sauver des milliers d'âmes sera aisément pardonné pour sa franchise. Pour
un picard, plus difficile sera pourtant, d'admettre qu'il n'ait pas tenu cette
dernière promesse, car son reniement causera sa perte.
Pour consolider sa place sur l'échiquier
européen, Henri acceptera le mariage avec Marie de Médicis, pensant ainsi
obtenir la grâce d'une famille qui avait tyrannisé sa mère, du crédit auprès
des florentins, une bénédiction papale et une entrée à l'Escurial. Le calcul,
audité et recompté par ses fidèles donnait l'assurance de pouvoir, à terme,
entreprendre la création d'un pays protestant aux Pays Bas.
Henri obtint aisément du pape l'annulation de
son mariage avec la reine Margot ( la bulle assura qu'il n'avait pas été
consommé), du crédit et la main de Marie.
Pour assurer sa place, il lui fallait un
enfançon. Henri IV avait aussi besoin de cela. Naquit ainsi Louis XIII. Le roi
pouvait entamer le soutien aux Flamands. La chose réveilla les antipathies
endormies et le goût de la vendetta. Dès le lendemain du jour où Marie de
Médicis obtint le titre de reine, lui assurant la régence, Henri périt
poignardé.
Le Vermandois pleurera sincèrement son roi.
Chevalier infatigable, ami des humbles, généreux, formidable homme d'Etat et
roi bon-enfant, son souvenir témoigne pour lui.
De son règne et de celui qui suivra, notre
région héritera beaucoup de petits manoirs de briques et moellons de pierre
taillée avec juste quelques réminiscences de tourelles pour rappeler les forteresses que l'artillerie venait de
sortir des signes extérieurs de puissance.
Parmi les impulsions qui furent données par
le gouvernement d'Henri, il faut citer aussi:
la
création d'une "maîtrise des Digues" qui fut confié à un Hollandais ,
Humphrey Bradley, dont un lointain descendant viendra rendre à l'Europe un
sérieux service,
le
percement du canal de Briare, qui ouvrira l'ère de canaux, période faste qui ne se terminera que dans les années 1970 sous les coups de butoir
des syndicats de cheminots,
le
renforcement de la flotte qui remit la présence de la France en haute-mer au niveau de ses deux rivales : Espagne et Angleterre,
la
prise de possession du Canada.
En histoire, comme dans la vie, les
gouvernements fragiles et courts sont souvent les plus féconds en oeuvres durables. La vie de Henri IV est, sur ce
point, éloquente. L'énumération des décisions, qui ont vraiment bouleversé le
pays, fait pâlir les règnes de ses flamboyants successeurs . Ni Louis XIII, ni Louis XIV, ni Louis XV, ni
Louis XVI qui symboliseront la monarchie absolue où le temps semblait asservi,
aucun ne réalisa autant que ce petit roi singulier, mal vu de la majorité des
cours d'Europe..
Les digues, les canaux, la
"Royale", l'Amérique; l'enfant du Gave du Pau aimait l'eau et le
grand large, dira la légende. Cette passion, à notre sens, il l'a dû plus à ses gènes familiaux qu'à son séjour pyrénéen
; n'était-il- pas le fils d'un concitoyen né sur les rives de la Somme, connaissant, par atavisme, la
générosité des flots maîtrisés et la nécessité de travaux concertés et
obstinés pour mener sa barque au port ?

Une manière d'apogée. Le
XVII ème siècle.
Les manuels d'histoire insistent lourdement
sur les changements qu'ont apporté la renaissance et le 16ème siècle dans la
sculpture et l'architecture.Les vrais
raisons de l'évolution de l' habitat n'avait rien à voir avec l'influence
italienne, Tartaglia excepté. La
nouvelle noblesse de robe et les seigneurs utilisèrent simplement les
ressources du pays, en construisant en briques avec des tenons de fer, des maisons
plus confortables.Les spectateurs de ces temps furent beaucoup
plus attentifs à des innovations qui ont engagé le pays vers l'ère moderne.Notre région connaissait depuis la plus haute
antiquité l'existence de la fiscalité. Fin 1576, une étape essentielle fut
franchie par l'instauration de la "
Taille générale"; non pas que ceux
qui en étaient exemptés allaient l'acquitter, la France a toujours été ce pays
démocratique ou seule la minorité paye l'impôt de tout le monde, mais par
l'instauration d'une taille retaillée sur mesure, c'est-à-dire tenant compte
des ressources.
Ce nouveau mode de calcul, conjugué avec
l'état civil, les écrits commerciaux et la connaissance des valeurs des charges
publiques, va faire rentrer nos concitoyens dans le monde des chiffres, de la
comptabilité et du raisonnement économique.Aussi, les premiers économistes
firent-ils leur apparition dans notre
pays. Ils eurent le grand mérite d'être à l'image de leur temps, soucieux d'un
dépassement de l'esprit partisan et du dogme ; analystes plus que doctrinaires,
ils furent facilement récupérés par les économistes anglo-saxons qui, un siècle
après, formuleront des théories beaucoup moins nuancées. Parmi ceux-ci, le plus intéressant fut, sans conteste, Jean Bodin, mort à Laon
en 1596. Il est l'auteur du fameux :"
il n'est de richesse que
d'hommes" et énonça dans le "
Traité de la République" la notion
de contrat social, tout à l'opposé des pensées de Machiavel. Procureur du roi
au bailliage de Laon, il étudia aussi dans sa "
Réponse aux paradoxes de
Malestroit", toutes ces questions sur la monnaie, l'inflation, l'activité
et le crédit qui agitent encore tous les penseurs économistes et les
politiciens du monde.La société dans son ensemble devenait motif
d'étude scientifique. L'économie comme le droit suivaient la destinée de la
religion : la seule bonne est celle qui sert d'instrument et non de fin en soi.
De cet homme sage et remarquable, on ne
s'étonnera pas d'apprendre que , bien que piètre orateur, il fut la voix qui emporta la décision
des échevins et notables de Laon de lâcher la ligue pour se placer du côté du
roi Henri.
Une digression sur Rabelais et Montaigne
n'est guère nécessaire car ils identifièrent ce souffle nouveau. Pour nos
villages, un original venu du sud joua aussi un rôle important, même si ce fut
très indirectement. Plutôt que de participer aux luttes fratricides des
gentilshommes catholiques et protestants. Olivier de Serres cultiva son jardin
en Ardèche. Il essaya le maïs, récemment venu d'Amérique, le riz, le houblon,
mais surtout théorisa l'assolement triennal, avec le remplacement de la jachère
par une année de pousse d'herbe ou de betterave. Henri IV, le fit venir à Paris
où il planta vingt mille mûriers blancs dans le jardin des Tuileries . On
imagine l'étonnement du peuple de Paris qui découvrit que chacun pouvait avoir
son ver à soie chez soi.
Olivier écrivit le "
Théâtre d'agriculture et de ménage des
champs" qui eut beaucoup plus d'influence que la pseudo politique de
Sully. "
Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France"
n'était qu'une proclamation sans accompagnement financier mais réjouissait tous
les paysans et particulièrement chez nous, car Sully était un voisin de
l'Artois qui connaissait l'âpreté du travail de la terre et le caprice des
récoltes. Le travail de la terre bénéficia, aussi, des
grands progrès qui fit faire Ambroise Paré dans le soin des plaies et des
fractures. Médecin itinérant des armées, il fit beaucoup de son ouvrage en
Picardie où la matière première était nombreuse derrière les troupes de
Coligny. La chirurgie et la connaissance des plantes
médicinales se diffuseront assez vite dans les campagnes car les Juifs
d'Espagne viendront nombreux se réfugier chez nous où ils ne pouvaient pas
exercer beaucoup d'activités. En 1565, apparaît le premier texte reconnaissant
à des Juifs le droit de résider en France. Ce droit sera toutefois limité par
une assignation à résidence : la " Judengasse ", d'où viennent les
rues des juifs que l'on trouve encore dans les bourgs à dominante commerciale. Bien qu'elle ne laisse rien dans les granges
et rien dans les corps, ce tableau des progrès serait incomplet sans
l'évocation de l'apparition de la musique profane qui grâce à Clément Jannequin
(qui fut un protégé de François de Guise) permit que la chasse, le chant des
oiseaux, la bataille puissent devenir des thèmes polyphoniques. L'orchestre
pour les danses répétait à côté du chapitre et les temples protestants
glorifiaient, comme jamais, Dieu avec des rythmes forts et des mélodies
parfaites. Les fanfares champêtres aussi sont nées à cette époque à côté du bâtiment de la milice qui, entre deux
campagnes, pouvait souffler un peu. Avec le 17ème siècle, l' ère moderne était
bien là et le Vermandois était à la page comme depuis les débuts de la
civilisation. La mise en place de la Généralité de Picardie instituait une
structure intermédiaire qui bloquait les grandes familles de sang royal. Ainsi,
Claude de Rouvroy, sire de Saint-Simon qui pouvait faire état d'une ascendance
carolingienne, d'un titre de duc-pair de France, n'avait plus qu'un avenir
limité sur place, plus de droit de lever d'armée, plus de droit de
haute-justice, quelques taxes et des rentes, rien que des picaillons. Il vendit
donc ses droits et ses biens et garda le titre pour allez côtoyer les siens. La
terre de Saint-Simon, accrochée au nom de la famille, deviendra célèbre, d'une
part par les mémoires du duc de Saint Simon qui est l'ouvrage le plus complet
et le plus impartial sur tout le règne de Louis XIV et d'autre part, par le mouvement des Saint-Simoniens qui furent
les grands ingénieurs du 19ème siècle.
Coupé de notre terroir depuis plusieurs
générations, le nom de Saint-Simon porte gloire quand même à la région.
L'indépendance d'esprit du duc et ses impertinences et son cynisme
traduisaient l'autorité morale de celui
qui portait le témoignage vivant d'un millénaire d'histoire commune. Parce que
le site de Saint-Simon prouvera
l'intérêt des grands travaux pour le mieux-être du monde, ce mouvement, qu'on
dit de pensée alors qu'il lui fallait comme les autres un sol pour projeter ses
visions, comptera parmi les plus
importants des temps modernes.
A l'heure de l'apogée, l'industrie
accompagnait l'ensemble et préparait son zénith.Comme cette activité, plus que tout autre,
nécessite foi et moyens, la ville de Saint- Quentin, qui avait sagement épargné
les protestants, sera payée en retour et vit s'installer chez elle en 1585, un
Coutraisien, Jean Crommelinc, attiré avec quelques autres par la tolérance
religieuse. A cause de la destruction de 1557, Saint-Quentin avait perdu ses ateliers de
confection de serge, saye, camelot et
droguet. Ces draps légers de laine,
parfois croisée avec du poil de chèvre, de la soie voire des fils d'or avaient
fait la renommé mondiale de la ville et mérité son inscription sur la liste
officielle des fournisseurs de Londres : la "Grande Hanse".
Dans leurs bagages, Commerlinc et les
Flamands apportèrent les premières
techniques de blanchiment des toiles , le tissage du lin et la pratique des
colorants.Les métiers à tisser, les rouets étaient
choses communes, les moutons foisons, mais il fallait une structure spécialisée
sur l'ennoblissement pour métamorphoser l'ensemble. L'industrie textile, fille
de l'ordre de la Toison d'Or, trouva ici, à nouveau, une terre fertile et
attira, dans son sillage, le commerce de gros des laines sur les places de
Chauny et Saint-Quentin, les savonneries, les fabriques de matières grasses et
collantes ( l'huile de lin) et surtout les teintureries. Ces dernières
utilisaient des produits couverts par le secret professionnel et toujours
annoncés comme venant de très très loin : l'indigo, le bois du brésil, bois de
campêche, l'alun.
Par quel miracle, cette industrie a-t-elle
survécu ?
L'avancée technologique, acquise par
nécessité à la fin du 16ème siècle, constitue une explication vraisemblable.Une légère extrapolation nous permet de
placer dans la lignée de cette industrie, les progrès des peintures à huile et
l'apparition du pastel qui trouvera naissance et sa plus belle expression dans notre région. Le seizième siècle, qui plaça notre région au
centre du monde, demeure une énigme et est indiscutablement marqué des
caractéristiques de l'ère moderne : l'histoire s'accélère tout à coup et tout
semble devoir se fracasser tous les jours ; les murailles, les autels,le droit du sang perdent leur valeur et, pourtant, à l'ombre d'une puissance
croissante de destruction, apparaissent des joyaux de littérature, de musique,
de peinture, d'art et d'industrie. Pour le contemporain du vingtième siècle, ce
paradoxe réside au coeur même de la dynamique. Le conflit entre protestants et
catholiques traduisait au niveau des mots et des invectives l'évolution
laborieuse d' un changement de structure de la société des trois états
(noblesse, clercs, tiers-état) vers quelque
chose de nouveau qui n'avait pas encore de nom. Le modèle antique de la cité
était le seul enseigné dans les écoles avec sa variante issue de Saint
Augustin, mais chacun ressentait le besoin d'autre chose car les relations
personnelles avaient déjà changé.
L'édit de la Paulette confirmait la nécessité
d'une émergence mais aussi enfermait la réflexion. Période de bouleversements
très modernes, ce siècle évolua, d'une part, par l'art appliqué, grâce aux
libertés que les gouvernants accorderont aux villes, et par l'absolutisme, qui
va concentrer la légitimité du pouvoir, sur le monarque. Ce manège, dont seul
Machiavel avait entrevu la mécanique, ne trouva au sein des universités que peu
d'analystes et pas de critique. L'école laïque n'ouvrait pas de troisième voie et l'université d'alors
n'offrait plus de champ de confrontation entre les idées pourtant proches des
huguenots et des jésuites. Ignace de Loyola qui rejetait toute la hierarchie
catholique traditionnelle n'était-il pas l'expression vivante du protestant ?
Cette lacune, le peuple en son entier la
ressentait et toutes les victimes hurlaient pour la création d'une institution
populaire. Elle naîtra lentement, très lentement.Ce n'est qu'en 1698 que la ville de
Saint-Quentin institua une taxe pour l'entretien des écoles. Par ce modeste
biais, la société civile pénétrait dans le fief de l'enseignement.Les
grands principes des Eglises ne craignaient rien encore mais les parents,
enfin, rentraient à l'école. La chape de plomb des libertés pour un très petit
nombre et l'absolutisme pour la masse se lézardaient. En moins d'un siècle, la
civilisation aura changé sans que rien vraiment des mentalités n'ait
fondalement évolué.
Avant d'arriver à ce tournant décisif, déjà
annoncé par l'arrivée des écoles jésuites dès 1604 et l'apogée des arts, il
nous faut continuer à lister les faits, petits et grands, de notre histoire.
Tous vont s'inscrire dorénavant dans cette perspective car le Vermandois adhère
depuis Henri IV , autant sociologiquement que psychologiquement, à la
communauté française et à son destin de manière définitive. Après la disparition tragique du roi, la
période de régence de Marie de Médicis ramena en France une clique de personnages hauts en couleur et exposa notre
région aux intrigues et troubles des grandes familles nobles.
Le duc de Longueville, bourbon et natif de
Ham, gouverneur de la Picardie sera, bien sûr, de la partie dans toutes les
manoeuvres de troupes au cours des années 1614 à 1616. Marie de Médicis n'a pas besoin de regarder la carte
longtemps pour mesurer le péril . Le comte de Soissons est un proche parent du
gouverneur. Une autre famille alliée au Grand Condé, dont l'épouse n'était
autre qu'Eléonore de Roye, possède un
large fief entre Péronne et Mondidier : les d'Ailly, ceux-ci aussi veulent
faire la loi le long de la voie qui relie Paris aux Pays Bas. Lorsque le prince
de Condé quitte la cour en 1614, tous suivent et soussignent le manifeste
contre la reine et contre Concini. Ce dernier, personnage de roman tout à fait authentique,
ne s'est-il pas constitué une armée personnelle de 7000 hommes, n'est-il pas le
premier ministre avec tous les pouvoirs ?
La tension est donc vive, dans le pays livré
à la fronde. Pour mettre échec aux menées des Picards et Champenois et protéger
le chemin de fuite vers l'Espagne, Concini se fit attribuer, ou s'attribua
lui-même, le gouvernement d'Amiens et de Péronne avec le titre de Marquis
d'Ancre. Ce court filet de rivière, marquant une frontière du Vermandois, faisait ainsi une entrée magistrale dans un
monde agité.Heureusement que Louis XIII portait les gènes
de son père et une partie de son génie . Le roi a pour mission de gouverner et
rien ne saurait l'entraver. Sagement, il s'engage par mariage avec la fille du
roi d'Espagne, Anne d'Autriche en 1615. Comme son demi frère, le duc de
Vendôme, fils de Gabrielle échoue dans une tentative armée contre Concini et
ses sbires, Louis XIII, aidé par Albert de Luynes, fait carrément assassiner
Concini en 1617 et invite sa mère à résider sous haute surveillance à Blois et
à n'en sortir que sur son ordre.
Louis XIII récompensa de Luynes, en conférant
à son frère le marquisat d'Ancre et en
accordant à ce dernier la main de l'héritiére de la famille d'Ailly.
Son influence étant bien ancrée, Louis XIII
rendit une visite solennelle dans la bonne ville de Saint-Quentin et dans celle
de Péronne, tout émues de recevoir un roi si jeune, capable d'une détermination
aussi marquée que celle de feu son père.Le petit roi, qui avait perdu son père à
l'âge de dix ans, perpétua les projets secrets de celui-ci. L'alliance avec
l'Espagne atténuait le risque de conflit frontal mais ne pouvait écarter la
dynastie d' objectifs à long terme : conquérir l'Artois, voire la Flandre,
promouvoir une nation protestante au nord. Le fils asssuma l'héritage politique
malgré la toute puissance de sa belle
famille, avec un style, bien à lui, déterminé, moins chaleureux que celui de
son père mais diablement efficace.
Richelieu est resté comme le seul
bénéficiaire de ce compliment car Louis XIII, monarque absolu comme son père,
déléguait moins.Ce fut lui, cependant, qui dès 1616 inspira
la politique de Richelieu dont le dessein fut résumé par le cardinal en une
formule :"
arrêter le progrès de la cour d'Espagne .".
On imagine la volée qu'il aurait recue de sa
fière jeune femme s'il l'avait lui-même
proférée. Non, Louis était prudent et avait appris très jeune à l'être mais
c'est bien à lui que Péronne doit les importants travaux de renforcement des
remparts : le bastion Richelieu dont la tour a des murs épais de 24 mètres .
Deux cents hommes travaillèrent sur le chantier. Ils nous ont laissé à la porte
de Bretagne un message inscrit dans la
brique pour chanter la gloire du roi qui recevra sur ce seuil les clés de la
ville de ses deux possesseurs : le mayeur et le gouverneur.Le motif de briques noires, toujours visible,
célèbre la visite de Louis XIII par
l'inscription:
"Vive le Roy"
" RMP"
pour les trois villes de Roye, Mondidier,
Péronne
et deux représentations symboliques des
clés.
La reconstruction des places de Guise,
Péronne, Corbie s'accompagnait de contacts diplomatiques avec les protestants
du nord de l'Allemagne qui, dans le prolongement de la guerre de religion
française, entamaient une guerre sacrée vers les états papistes du sud sous la
domination de l'empereur d'Autriche Habsbourg.
Depuis la parution du catéchisme de
Heidelberg de notre concitoyen Calvin, en 1563, la doctrine Calviniste autorise
la solution armée. L'opposition avec les Etats catholiques du Sud devient
irrémédiable. L' adossement de la Lorraine, de la Franche Comté, de la Bavière
et de l'Alsace sur la Suisse, bastion fortifié du protestantisme, rend ses provinces
vulnérables. Une guerre va en résulter et durer trente années. L'Alsace et de
nombreuses régions d'Allemagne gardent le souvenir d'une période de guerre
civile horrible. Comme chez nous, elle fut impitoyable. Les premiers Etats du Nord commencèrent les
hostilités vers 1618. Seuls, au début, le Danemark et la Suède se joignirent à
eux pour des expéditions punitives sanglantes. La chevalerie interdisait
l'agression des femmes et des enfants. Wallenstein et les autres se
glorifièrent d'être des égorgeurs d'enfants. Louis XIII et Richelieu
manifestèrent le soutien de la France à cette cause. La Bourgogne, la Franche Comté, l'Alsace, la
Lorraine sont encore aujourd'hui les pays les plus fermement attachés au catholicisme et devaient l'être encore
plus totalement à cette époque. Parmi les seigneurs importants de cette vaste
région, le duc Charles de Lorraine qui
avait épousé la dernière fille de Gabrielle d'Estrées, tenait de plus en plus
souvent garnison près du Doubs dans une région charnière qui permettait tout à
la fois, l'incursion en Alsace, en Suisse et en Lorraine. L'entrée en guerre de
la France signifierait un danger de coupure des provinces espagnoles de Flandre
et Artois d'avec la Lorraine et la Bourgogne. Charles de Lorraine part donc
vers le nord , sans perdre de temps.
Il n'a pas tort car, déjà, le héraut du roi
de France est parti vers Bruxelles porter la déclaration de guerre. Derrière
lui, le maréchal de Châtillon emmène les premières troupes vers Liège pour
faire la jonction avec les Allemands et les Hollandais.Un conflit multilatéral se déclenche de part
et d'autre du Vermandois, mais le maréchal tarde à trouver les alliés du nord.
L'ennemi espagnol, plutôt que de courir après le commando égaré, se retourne
directement vers la France. Après tout, ce sont des traîtres. L'infant Don
Fernando, beau frère du Roi, franchit, avec audace la frontière, prend le
Catelet, Corbie, et son avant-garde descend jusqu'à Pontoise.Les places et les villes ne feront qu'une
résistance symbolique à ce voisin du Nord. >On annonça vite et le procès des soldats
félons et la montée d'une armée nouvelle sous les ordres du roi. Les milices
furent rappelées.En même temps, la jonction du nord ayant eu
lieu, les troupes du prince d'Orange-Nassau, passèrent à l'attaque sur
l'arrière des troupes de l'Infant. Le repli fut donc ordonné par l'Espagnol,
ainsi que fut donné l'ordre aux troupes de Charles de Lorraine d'accélérer la
cadence.Charles de Lorraine arrive lui par l'Est et
prend la partie sud du Vermandois, alors que déjà les Flamands rentrent.
Le pays fut donc puni. Les maisons furent
brûlées, comme les granges. Les
récoltes et le bétail disparurent. Seuls furent épargnés les châteaux, les
églises et les presbytères.
La punition fut finalement légère car le duc
de Lorraine aimait sa femme qui était la propre fille de Gabrielle d'Estrées et
Don Fernando descendait , lui , de Philippe II. L'empire bourguignon et la chrétienté
garderont, de ce fait, dans le subconscient des habitants des villes et
villages de la contrée, une réputation
plus proche de l'amitié que de la l'hostilité.L'armée française récupéra vite les terres
occupées et Louis XIII et Richelieu indemnisèrent le pays.
La région sortait, une nouvelle fois,
meurtrie pour l'exemple, sans que personne ne l'eut consultée, simplement parce
que la carte l'avait placé là, à la merci des grands et de l'histoire .
De cette incursion brutale et dévastatrice,
le souvenir s'estompa vite. La reconstruction des habitations à toit de chaume
n'était-elle pas un passe temps tous les deux ou trois ans ? Les communes
retrouvèrent leurs aspects d'antan. Un ressentiment fut le seul reliquat de
l'épreuve. Quelle confiance accorder à ces religions qui avec leurs
prêchi-prêcha s'avèrent pires que le reste ?
L'homme vaut mieux que l'homélie !


Le Vermandois à l'heure
des dévotions.Coliette, Valincourt, Grandin. Condren.
Bien arbitrairement, le début de l'ère
moderne se confond avec le siècle d' Henri IV.Deux faits majeurs, parmi d'autres, contribuent à cette assimilation :
le triomphe de l'artillerie d'une part qui n'endommagera pas les forts de Ham,
ni Coucy mais modifiera les remparts de Péronne et surtout rasera une première
fois Saint-Quentin et, d'autre part, la fin de l'arme blanche
comme carte d'identité.
L'Occident devait à la chrétienté que l'arme
blanche valait plus qu'une simple arme de défense ou d'attaque. Elle était
devenue l'outil d'un code et seuls les nobles pouvaient la porter et s'en servir.
Ce droit s'était, petit à petit, confondu avec celui de faire justice et,
aujourd'hui, encore les deux symboles sont souvent représentés ensemble :
l'épée de la justice n'orne-t-elle pas les frontons de tous les tribunaux de
France ?
Avec l' assassinat de François de Guise
fomenté par le parti protestant, une innovation bouleversait complètement le
monde. Sorte d'artillerie portative en miniature avec une précision d'
arbalète, ce sont les ferronniers de Brescia en Italie qui lanceront le gadget
sur le marché : le pistolet à pierre de silex faisait une entrée tonitruante et ambiguë dans l'histoire : elle tuait
mieux. Elle sera vite condamnée par les Eglises, sauf contre leurs ennemis,
qui, en cette époque, priaient, pourtant, le même dieu sous les mêmes espèces.
La diffusion de l'engin fut largement facilitée, sans que ne soit entrevue la
gravité de cette permission..
Le Vermandois perdait son avance
technologique obtenue depuis les Celtes dans le travail, la fonte et la
forge, du fer des épées, mais, surtout,
la justification même du droit de justice était, sans coup férir, atteinte dans
son fondement et mise en cause. La distinction entre haute et basse justice
s'estompe quelque peu lorsque le tout-un-chacun peut infliger la sanction
suprême. La haute justice va glisser
entre les mains des grandes familles vers les magistrats et vers la justice
royale.Les spadassins, les gardes, les milices de
sûreté deviendront l'ossature de la sécurité publique et le régiment des
mousquetaires n'aura que l'héritage du panache et des traditions
chevaleresques.
Les Etats -Unis d'Amérique, où le port des
armes à feu individuelles est autorisé, font la démonstration de l'énorme
insécurité qui résulte de cette liberté et, aussi, de la nécessité d'une justice et d'une police efficace
s'appuyant sur un cadre législatif sans passe droit et d'un code moral rigide
et puritain . Notre pays n'avait que des institutions
fragiles et le bruit de la poudre obligea à resserrer partout l'ordre moral ,
autant que l'ordre civil.La violence de la période passée fut le
terreau d'une autre violence beaucoup plus intellectuelle avant que le problème
de la justice égale pour tous ne soit véritablement envisagé.
Pour comprendre l'ampleur du désarroi qui
atteignait l'Occident chrétien dans sa fibre, il faut replacer ici dans son
contexte les décisions du pape Jules III prises vers 1551, à la suite du
Concile de Trente. Face aux questions posées par la relecture de la bible par
les protestants, le descendant de Pierre devait nécessairement se prononcer sur
la transsubstantiation, l'extrême-onction et la confession, dont les écritures
saintes ne parlaient pas. En termes
techniques, il ne s'agissait que de fixer, en monnaie d'alors, le prix que les chrétiens devaient payer
pour s'assurer le paradis. La
confirmation de la présence mystérieuse du Dieu dans l'ostie rendait
obligatoire que les bâtiments d'église se dressent plus haut que tous les
autres et en particulier les beffrois et les temples. L'extrème-onction devint
"l'ultima ratio" du clergé qui devenait décisionnaire sur ce moyen
séculier d'excommunication puisque ce sacrement pouvait être refusé, à certaines professions notamment.
Concernant le dernier point théologique, le pape décréta la confession orale
nécessaire, voire obligatoire. Il ne pouvait plus être question de refuser que
les individus recherchent eux-mêmes leur salut mais il fallait garder le
troupeau à portée des bergers et des chiens, et, pour cela, coloniser les
consciences.
Du début du grand siècle, au siècle des lumières,
à la Révolution et jusqu'à la période récente d'avant Vatican II, la confession
orale fut donc l'acte principal du chrétien. Le confesseur remplaçait-il
ou complétait-il la conscience de
l'individu et lui-même ne subissait-il pas un sort identique de la
fréquentation de son propre confesseur ? La réponse n'appartient , sans doute,
qu'à Dieu. L'observateur relèvera que
les mondes de la littérature, de la réflexion morale et historique feront un formidable bond en avant, à peu près
équivalent à ceux du conformisme et du centralisme.
L'Académie Française, fille de Richelieu et
donc de Mgr Lescot son confesseur né dans notre région, concentre toute l'ambiguité de cette
période. Ce qu'elle n'admet pas constitue une faute d'orthographe et exclut son
auteur du cénacle. La matière, qu'elle a traitée, ressort polie, claire et
précise et ouvre à l'expression des chemins plus sûrs.
La distinction des individus qui ne se
faisait plus sur le droit au port d'arme, reposera maintenant sur des critères
plus intellectuels : c'est l'époque humaniste pour certains, classique pour
d'autres, conformiste pour tous. Les grands hommes issus de notre sol n'auront
plus grand chose de commun avec leurs prédécesseurs. Ni le courage physique, ni
la sainteté, ni l'originalité, ni le sens de l'honneur du sang et de la famille
ne figureront sur la liste des matières d'examen.>L'ordre de classement s'appuiera sur un
penser correct strict, se limitant à des sujets éthérés avec un comportement
d'étiquette. Saint Simon sera féroce sur les hypocrisies de la cour royale comme sur les comportements et les idées de
la quasi totalité du monde qu'il cotôyait . Il prit, toutefois, la défense de Boileau et
d'un de nos concitoyens, Jean-Baptiste-Henri Du Trousset de Valaincourt. Natif
de Ham, d'une famille noble de Saint-Quentin, il se fit connaître par divers
écrits parfaitement en phase avec l'esprit de l'époque: lettres à Mme la Marquise de.... sur la princesse de Clèves, renfermant :
une critique modérée et sage de cette audacieuse immorale,
une biographie commentée sur François de Guise, personnage
incontournable,
une sur le Connétable de Bourbon, son concitoyen,
des observations sur l'Oedipe de Sophocle,
des traductions des poésies d' Horace,
Le personnage est maintenant relégué aux
renvois dans les livres de littérature, mais il fut successeur de Racine à
l'Académie Française et un des rares personnages de son temps considéré par
Saint Simon qui admirera sa sagesse.
Lors du conflit des anciens et des modernes,
pressentait-il, comme Saint-Simon, les risques d'une société sans dieu ? Il se
placera avec Boileau du côté des rétrogrades.L'ouvrage qu'il rédigea avec Boileau sur
l'Histoire de Louis XIV est malheureusement resté inachevé et Valaincourt, dont
le portrait est à Versailles, plus connu des amateurs d'art du grand siècle que
des historiens. Sa sagesse ne fut pas que littéraire.
L'époque prônait les valeurs morales les plus exigeantes et répétait, en
litanies : l'argent pourrit et en
parler est signe de mauvaise éducation. Valaincourt, nous dit ce même Saint
Simon, géra bien sa fortune et finit très riche, preuve réconfortante d'un bon
sens paysan plus fort que toutes les dissertations . La contribution littéraire du Vermandois ne
se limitait pas à cet académicien. Coliette, curé de Gricourt et chanoine de
Saint-Quentin, rédigea la première histoire du Vermandois. Emmerez, de la Fons,
Grandin, Vasseur, tous clercs et certains professeurs de théologie, partageront
la même passion pour les annates, histoires, mémoires du pays avec une
forte connotation morale et religieuse.
Le pays, comme les êtres vivants, a, jadis,
commis des fautes et s'obstine dans le pêché. Tout peut être pardonné par une contrition sincère et une vie
d'observance. Ce discours, dans un monde en proie au doute,
ajouté aux précisions dogmatiques du concile va éveiller nombre de vocations
religieuses. Chez nous, le mouvement des oratoriens, avatar moderne de l'ordre
des Prémontrés, appela un jeune natif de Condren, qui portera plus tard ce nom.
Il fut le rédacteur des règles de cet ordre religieux séculier au côté de
Bérulle et de son saint fondateur, Philippe de Néri.Un autre ordre naquit, en ces temps de
gloire, à Reims sous l'impulsion de Saint Jean Baptiste de la Salle. Cette
magnifique institution se retrouve aujourd'hui dans les coins les plus éloignés
de la planète et n'est pas né près de chez nous pour rien. Loin de Paris, en
réaction contre l'élitisme du latin, grec mais au sein de l'Eglise, ses promoteurs comprendront que l'éducation des jeunes est plus sacrée que le
magistère de l'Eglise et que tout n'est pas dans les évangiles.
Saluons, en les croisant, ces véritables
révolutionnaires, qui, depuis 1679, poursuivent, en toute humilité, l'oeuvre la plus importante du monde.
Le projet éducatif plagiait celui des
jésuites et d'autres mais il était né en province et toute la différence était
déjà là.
Paris vivait, en cirant ses pompes et en
écoutant les prédicateurs de carême. Le roi ne convoquait pas le parlement
composé de bouseux alors que tout ce que la France comptait de beaux esprits
vivait quotidiennement à ses côtés. Molière, pour faire vivre sa troupe, fera
s'esclaffer de rire la cour dans M de Pourceaugnac dont la servante parlait
avec l'accent de Saint-Quentin. La précision est de l'auteur même. Son seigneur
et elle dissuadaient du retour ou de l'installation tous ceux qui, déjà,
voulaient quitter cette ville nauséabonde que Boileau osera décrire.Notre région devint la victime du conformisme
et de la centralisation des administrations. Colbert est souvent cité comme
l'initiateur de ce mouvement. Lui qui favorisa l'industrialisation de la vallée
de l'Oise et fit de Saint-Gobain, la première usine chimique s'opposait, au
contraire à cette funeste mode. La société bien pensante, dans son entier,
considérait, elle, cette gabegie comme le nec plus ultra de la raison.
Corneille avait précédé Racine et la société
préfèrait l'homme tel qu'il devait être et non tel qu'il était. L'aspiration
vers l'absolu était à l'ordre du jour dans tous les confessionnals. Le
consensus sur le châtiment va
alimenter, dès lors, de manière exponentielle les galères. Le petit peuple,
coincé entre la carotte et le bâton, subira le sort logique que la morale réserve
aux pauvres dans les sociétés bloquées : toujours moins
"Selon que vous serez grands ou
misérables, les jugements seront blancs ou noirs."
Le condensé schématique de l'état d'esprit
dominant de l'époque présente, comme toutes les simplifications, un risque
d'interprétation. Aussi, dans l'histoire de ce temps, nous relaterons deux
anecdotes venant du plus bas du peuple. L'une et l'autre révèlent les failles
d'une société que nos livres d'histoire ont tendance à glorifier. La mutation professionnelle de la noblesse
vers la capitale ou vers les ordres drainera de régions lointaines, depuis le
début du XVIIème, des enrichis qui
achèteront les terres et parfois les titres. C'est ainsi qu'arriva de
Bouzonville, en haute Lorraine, après les troubles de la fronde, un seigneur
qui prit possession d'un village de chez nous. Il arriva certainement bride
abattue, car le pays était riche en blés, poteries, forges, ateliers de
tissage, bijoux, etc....Les villageois n'avaient pas eu leur mot à dire et bien qu' instruits
des techniques de cultures modernes , imprégnés des idées de la réforme et du
salut individuel, exercés à la confrontation entre les trois religions, ils
avaient été vendus comme des primaires, bons à pressurer. Une animosité
certaine germa, que la structure juridique et même les prêches d'alors ne
pouvaient résoudre. L'oppresseur était juge et partie, se croyant toujours héritier de la haute
justice ; quant aux villageois, sans posséder de pistolet, ils savaient que
chacun avait droit à un brin de justice et le doyen au confessionnal donnait
d'ailleurs facilement l'absolution pour les fautes avouées de glanage illégal,
voire de braconnage.
Quelle faute commit Mme Anne Grégoire, veuve
Carguet ? Insulte, refus de travailler, glanage ? Le délit ne fut rien en
comparaison de l'attitude du nouveau seigneur qui fit piétiner la vieille femme
par son cheval. La population du village, choquée, tenta d'ester en justice. La
plainte fut déclarée recevable mais l'échelon de juridiction susceptible de
traiter d'un cas pareil relevait de la justice royale et l'instruction
promettait d'être longue autant qu'aléatoire. Un des fils d'Anne Grégoire, las
d'attendre, fit justice lui-même. Les habitants furent unanimes à défendre ce
geste et personne ne réclama réparation pour ce vilain personnage, ni le curé,
ni les seigneurs d'alentour.
L'évènement qui s'est passé à Flavy-le-Martel
n'a certainement pas été un cas unique. L'exigence de morale ne s'appliquait
pas équitablement. Le peuple voulait une justice, au vrai sens du terme, qui
défende la veuve et évite à l'orphelin de faire justice lui-même.
Le roi, entouré d'orateurs superbes mais loin
des réalités, entendait tous les jours que les hommes étaient mauvais et que
les institutions étaient bonnes . Le message de notre région n' éclaira pas sa
lanterne . Il n'y aurait rien à regretter si la fin de la monarchie avait apporté plus de justice à tous les
habitants.
Dans ce chapitre critique sur la perversion des bonnes intentions, il manquerait
une note de véracité si ceux, qui réussirent leur vie, étaient oubliés.
Valaincourt , Coliette, tous les historiographes de l'époque méritent notre
admiration. Les chemins du succès social étaient étroits, s'inscrivaient dans
un cursus fléché, avec un degré mesuré d'imagination et d'audace. Une famille
de la région, à l'instar d'autres familles de condition modeste gravira de
nombreuses marches, sans aucune médaille, ni diplôme, ni félicitation des
grands de l'Etat. Un dénommé Vinchon, humble travailleur des champs, négociera
en 1488 avec son seigneur un contrat de location de terres près de Trefcon. Son fils lui succéda et, en se mettant, à
chaque innovation, à la pointe des techniques d'amélioration des rendements,
rachètera sa terre et placera ses enfants selon les mêmes principes. L'
exploitant agricole était né. De Trefcon à Pontruet, Maissemy, Douchy, Jussy,
Vraignes, partout les enfants s'allieront avec d'autres familles qui
n'ambitionnaient ni le ciel, ni le droit de justice, ni des pensions d'ancien
combattant, ni la fonction cléricale. Rien ne fut simple pour ces courageux qui
n'avaient que leurs mains et leur intelligence. Mais, comme la société ne s'intéressait qu'
au ciel, discutait de l'existence de dieu à l'aide de paris pascaliens, ceux
qui retournaient la terre et regardaient le ciel pour son contenu météorologique,
accomplissaient, sans le savoir, la seule mission que Dieu ait effectivement
assigné aux hommes de bonne volonté.
En ce siècle de dévotion, ceux qui priaient
peu, touchaient la prime des ouvriers
de la dernière heure !
Vers 1750, la famille atteindra le seuil
critique qui autorise à avoir des idées sur le gouvernement du pays. Ne
possède-t-elle pas des centaines d'hectares, plusieurs fiefs selon les normes
d'antan ? Son pouvoir se prolonge grâce à des représentants dans le monde, un notaire, un curé, un conseiller
secrétaire du roi et, surtout, elle sera alliée avec toutes les familles qui, alentour, auront suivi, peu ou
prou, le même parcours discret: les Dauthuile, Demarole, Foulquier d'Hérouel, Quéquignon,
Geneste, Duplaquet, Martine, Namuroy, Boudoux d'Hautefeuille, Delignères,
Bénard, Malézieux, Tattegrain, Deguise, Foy.
Au sein des villes, l'esprit d'entreprise
connut une floraison aussi abondante et silencieuse. La manufacture de
Saint-Quentin offrait des matières à de nombreux rouets et métiers artisanaux.
Il fut dénombré 1826 métiers à toile dans l'élection de Saint-Quentin. La
famille Charpentier avait installé un de ses membres à Cadix, marché de
cocagne qui était à l'Europe d'alors ce
que les émirats arabes sont au monde contemporain.

Louis XIII, Louis XIV,
la guerre des Flandres.
Le dernier comte du
Vermandois.
La révocation de l'Edit
de Nantes .
La nouvelle dimension du monde.
Les crinolines pour les femmes et les fraises
pour les hommes estompaient la sensualité des corps et habillaient
lourdement ceux qui se rendaient
régulièrement aux vêpres, matines et confesses ou à l'école du dimanche.
L'ordre moral avait posé une chape de plomb sur la société, empêchant une
expansion désordonnée mais, corrélativement, augmentant la tension des atomes
internes.
Le Vermandois baigna comme les autres régions
dans cette marmite où certains améliorèrent leur ordinaire et d'autres furent
échaudés. Comme depuis le début du monde, les faits et
l'histoire importaient moins que la
perception individuelle mais une sensation nouvelle sourdissait des plaies
encore ouvertes malgré les cataplasmes philosophiques. Est-ce que l'instinct
bestial n'était pas tout aussi sage et social que toutes ces convenances
préfabriquées ?
Le haut de la marmite était occupé par le roi
qui n'aimait guère sa mère et par Richelieu qui sera immortalisé avec une
armure sous l'habit ecclésiastique. La proche parenté avait depuis longtemps
démontré une grande puissance de maléfices à laquelle s'ajoutaient maintenant
des marques de consanguinité. Les protestants et les catholiques vivaient la
détestation au quotidien. La fuite au loin ne devenait pas insensée dans ce
monde trop poli ...
Deux de nos concitoyens participèrent de
manière éminente aux premières découvertes de la petite terre qui venait de
s'ouvrir aux explorateurs. Leurs témoignages, aussi, devraient figurer au
programme de l'enseignement de base des jeunes car, dans le sillon du procès de
Valladolid qui reconnut une âme aux Indiens d'Amérique, ils seront des
défenseurs authentiques de la dimension pluriculturelle de l'humanité.
Trop originaux, ils sont, l'un et l'autre,
inclassables dans des mouvements littéraires ou de pensées et furent
oubliés.
Au Panthéon du Vermandois, ils
méritent place.
Xavier de Charlevoix, né à Saint-Quentin en
1682, fut élève des jésuites et rentra dans cet ordre curieux de tout. Il fit
partie des missionnaires envoyés " au nouveau monde" où il explora
les plaines gigantesques qui vont du Saint-Laurent au Mississipi. Son nom reste attaché à plusieurs villes de ce pays.
Ecrivain, historien, voyageur, ethnologue, il rassemblera ses carnets dans
" Histoire et description générale de la Nouvelle France" .
Chateaubriand, dont le séjour aux Amériques
ne dura que cinq mois et se limita à un voyage de Philadelphie aux chutes du
Niagara, s'inspira complètement de l'ouvrage de Charlevoix pour son Voyage en
Amérique qui déborde complètement cette zone. Mais, très au delà des images colorées,
c'est l'esprit même du livre de Charlevoix qui influencera le plus ce père du
romantisme. Chez un jésuite, tout revient toujours à Dieu, la pureté comme
l'innocence, la beauté comme l' ignorance. Le Génie du Christianisme s'inscrit dans le
fil de la pensée du jésuite voyageur, avec, toutefois, une limite.
Chateaubriand écrit "
Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet
état de vague des passions augmente ; car il arrive alors une chose triste : le
grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude de livres qui
traitent de l'homme et des sentiments rendent habile sans expérience. On est
détrompé sans avoir joui ; il reste encore des désirs, et l'on n'a plus
d'illusions. L'imagination est riche et merveilleuse; l'existence pauvre, sèche
et désenchanté. On habite avec un coeur plein un monde vide, et sans avoir usé
de rien on est désabusé de tout."
L'analyse prodigieusement prémonitoire de la
morosité des sociétés contemporaines n'aurait pas plu à Charlevoix. La
présentation d'un " monde vide " l'eut révolté, tout autant que celle
du " coeur plein". Autorisé à parler avec la voix de Charles le
grand, il aurait rappelé qu'un coeur plein était un coeur qui s'engage et que
le monde loin d'être un néant était notre salut. N'était-il pas prodigieux ?
Charlevoix ne se contenta pas de visiter
l'Amérique du Nord, il ira aussi aux Antilles d'où il tirera la matière d'une
histoire de Saint Domingue, descendra en Amérique du Sud, visiter ses confrères
du Paraguay. Ce sera un tome supplémentaire sur l'histoire du Paraguay.
Traversa-t-il le Pacifique, après le Cap Horn ? En tout cas, il fit le tour du
monde connu, puisqu'il séjourna également au Japon, dont il rédigea l' histoire
à travers les siècles, en magnifiant évidemment l'évangélisation par son Saint
Patron : Xavier.
A côté de ce professionnel du reportage
culturel, jésuite, Bénezet Antoine,
également natif de Saint-Quentin en 1713 , figure dans nos dictionnaires comme
philanthrope américain, singularité ne correspondant à aucune catégorie connue.
Passe encore d'avoir émigré en Amérique à cause de sa religion, mais
philanthrope !
Tout homme raisonnable aujourd'hui se défend
d'agir pour ce motif. "Nous ne sommes pas philanthropes " , nous est
servi dans tous les commerces comme
dans les entreprises et services publics. Bénézet n'aurait pas désavoué cette
classification posthume, qui constitue un suprême éloge pour un être humain,
chassé, contraint à l'exil outre-mer et coupé de ses racines. Car tel fut le
sort de notre concitoyen qui ne voulut pas renier sa foi et partit donc à
Londres puis dans les colonies britanniques d'Amérique. Dans ce territoire
superbe, il adhérera à la secte quaker, proche du mouvement des illuminés dont
la présence fut signalée à Saint-Quentin, qui rassemblait à ses yeux les idéaux de vie du christianisme
authentique, tout en participant totalement à la politique du monde que son
parcours original lui permettait de bien connaître. Avec la bible et une vie de
simplicité, dans un cadre de verdure qui devait lui rappeler souvent sa terre
natale, Antoine Bénézet aurait pu se contenter de la vie de félicité qu'il
avait choisie. Exilé à cause de sa foi, il est un homme libre, parfaitement
capable d'être riche parmi les riches et humble parmi les siens et souffre de
voir que certains cherchent la fortune sur le dos d'esclaves.
Ceux-là, aussi, sont partis loin de chez eux,
sans défense. L'attitude des pasteurs des églises anglicanes et
luthériennes le révolte plus que tout,
lui dont l'éducation a été marquée par l'institution chrétienne calviniste. Il
confirmera donc son engagement à la doctrine quaker et fort de ses atouts
personnels prendra la défense d'une cause perdue d'avance : celle des noirs en
Amérique . Il écrivit une "
Relation historique de
la Guinée " qui devait être au peuple noir un mémorial de sa culture et le
fondement de sa dignité. Fils de chez nous, Bénézet ressentait ce devoir de
mémoire qui donnait un sens à son exil en le rendant supportable et souffrait
de voir les noirs dépourvus de ce minimum de bagages qui, où que vous soyez,
explique votre identité.
A côté de ce livre destiné aux noirs
déboussolés et asservis afin qu'ils retrouvent une partie de leur âme, Bénézet
traça, dans un but purement politique,le "
tableau de l'état
misérable des nègres esclaves ".
Le premier ouvrage était d'essence
philanthropique, pas le second !
Destiné aux bien-pensants des églises
reconnues avec l'aide des moyens de la secte, l'ouvrage eut un grand
retentissement. Lincoln comme une majorité d'Américains en connaissait l'existence
et notre concitoyen figure ainsi comme un humble inspirateur de l'abolition de
l'esclavage aux Etats-Unis.
La Guinée de Bénézet, ne l'oublions pas, se
trouvait chez nous. Il rêvait d'entendre les chants, les rires, les sons, les
odeurs de son pays, tout en acceptant la résignation de n'y retourner jamais.
On quitte sa mère, on l'aime encore plus ! et rien ne paraît plus intolérable
que l' interdiction de le dire et de l'expliquer.
Ces deux voyageurs naviguèrent à travers le
monde avec une sensibilité historique et culturelle qui devait beaucoup à leurs
origines picardes, toute à l'opposé de celle de Chateaubriand. Le monde n'est
pas vide, non seulement il est beau mais il a une histoire et les coeurs pleins
n'appartiennent pas aux rêveurs mais aux âmes engagées !
Si la
Picardie ne fut pas, le regretterons-nous, une des terres d'élection du romantisme, elle verra naître chez elle, le
roman historique, plus tard, certes. Comme, chaque fois qu'une affaire importante
est dévoilée par la presse, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts, il nous
faut introduire ici Alexandre Dumas qui jettera, avec un siècle de recul, un
regard très éclairant sur les
"affaires" de l'histoire de France .
Comme les "riches heures" avaient
enjolivé le souvenir des XIème et XIIème siècles, les romans de cape et d'épée
d'Alexandre Dumas, écrits au XIXème siècle, vont farder des réalités des règnes
des quatre Louis mais aussi en révéler d'autres.
Dans les romans d' Alexandre Dumas, ce sont
les seconds rôles qui ont une présence. La reine, le roi, le cardinal, sont des
personnages tragiques, sans état d'âme.
Chez les grands, peu sont nobles et généreux, l'attitude commune est d'agir en
partisan, de défendre sa caste et son rang avec sérieux et gravité. Tout le
romanesque vient de ce que ce monde étrange est visité par des humains qui
connaissent la fatigue, le doute, la camaraderie et le sens de l'humour. Autour
des grands, apparaissent des personnages mystérieux qui accentuent le côté
passionnel de cet univers, les espionnes, les courtisanes, les cadets de
Gascogne. Dans le rétroviseur apparaissent des visages aux regards hébétés de
bêtes perdues, le monde du Roi-Soleil cachait derrière les ors et les velours
cramoisis des ombres : le "Comte de Monte Christo" au château d'If,
le "Vicomte de Bragelonne" et le "Masque de Fer ".
Alexandre Dumas, né à Villers Cotterets au
milieu de ce paysage de châteaux, encore debout, certains inachevés, et à
l'époque où les récits troublants occupaient encore nombre de soirées à la
chandelle, n'aura pas le temps de fréquenter l'école jusqu' au stade où
celle-ci étouffe définitivement l'imagination. Aussi, à quinze ans, il suit les
conseils du Général Foy de Ham, compagnon d'arme de son père et rentre au
secrétariat d'un de ces Grands , le Duc d'Orléans. La rigidité de cours royales
d'avant la Révolution s'étant relâchée, le fougueux jeune homme lancera un concept nouveau, sorte de relecture
de l'histoire, privilégiant l'image et les sentiments. Parmi ses sujets d'intérêt, un nous est particulièrement
cher :
le masque de fer.
L'évocation de de cette énigme n'apparaît pas
dans ce livre sans cause, car si très rares sont les mentions de ce personnage
chez les historiens du XVII ème siècle, le masque de fer a réellement existé et
derrière lui était soustrait du monde le Comte du Vermandois !
Cette hypothèse, en dépit de la note
romanesque apportée par Alexandre Dumas, est de toutes la plus vraisemblable.
Le titre a, c'est une certitude, été donné à un enfant qui ne pouvait qu'être
de sang royal et pourtant jamais le comte n'a été vu.
Que fallait-il cacher derrière ce masque ?
Une des réponses se déduit de la mentalité
dominante de l'époque. La société était bâtie sur des interdits que les
confesseurs ressassaient invariablement. Ce que les curés vouaient à la
géhenne, les évêques ne pouvaient l'interdire aux grands qui sont aussi
faillibles que les autres. Il était de l'ordre moral supérieur que le péché
absolu soit caché. Un péché absolu, c'est l'équation du péché mortel pour tous
et pardonné à celui qui l'a commis. Sans doute, l'enfant était le portrait du
péché, bâtard ressemblant trop à son père ? vérolé purulent ? , et mettait en péril la monarchie absolue en
portant affront à la chrétienté.
Ce paradoxe du péché absolu qui est abordé
ici, par un détour auprès du roman historique, renvoie aux reflexions des plus
grands philosophes de cette époque : Kant, Pascal, Descartes, Hegel, Rousseau,
Voltaire, et plus tard Nietszsche, tous chercheront l'absolu dans l'homme,
voire l'absolu sans l'homme, au delà du bien et du mal.>Des élucubrations d'état major, des
aspirations d'absolu et d'autres balivernes de curés vouèrent le dernier comte
du Vermandois à un exil intérieur innommable!
Condorcet aborda de manière forte la critique
de la morale absurde qui condamna le comte du Vermandois :
" on y apprend aux enfants qu'on ne peut faire de bonnes actions
sans grâce et qu'il y a deux sortes de crimes : l'un véniel, pour lequel on est
brûlé pendant quelques siècles, l'autre mortel, pour lequel on est brûlé
éternellement ".
Au delà de la morale et de la fiction, le
dernier Comte du Vermandois, dont l'existence alimente encore rumeurs et interrogations, a sa trace dans
les registres officiels. Fils naturel de Louis XIV et de Mme de la Vallière, il est né en 1667 à Paris,
légitimé en 1669. Cette même année, il reçut le titre de grand Amiral de
France. Il est officiellement décédé en 1683. Sa mère, évincée par Mme de
Montespan, se retira chez les Carmélites en 1674 sous le nom de Louise de la
Miséricorde.Le Masque de fer fut enfermé à la prison de
Pignerol , puis aux îles Saintes Marguerite en 1686, puis à la Bastille où il
mourrut en 1703. L'autre hypothèse fait du Masque de fer, un
fils d'Anne d'Autriche et de Buckingham, frère adultérin de Louis XIV .Aucun ragot n' avait rapporté de grossesse
royale alors que le Comte du Vermandois, lui, est bien né. L'exil forcé de sa
mère et la date de la disparition de Comte, correspondant au premier
emprisonnement du Masque, ouvrent des
pistes, en effet, troublantes.
Les décennies qui précédèrent la révolution
furent des années inquiètes. Le trouble des esprits avait de multiples origines que la venue des rois ne suffisait
pas à calmer. Louis XIV passa dans la région sept fois sur le chemin des
Flandres. C' était devenu une escale ordinaire, où le roi et la cour pouvaient
souffler un peu. Les largesses ne s'enregistraient plus dans des chartes avec
assurance de fidélité et de dévouement. Les seules libéralités allaient aux bâtiments
d'Eglise. Bien que la ville vît passer d'Artagnan et des troupes royales en
tenues brodées d'or, le poids de l'administration , le lest des actes de
contrition, et la perte des dynamiques huguenots, avaient grevé la confiance,
et le moral n'était plus vraiment là. La conquête des Flandres, puis de la Franche
Comté et de Strasbourg, justifiait, aux
yeux du roi, toutes les ponctions.
Après ces annexions, un répit aurait pu être accordé aux provinces
contributrices. Les fortifications de Vauban, les fêtes de Versailles, remplaceront
les chapitres de dépenses et éviteront aux fermiers généraux la crainte de
relâcher la pression des griffes fiscales règlées avec minutie depuis les
Romains.



Le Nain, De la Tour, Crozat, Parmentier, Law, Benoît Labre
La destinée maudite du dernier comte du
Vermandois rélégua le pays au rang des provinces confiées aux pique- assiettes.
Louis XIV traversa la région par obligation. Louis XV lui ne parut même pas
dans sa bonne ville. Un fonctionnaire zélé osera même mettre à mal la charte
accordée à la ville de Saint-Quentin par Philippe Auguste et ses ajouts
postérieurs. Il faudra un procès devant le parlement pour que l'engagement
royal soit maintenu. Soutenu par l'avocat Hordret, l'affaire portait en pleine lumière le fossé qui se creusait
entre le peuple et son gouvernement. Les fissures furent nombreuses mais rien
ne laissait présager un divorce pas même une séparation, ce n'étaient encore
que quelques volées d'assiettes sur les têtes de subalternes obséquieux . La France d'alors regorgeait d'or et en
éclaboussait le monde. Aucune monarchie au monde ne pouvait prétendre l'égaler.
Et pourtant, quand les opportunités d'investissement sont verrouillées par la
rigidité des fonctions, l'or est tout le contraire de la richesse. Déjà vers 1672, le chantier titanesque du
percement du canal entre les deux mers,
dit du Languedoc, avait failli capoter sous l'impécuniosité de l'Etat. Pour
l'achever, l'Etat concédera à un audacieux ingénieur, Pierre-Paul Riquet, le
canal en fief perpétuel avec droit d'y bâtir des moulins et des magasins.
La réussite, in extremis, de ce projet
suscita des idées, voire aiguilla des initiatives. Les rivières avaient été depuis la nuit des
temps les sources de richesse de notre région et les voies drainant toutes les
activités mais les passages d'une vallée à l'autre demeuraient des murailles
autrement plus infranchissables que le
" pas de la case " au milieu des plaines occitanes .
Un premier projet vit le jour dans la tête
d'un audacieux. Il s'appelait Caignart de Marcy et obtint, à l'instar de
Riquet, la concession d'un canal par le plus court chemin entre Saint-Quentin
et l'Oise via Sissy et Homblières. C'était le plus fort rapport
de dénivellation au kilomètre et, en ces>mois de année 1724, si l'or abondait, le crédit était mort, tué
en 1718 par la faillite de la banque Law.
La société française d'alors, par le fait de
générations de notaires, croulait sous les actes et quittances mais ne fréquentait
pas les guichets de banque. Il fallut l'appui d'un des fils de Louis XIV, le
prince d'Orléans, qui avait passé plusieurs années en Angleterre, pour que Law
obtienne l'agrément d'exercer son commerce à Paris.
La banque commença dans l'allégresse de promesses
raisonnables : Riquet était un gros déposant et l'armement des bateaux pour les
Indes semblait une opportunité excellente en matière de crédit. Pourtant le
financement devait accompagner, sur des durées de plus de six mois, sans aucun
espoir de rentrée financière, des opérations à haut risque. Outre ce domaine
d'activité, seules la construction et l'agriculture offraient des sorties assez
sûres. Nombreux furent donc les agriculteurs et notamment chez nos concitoyens
qui osèrent utiliser le crédit pour acheter des terres ou monter des bâtiments.
L'épopée commencée en fanfare se termina vite en déconfiture. Qui colporta les rumeurs que le papier remis
par la banque ne valait rien, que tel navire avait été piraté, que la lettre de
change de Pondichéry était creuse ?
La panique fit courir dans la rue Quincampoix
et chacun demanda la restitution de l'or que, seul, les notaires acceptaient.
Les moins dupes furent les agriculteurs et un nombre limité d'investisseurs.
Cette déroute eut pour conséquence d'accentuer fortement la méfiance des
Français pour le papier monnaie et les banques. L'industrie naissante fut, dès
le départ, rangée sur l'étagère des farces et attrapes et les Saint-Simoniens,
qui, plus tard, réfléchiront sur les moyens du progrès économique,
n'envisageront pas un instant le recours dynamique au crédit. Caignart de Marcy chercha partout des aides,
en vain. Dans ce monde, où l'entrepreneur ne pouvait compter que sur son
étoile, un certain Crozat reprit l'idée à son compte et réalisa son rêve. A ce
titre, bien que venu de loin, il fut le visionnaire et le bienfaiteur de notre
région. Il fera rentrer le Vermandois dans l'ère industrielle avec un demi
siècle d'avance et l' installera solidement dans son rôle de place tournante
pour le transport fluvial européen. Le canal est, autant que son créateur, un
personnage important de notre pièce. sa carrière semble terminée et il est
relégué aux rôles muets et à la distraction des pêcheurs à la ligne du dimanche
mais il fut longtemps un jeune premier, fier de saluer Saint-Simon et de relier
le Nord et la capitale. Il eut une descendance dans les canaux de
Suez et de Panama. Son héritage éveillera jalousie et intérêt de la part de
prédateurs armés venus du nord. Le cheminement qui amena Crozat à s'intéresser
au projet du canal relate toutes les étapes nécessaires à l'accomplissement
d'une idée. Crozat, natif de Toulouse, partit très jeune vers les terres
vierges de Louisiane où il obtiendra le monopole du commerce des grains. Il en
retirera des pécunes mais aussi des constatations : les blés de France sont
incomparables, le canal du midi, au lieu de ramener les grains vers Bordeaux,
les aspire vers Marseille. Comment s'assurer des approvisionnements réguliers
en céréales, blé pour les pains, orge pour la bière, avoine pour les chevaux et
les petits déjeuners des immigrants ? Un canal entre l'Oise et l ' Escaut, ce
serait l'assurance de prendre pied dans le grenier à blé du monde et de pouvoir
l'acheminer à moindre coût. Crozat fit donc construire le Canal de Chauny à
Saint-Quentin à ses frais. Ce premier tronçon de 41 Km fut réalisé en six
années et inauguré en 1738. Antoine Crozat décéda malheureusement peu après.
Son frère, peu soutenu à la cour, ne poursuivit pas l'aventure. Une certaine
Mme de Pompadour y faisait régner l'ordre tacite implacable d'écarter tous les projets des farfelus de l'industrie
pour ne donner agrément qu'aux projets de l'immobilier de standing. Les grands
directeurs des banques parisiennes , sous la férule de la direction du trésor,
sont aujourd'hui encore les émules fidèles de cette " autorité ".
Le frère de Crozat ne séjourna pas le long
des rives du nouveau canal et ne s'intéressa pas à la continuation des travaux.
Sa passion pour la peinture le rend cependant très révélateur de son temps. Il
misa non sur le blé mais sur des peintres. Il contribua à faire éclore le
talent de Watteau, Van Loo, Coypel, Subleyras et toute cette école de finesse
du XVIIIème siècle qui accéda à la notoriété loin des cénacles parisiens.
L'évocation de l'apogée de la peinture et le
rôle des mécènes provinciaux introduit la gloire du plus éminent fils de
Saint-Quentin. La famille Le Nain, de Laon, avait déjà donné la mesure du
talent de peintres du terroir. Comme les Hollandais, ils s'attacheront à croquer
des personnes ordinaires dans leurs attitudes et leurs gestes quotidiens. La
noblesse des êtres déjà se situe au delà de l'académisme et le peintre
s'affranchit des obligations des allégories de " bon ton ". Ni mouche,
ni sablier, ni tête de mort, ni fleur fanée, ni fille sage tenant une lampe
allumée, le paysan est au milieu de sa famille dans le clair obscur de la
chaumière et le pain est tranché à bras le corps. Les Le Nain étaient des
grands révolutionnaires.
Quentin la Tour n'aura plus à tenter ce que
ses voisins avaient osé . Son environnement, à trois tiers de siècle de
distance, n'est pas comparable. C'est un citadin d'une ville prodigieuse
entourée d'une campagne moderne. Surtout il est le témoin des progrès de
l'industrie textile et des colorants. Sans ce cadre, Quentin n'aurait pas
atteint cette notoriété mondiale.Comme tous les peintres, il commence ses
toiles en griffonnant au crayon de carbone, les principaux traits de l'oeuvre.
Ces lignes sommaires portent toute l'ossature et parfois tout le génie de
l'oeuvre accomplie. Le " sacré coup de crayon " deviendra plus tard
l'expression la plus résumée de la valeur ajoutée. Daumier, Walt Disney, tous
les auteurs de BD, tous les cartoonists deviendront riches à partir de rien.Pas
tout à fait, et le Vermandois apportera aussi, dans ce domaine, sa
contribution.Le pastel poussait en abondance dans la région pour fournir les
teintureries en couleur bleutée. Lors de sa transformation, le pastel est
réduit en pâte puis en poudre et peut ainsi être incorporé dans les bains colorants. Il devait être,
depuis longtemps, utilisé comme crayon pour dessiner les contours des toiles de
lin à découper avant que de figurer sur la palette de l'artiste pour ses
ébauches.
Dans peu de livres érudits, l'invention du crayon
de couleur trouve grâce. Ce fut pourtant, avant la télévision en couleur, une
des innovations les plus importantes de l'humanité. Le regard émerveillé des
enfants ouvrant une boîte de crayons Caran d'Ache, nous le rappelle utilement. Les premiers crayons de couleur
transportables et immédiatement utilisables métamorphoseront la peinture .
Quentin la Tour comprendra vite l'avantage du trait apparent et fera éclater
l'art du portrait. Le visage sur la toile sans relief et sans vie passera, dès
lors, pour démodé et il faudra attendre
les impressionnistes pour que la force du " coup de pinceau" rivalisât, à nouveau, avec le coup de crayon. Ainsi les peintures de
Quentin la Tour connurent un long purgatoire après une vogue inégalable. Notre
concitoyen était tellemnt prisé par la cour de France qu'il en connaissait, par
le menu, toutes les têtes, de Mme de Pompadour, au roi, de la dauphine au Comte
de Provence , etc....... Il pouvait se glorifier d'être le seul personnage du
pays qui pouvait faire attendre le roi et la reine et imposer le silence à tous
les grands. Bien qu'intime de la plus haute noblesse, Quentin resta un homme
simple qui n'oublia jamais que son père fut arpenteur en Vermandois et que son
grand père participa à la restauration du gros clocher de la collégiale. Il avait un appartement au Louvre et
honorait cependant de son amitié les encyclopédistes, d'Alembert, Rousseau,
Voltaire. Il affichera cette superbe indépendance
d'esprit en maintes occasions . Peintre de la reine, des dauphines , de
l'infante d'Espagne, il se fit longtemps prier avant d'accepter le portrait de
la favorite du roi, la fameuse Mme de la Pompadour. Ne l'aimant guère, il
demanda quarante-huit mille livres pour le travail, et trouva diverses excuses
pour retarder sa venue en ville. Finalement, il vint à Versailles où, logeant à
l'entresol, il eut le loisir de croiser ses vrais amis de l'Encyclopédie. On
rapporte qu'il avait exigé qu'aucun importun n'assistât aux séances. C'était
l'argument pour travailler à l'aise sans perruque ni escarpins. Voilà que le
roi pénètre, tout sucre et tout miel, dans la pièce transformée en atelier. La
Tour salue et se retire en déclarant qu'il travaillerait lorsque madame serait
seule !
Une autre anecdote est rapporté par le
chevalier d'Estrées. Le peintre travaille sur le portrait d'un des grands du
système : M de la Reynière n'est-il pas fermier général !
Trouvant les séances longues, il envoie son
domestique pour prévenir qu'il n'est pas libre pour l'heure fixée
"
Ton maître est un sot que je n'aurais
pas dû peindre. Assieds-toi là, ta figure me plaît, je vais te peindre",
dit-il au jeune homme.
-Mais, Monsieur, si je tarde à rendre réponse
à M de la Reynière, on me mettra à la porte.
-Bah, je te replacerai."
Ce que fit effectivement Quentin de La Tour.
Pour se permettre une telle audace, il
fallait plus que du talent. Quentin n'était pas qu'un portraitiste plus doué
que les autres, il portait témoignage pour le créateur..." Tous ces portraits de femmes peints,
par La Tour, ne sont pas seulement vivants ; ils ont un charme particulier, ils
sont souriants, et c'est ce sourire qui leur communique la majeure partie de
leur vie.
A cette galerie de révolutionnaires
pacifistes, ajoutons deux proches cousins :Parmentier, natif de Mondidier, dont la
contribution à notre région et aux Belges est bien connue et Saint Benoît Labre.
Ce saint exprime parfaitement les blocages de
la société du siècle des lumières. Né en Artois, province cossue mais quelque
peu suspecte pour l'intelligentsia parisienne, il est pauvre mais a la foi et
veut servir Dieu. Il ira , avec son chien, jusqu'à Rome pour demander l'accès à
la prêtrise. Même la première marche lui sera refusée, les pauvres pouvaient
être envoyés aux colonies par simple bon vouloir de l'administration, les
valets ne pouvaient pas quitter leur maître. Benoit devint clochard prêchant,
proclamant toujours et partout la gloire de Dieu.Louis XVI avait la passion des serrures,
Louis XIV celui de sa gloire, Louis XV celle du despotisme éclairé. Comme Condorcet
dira de la Pompadour et des grands " Je les salue de loin, je les respecte
comme je dois et je les estime comme je peux ", Benoit ne reçut aucune
aide et aucun soutien, il faisait partie du quart-monde du clergé, bien au
dessous du seuil du salut. La chrétienté l'honore comme saint patron des
réfugiés et des immigrés, après avoir reconnu la validité de son message.
C'était la propre voix du comte du
Vermandois osant dire à tous que
l'évangile ne prêchait pas l'exclusion ni l'avilissement. Les inamovibles favorisés du système, bardés
de convictions, n'entendirent rien. Contraints bientôt à partir, ils eurent
loisir de prier ce saint, qu'ils n'avaient pas voulu écouter.

Encore un bout de Canal.
Les francs maçons.
Young .
L'affaire du blé.
Les Cahiers des doléances.
Condorcet.
Les révolutionnaires
picards
Les signes prémonitoires d'un bouleversement
à venir n'avaient pas manqué sur la route bien que l'apparence d'un monde sans
problème prévalût partout. Le canal de Croizat fut poursuivi vers Ham et
Péronne pour rendre navigable la haute partie de la Somme. La tâche ne fut pas
très ardue bien que, là aussi, la géographie des villages fut altérée en
profondeur. Ham et Péronne perdirent plusieurs zones marécageuses qui faisaient
partie de leurs défenses naturelles ainsi que de leur cadre de vie. En ces
dernières années de l'ancien régime, un anglais du nom de Young traversa notre
contrée. Il rassembla ses observations dans son livre
"
Travels in France ". Comme son ancêtre qui était venu mesurer les
murailles de Saint Quentin avant la canonnade, il avait l'oeil de l'espion,
intéressé de découvrir toutes les méthodes culturales qui pouvaient améliorer
la productivité des terres anglaises. Notre région le passionna et il la
célébra comme la terre la plus fertile au monde. Son analyse ne se limita pas à
cet aspect superficiel des choses. Il recensa qu'une ferme de 800 setiers
demandait 35 chevaux alors que celle d' une superficie de moitié inférieure en
exigeait vingt. Chacun le savait chez nous mais l'anglais repartait avec une
donnée économique de première importance pour son pays où la campagne était
ouverte. Le régime juridique des exploitations agricoles tient aussi une place
importante dans son récit de voyage. Alors que le français ne voit que les
devoirs et les charges, l'anglais mesure les droits. Il effectue un savant
calcul pour mesurer le poids des fermages chez nous et dans son pays,
comparaison évidemment accablante pour nos paysans. Il scrute aussi la défense
juridique des fermiers. Partout, les propriétaires ont le droit pour eux et
surtout, les nouveaux arrivants peuvent spolier les anciens
outrageusement. Young notera cependant
que, dans le Vermandois, la coutume du "
mauvais gré" donnait à la
communauté des paysans un droit de rejet des étrangers, qui avaient surenchéri,
par l'intimidation, la quarantaine voire la vengeance collective. Cette coutume
constituait le ciment des familles qui, par le seul mérite de leur travail,
entretenaient le pays mais faisait l'objet de furieux et nombreux procès. En
1787, l'assemblée provinciale picarde mettra ces causes de litiges en tête du
travail législatif qu'elle devait entreprendre.
Hélas, le temps ne lui laissa aucun délai !
Young, libéral convaincu en matière économique, ne trouvera pas de
contradiction dans cette réaction corporatiste, il la soutiendra même. Il
comprendra vite que l' agriculture était une vache à lait pour une classe oisive qui, chez nous,
ne payait pas ses travailleurs au juste prix. Tout l'appareil judiciaire contribuait
à la pérennité du servage. Déjà en
1707, un arrêté avait condamné les occupants qui jouissaient sans baux des
terres, "
les cédent et disposent sans la participation des propriétaires".
Où était le mal puisque les fermages et les corvées étaient honorés ?
La question reste posée car le texte, modifié
mille fois dans sa forme, régit toujours les rapports des propriétaires et des
fermiers d'aujourd'hui. Young, lui, ne comprenait simplement pas cette hérésie
juridique qui fausse la notion même du contrat.
Là, où le marché libre réglait naturellement les déséquilibres,
fallait-il un arrêté, ayant force de loi, qui accordât, à une seule partie,
l'avantage d'une action faite dans l'intérêt de l'ensemble des contractants ?
- of course, no !
Young raisonnait comme un extra-terrestre.
Pour lui, les blés pouvaient circuler librement et franchir les océans.
Croizat, le savait aussi, mais dut payer de sa poche son affranchissement de
règlementations tatillonnes qui tyrannisaient, rançonnaient et affamaient.
La France, terre d'élection de la culture des
céréales, était sous la coupe d'une caste inféodée à la haute noblesse et
proche des clochers qui pouvait seule stocker et négocier. Son intérêt
dépassait toute notion d'intérêt public. Les pauvres, s'ils n'ont plus moyen de
payer leur pain, qu'ils partent aux colonies !
Nombreux sont ceux qui soutiennent que la
Révolution fut une des plus grandes occasions manquées de l'histoire. Révolte
issue d'une manif de boulevards, les organes d'information du temps se
trompèrent sur le sens des banderoles et l'erreur d'interprétation mit le monde
cul par dessus tête.
Le surenchérissement conjoncturel du blé
consécutif au rejet par Necker,
banquier, des décisions de libéralisation du commerce du blé suggérées par
Turgot à la suite d'affirmations fallacieuses sur le mauvais rendement des récoltes, donna libre cours à une folle
spéculation. Sur notre terroir, le blé n'a jamais vraiment
manqué et pourtant la goutte fit déborder le vase. Le motif de la révolte
cachait une forêt de doléances que Turgot avait déjà pressenties. Il sera
l'inspirateur de la renaissance des
parlements provinciaux et fut, de ce fait, l'objet d'une cabale qui prétendit que ces convocations étaient
destinées à museler les voix d'opposition qui s'élèveraient. En Picardie, la
convocation du parlement n'eut lieu qu'en 1787, restaurant un pouvoir
législatif souverain né sous la ligue et oublié depuis lors. Le remplacement de
Turgot, qui fut un ami très cher de Condorcet, par Necker est souvent attribué
aux intrigues de l'"Autrichienne", Marie Antoinette sur son faible
mari. Turgot se déclarait agnostique et proche de la pensée franc-maçonne qui
avait planté des loges à Saint Quentin comme ailleurs. La reine eut un haut le
coeur, directement provoqué par son confesseur qui tenait son jugement du confesseur de son confesseur. Bien que
genevois, Necker, représentait un moindre mal et fut choisi, puis révoqué sitôt
mesurée la profondeur du trou . Le peuple, non consulté, voulait simplement
manifester son désaccord : pas de revendication statutaire, ni d'augmentation
de salaires, ni plus d'emploi, pas même moins de corruption, le peuple défila
pour du pain plus abondant et moins cher, alors que, tout le monde le savait,
les greniers étaient pleins.
Dans le chapitre, que quelques femmes de
Paris vont ouvrir, notre région apporta une contribution essentielle : un grand
nombre des personnages importants de la période sont issus de notre sol.
Rien d'étonnant à cela, l'évolution du monde
n'était pas passée à l'écart ! Maintenus longtemps dans ce que Condorcet
appelera l' état naturel du chrétien, c'est à dire " humiliation et
opprobre", les plus humbles des habitants savaient par atavisme, ou intuition
ou comme une leçon venue du fond des âges, depuis Jules César à tout le moins,
que le fond des pensées n'appartient qu'au sol muet qui nous supporte; à ce
"genius loci", refuge de la dignité, où confesseurs et moralistes
sont interdits de séjour. Le jour où, pour la première fois, les
citoyens furent invités à parler sans contrainte à la seule condition de savoir
écrire, un monde inédit fit surface.
Les
cahiers des doléances seront le résultat
de cette consultation d'un genre nouveau. Ils devaient servir de prologue à la
"
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" et constituer un
document écrit aussi important que le Coran et la Bible et ont pratiquement
disparu de la conscience de nos concitoyens. Il s'agit pourtant du plus beau
devoir de classe et l'un des plus révélateurs de ce que nos ancêtres de 4 à 5
générations pensaient pour eux et rêvaient pour nous. Chaque mairie devrait maintenir affichées les
quelques pages cosignées qui, encore à ce jour, matérialisent l'exemplaire unique d'une consultation
populaire libre dans notre pays. Un inventaire exhaustif même, à l'échelle
réduite de notre contrée, serait une entreprise monumentale. Chaque communauté,
consciente des aspects multiples des problèmes de la société, ne manqua pas
l'occasion qui s'offrait d'évoquer les aspects généraux en termes souvent
convenus et d'insister sur les cas pratiques, souvent chargés de contentieux
millénaires et incompréhensibles pour
l'étranger.
Des appréciations synthétiques peuvent être
tracées, bien que la lecture d'un seul de ces documents vaille mieux que tous
les triturages.
La première des constatations rejoint ce que
Condorcet disait des habitants de Ribemont avec lesquels il usa ses culottes
courtes. Ces 2015 âmes regroupés en 387
feux :
" sont passablement polis en leurs moeurs et en leur parler...., ils
ont l'esprit subtil....., mais un peu lents au travail, ayant trop d'attache à
la recherche des menus plaisirs, et amis de leur liberté".
Ces termes simples et affectueux condensent
mille caractéristiques du cahier des doléances :
- même dans le plus petit village, des idées
politiques sont exprimées, des références aux lois, à la religion, aux usages
habilement utilisées, les pratiques perverses du commerce fustigées,
- le respect n'empêche pas des propos fermes,
- les avantages acquis, même les plus
infimes, sont reproduits, comme par crainte d'une possible disparition
- les corvées, les impôts, toutes les
obligations de travailler pour autrui rassemblent aisément une unanimité
d'opposition et de protestation.
- l'église figure dans chacun des cahiers,
avec des différences de tonalité extraordinaire d'un village à l'autre : de
l'admonestation solennelle, à l'aveu qu'aucun différend n'entache les liens du
pays avec le clergé, à la mise en garde contre l'hypocrisie voire l'abus et
l'escroquerie.
Les citoyens d'Happencourt proclameront:
"S' il y a des abus à réformer dans le clergé, comme cela
peut être, nous ne les connaissons pas "
là où ceux d'Hargicourt demanderont que:
" les biens du haut clergé soient réunis aux domaines du Roi.
Que les curés de campagne soient fixés à une somme de 1500 £, pour
portion congrue"
Ceux de Flavy écriront:
" L'Eglise est assez riche pour faire un sort à Messieurs les Curés
en raison de leur profession, et pour les mettre à même de ne plus percevoir de Casuel, cette vénalité de
secours de l'Eglise s'accorde bien peu avec la sainteté de la religion qu'elle
nous enseigne."
Intéressante est la position des Homblierois
dont l'abbaye rythmait toute la commune
" Que tous les sacrements soient donnés gratis par Messieurs les
curés "
" Depuis 7 ans, une partie du clergé et d'autres se sont avisés,
pour leur plus grand bien et avantage, de mettre sur leurs baux la redevance en bled à
prix " Les receveurs de Mrs les Abbés ruinent en bonne partie tous les
fermiers..... la raison en est que, passant leurs baux à Paris où il n'y a pas de
contrôle, on ne peut pas en avoir connaissance"
Contre l'insécurité financière, qui devait
être un fléau dans nos villages reculés mais riches pour l'époque, plusieurs
solutions sont avancées:
" Que les Banqueroutiers frauduleux
soient flétris au front des lettres B.F. Que les faillis soient jugés indignes
de faire de nouvelles affaires " (Hargicourt)
"Défendre les lieux privilégiés aux
banqueroutes ou les expulser après trois mois, ou faire justice, et que les
frais n'enlèvent pas tout et ne perdent pas les créanciers de leur dû.
L'iniquité et l'énormité des frais de poursuite portent les créanciers à des
arrangements des plus onéreux qui portent un tort notable aux
manufacturiers."
Plus loin, dans le cahier de Flavy-le-Martel:
"Mettre ordre au grand nombre de portes bales qui roulent
dans les campagnes, enlèvent l'argent de ceux qui achèteront les effets notés
et donnent lieu au désordre "
Ces portes bales qui achètent les effets ont
disparu du paysage mais l'expression t'as pas dix balles perpétue le souvenir
de cette activité de prêt à tout bout de champ particulièrement dévastatrice.
La compilation des revendications en matière
fiscale sous les multiples formes qui s'étaient développées au cours des
siècles ne présente que peu d'intérêt car le rejet de ce type de charges
atteint l'unanimité sans exception.La lourdeur est décriée plusieurs fois dans
chaque texte, mais l'affirmation de l'inégalité devant l'impôt rebute, semble
faire hésiter plus d'un.
Certains oseront et il faut citer comme un
monument de notre histoire le cahier de doléances d'Hérouèl, aujourd'hui
Foreste, qui porte une signature célèbre et résume, parfaitement la situation économique du pays, un peu à la
manière de nos experts contemporains.
" Le Tiers Etat du département de Saint Quentin paye de
taille, impositions accessoires, capitation, droit d'usage...
: 182.727 Livres 4 sols et 2 deniers
effectuent corvées
: 30 376 14 2
-----------------------------------------------------------------------
total : 212.636 19 4
La noblesse ne paye que la capitation pour quoique nous ayons des nobles très riches
dans ce département .Le tiers état paye tous les impôts et toutes
les charges de la province, tels que les gages de la maréchaussée, les
appartements des gouverneurs, commandant, intendant, l'adjoint :
Logement : 10000
Frais et bureau : 21000 "
Après cette introduction chiffrée au denier près, les requêtes s'alignent simples
et précises:
. Que la province de Picardie soit créee en état provincial
de la même manière qu'était l'assemblée provinciale,
Qu'elle soit chargée de la répartition de l'impôt,
Que les privilèges pécuniaires de
tous les états soient supprimés
Que la totalité des domaines des ordres du clergé et de la noblesse
soit imposée comme celui du tiers état, sans nulle exception,
Que la portion congrue du clergé soit augmentée,
Abolition de la vénalité des charges.....
Réunion des tribunaux dans les villes...
Au pied de la dernière page figure la
signature ample du citoyen
Fouquier-Tinville parmi quelques autres. Celui qui
deviendra l' accusateur public et organisera la terreur se présente, dans cet
écrit, dont on ne peut douter un instant qu'il en ait été le principal
inspirateur voire le rédacteur, comme bien raisonnable: régionaliste modéré souhaitant une assemblée identique à celle apparue
sous la ligue, défenseur du bas clergé de campagne, ne souhaitant nullement la disparition des trois états.
Le destin de Fouquier Tinville, entre le
cahier des doléances de 89 et sa mort sur la guillotine en 93, suit le
cheminement d'une folie collective inconnue jusqu'alors dans l'histoire.Les guerres multiples de l'ancien régime
trouvaient dans des chartes et traités des motifs légitimes de combats et de destructions. Dans la
Révolution Française, les cahiers des doléances prendront, pour le peuple, la
place des traités bafoués. Le prix du blé figure peu dans les textes, le
bouleversement de la société non plus, il n'était souhaité que des réformes
mineures, oui mais signées par des assemblées de citoyens au nom du peuple
français. Seule l'importance de la chose écrite fondera et justifiera, par la
suite, le reproche d'incapacité d'engager la moindre réforme que feront nos
concitoyens unanimes.
De ce constat naîtra la révolte !
A l'appel au soulèvement, notre région
apporta une des troupes les plus importantes du royaume finissant.
Condorcet, né à Ribemont, occupe la place du
prophète annonciateur sans qui rien n'eut été possible. Elevé chichement par sa
mère veuve, bien que noble et neveu d'évêque, il vivra son enfance comme les
enfants du village, puis fréquentera les jésuites et découvrira les
mathématiques. Cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, la science vient
de franchir une étape essentielle grâce à Euler, d' Alembert, Lagrange et le
professeur jésuite saura ouvrir l'esprit du jeune homme. Toutes les sciences
retiendront, par la suite, son intérêt mais les mathématiques resteront son
espace intérieur où il se réfugiera chaque fois que la vie publique l'obligera
au recul. Ami de Turgot, de d'Alembert et de Voltaire, il se joindra tôt au
combat de Turgot pour la libéralisation du commerce des blés et pour la
suppression des corvées. Pour soutenir Turgot contre Necker, il publiera même
un pamphlet au ton mordant qui effrayera plusieurs de ses proches amis
" Lettre d'un laboureur de Picardie à M
Necker, auteur prohibitif à Paris.".
L'argumentation fustige "
les brigands manipulés qui
démolissent les moulins, en disant qu'ils manquaient de pain et en criant
qu'ils avaient faim en répandant l'or à pleines mains." et surtout les financiers qui se déshonorent
en favorisant la spéculation.
A ces feuillets rédigés à la hâte sous la
pression des remue-ménage politiques,
Condorcet ajoutera un ouvrage rédigé plus posément "
Réflexions sur le
commerce des blés". Il sera publié, par un juste retour des choses, à
Genève, pays de Necker, en 1776 par
Voltaire.
De cette date, l'amitié du jeune Condorcet et
du sage de Ferney sera indéfectible, chacun soutenant l'autre dans ses actions
publiques. Membre de l'Académie des Sciences, il
accédera à l'Académie française après une suite colossale de travaux divers,
sur les canaux notamment, mais aussi sur le calcul intégral, les probabilités,
la chimie des trois corps, un premier projet d'uniformisation des poids et
mesures. Sa participation à l'Encyclopédie est
demeurée célèbre car il sera chargé de la rédaction du chapitre sur
l'Economie-Politique, science nouvelle promise à un grand avenir. Il fut élu à l'Assemblée constituante et
législative et présenta un projet de réforme sur l'instruction publique. La
terreur le surprendra à Paris et il fut mis en prison. Il y rédigea une "
Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain" où s'exprime sa foi
dans l'avenir grâce à l'éducation. Parangon d'honnête homme, non violent sauf
par le verbe contre l'injustice et la souffrance des enfants, Condorcet fut un
citoyen d'une absolue noblesse d'âme, qui conscient de l'horreur de la
guillotine préféra utiliser son savoir de chimiste pour se donner la mort, en
s'empoisonnant, et infliger ainsi un affront à tous les ignobles qui
idolâtraient la machine infernale.
L'héroïsme de Condorcet portait la marque d'une âme bien trempée et d'un
courage rare et pourtant le personnage fut toute sa vie considéré comme timide,
réservé et peu volubile, alors qu'il côtoyait l'élite des mondes des sciences
et des salons. La famille impériale russe, d'origine
allemande, fera même des commentaires méprisants sur l'orateur de l'Académie
qui d'une voix sans emphase parlait de l'unité des sciences et du progrès. Sous
les dorures et dans la légèreté du ciel de Paris, les prémices d'une guerre
culturelle pointaient le nez ! Mais si Condorcet n'avait pas besoin des
accents de Démosthène, ni de Mirabeau, c'est que ses auditoires n'étaient pas
ignorants. Le tiers-état savait lire et écrire !
Enfin beaucoup de congénères de notre
Ribemontois vivaient des aventures parallèles. Camille Desmoulins est fils de
Guise. Il rencontre au Lycée Louis le Grand un certain Robespierre, natif
d'Arras. Ils deviendront, l'un journaliste et l'autre avocat et, unis par
l'amitié, feront la connaissance d'un champenois du nom de Danton. Très vite se
joindra à eux Dumouriez de Cambrai, qui avait une formation militaire. Derrière
cette avant-garde sortie des écoles des frères et des oratoriens, que Condren
avait contribué à édifier, monteront à Paris d'autres picards : Gracchus
Babeuf de son vrai prénom
François-Noël, natif de Monchy, Fouquier Tinville, et Saint Just, l'archange de
la terreur, né à Blérancourt.Les deux derniers de ces trois martyrs de la
révolution furent des acteurs de premier plan d'une machine sanguinaire et furent broyés par celle-ci avant que d'avoir pu théoriser leurs idées. Babeuf,
comme ses semblables, fut condamné à la guillotine et comme Condorcet démontra
la suprême force de la pensée sur l'oppression. Au moment de monter vers
l'estrade sinistre, il sortit un poignard et devant la foule assemblée se
donna, lui-même, la mort à coup de
couteau. La scène se passa à Vendôme, loin de chez
nous, le 28 mai 1797.Qu'allait faire François-Noël loin de son
terroir et du siège de son journal "
la Tribune du Peuple" ?
L'acte ultime de sa vie éclaire le caractère
du personnage qui, lui, prit le temps
de penser à l'édification d'une société plus humaine et fonda une école de
pensée connue sous le nom de Babouvisme. Elle est reconnue pour être l'une des
inspiratrices fortes du communisme marxiste. Cette idéologie l'incorpora sans
trop voir le caractère original de l'apport de Babeuf. Grâce à notre
concitoyen, le communisme sortait du ghetto des cités et des usines pour
annexer les campagnes. Le recul historique permet aujourd'hui de constater que,
à l'inverse des pronostics de ses théoriciens Marx et Engels, le communisme
s'est installé dans les pays à dominante agricole, Russie, Chine, Cuba, là où
Babeuf savait le besoin de révolution possible et non pas là où les
intellectuels des banlieues rouges la révèrent. Gracchus, dont le père traversa l'histoire
mouvementée de la région en optant pour l'armée bourguignonne, devint géomètre
puis "commissaire-terrier" du côté de Roye. Intéressé par les
problèmes de fiscalité, il concevra une réforme présentée sous le nom de
"cadastre perpétuel". Engagé dans cette réflexion largement publique
en ce siècle des lumières, il choisira le prénom de Cracchus pour bien situer le cadre de son projet.
L'empereur romain s'était rendu populaire "par son administration humaine
et ses tentatives de réforme agraire". Tel était tout son objectif !
Après avoir été conseiller de la Somme, il
montra à Paris. Journaliste, très largement polémiste comme cela était d'usage
en ces temps, nullement démagogue, comme le note notre Larousse, ici mal
inspiré, il fut l'un des rares révolutionnaires français avec Condorcet à avoir
une doctrine pour la résolution des problèmes ruraux. Parmi les idées de
"La doctrine des Egaux", les modalités d'établissement d'un système
égalitaire dans le monde agricole, aucune mention n'est faite d'une étatisation
des terres et de la fonctionnarisation des paysans ; la propriété privée et les
revenus ne sont pas condamnés. Les mortels sont égaux: ce n'est pas la naissance, mais la seule vertu qui fait leur
différence. La société n'a pour honneur que de placer ses membres sur un plan
de stricte égalité, dont l'idéal
philosophique est la "
Communauté des biens".Babeuf savait que nos villages vivaient une
solidarité au quotidien de nature humaine et que les inégalités pouvaient se
réduire sans autre intervention que celle de la population concernée. La force
de son message vint certainement de sa propre conviction.
Celui que nombreux présentent comme un
révolutionnaire extrémiste n'entâcha son nom d'aucun méfait ni d'aucun abus. Il
combattit la corruption âprement et vécut pauvre. Tout en assurant à sa femme
et à ses enfants le nécessaire, il expliqua à ceux-ci, dans ses
correspondances, l'aversion que soulevait, en lui, ceux qui dévoyaient la
révolution.
C'est d'ailleurs, au titre de la défense de
la morale, que Babeuf partit vers Vendôme avec quelques amis. Pour un paysan de
Picardie, le soulèvement vendéen ne pouvait pas être un péril pour la nation,
ni la remise en cause des Libertés, ni de l'Egalité et encore moins de la
Fraternité. Il ne s'agissait que d'un pillage et d'un crime camouflé, le terme
de génocide viendra plus tard sans apporter d'explication rationnelle. Babeuf
s'insurge et tente de faire obstruction au chef de la répression : Carrier.
Malheureusement, la tentative que l'histoire relate comme " la conspiration des égaux "est déjouée et Babeuf condamné comme
criminel, sans avoir tué personne, par
l'auteur d'une des plus honteuses tueries de notre histoire, avec derrière lui toute la droite et la gauche du pays d'alors..
Le souvenir du défenseur du peuple vendéen
comme des paysans et des pauvres du monde entier mérite un immense respect.
Certes l'aphorisme de Babeuf : "
Faites
à autrui tout ce que vous voudriez qui vous fut fait " n'est qu'une déclinaison
du commandement chrétien " aime ton prochain comme toi-même", mais se
situant dans un ouvrage d'organisation de la société, il restitue le vrai fond
de pensée de son auteur. Sa pensée, comme notre pays et nos maisons, a été formidablement dénaturée voire déformée par la doctrine marxiste. Parce
que cette forme d'inquisition contrôle encore une grande partie de la planète,
une oeuvre de reconstruction et de
réhabilitation de la pensée de Babeuf s'impose pour les enfants de Monchy, bien
sûr, mais aussi pour l'humanité entière. Les révolutionnaires du Vermandois donnent une dimension nouvelle à notre
communauté. Ni l'honneur de la tribu, ni le fer de l'enclume, ni l'onction
divine, ni le droit de haute justice, ni l'appartenance à la vraie foi n'entrent
en ligne de compte dans leurs démarches personnelles.
Rien de leurs idées n'est pourtant absolument
original !
Elles expriment une sagesse et un amour de la
terre que les Celtes célébraient déjà
certainement autour des feux du solstice, au pied des buttes, mais d'une
manière nouvelle. L'individu humble de notre bourgade ose concevoir l'ordre du
monde et se battre pour ses rêves. Tant que la monarchie fut confrontée à la
convocation des Etats Généraux, à la lecture des cahiers de doléances, à la
déclaration des droits de l'homme, en dépit de troubles localisés, le pays
connut une certaine aisance et une grande exaltation qui enthousiasma toutes
les minorités opprimées de la terre.
Le 25/6/1791, la fuite à Varennes mit le
peuple devant une cruelle réalité. Le fils de Hughes Capet, élu, il y a mille
ans, par nos parents, détenteur d'un maillon de la chaîne du tombeau de Saint
Pierre, guérisseur des écrouelles, craignait-il ses sujets , qui, chaque jour,
se saignaient pour son bon plaisir ? A quoi servaient donc toutes ces prières
que le peuple ânonnait sincèrement pour lui et sa famille ?
Le chemin de la République n'apparaissait pas
comme une voie à sens unique. Plusieurs monarchistes votèrent pour la
"Gueuse" sans trouble de conscience puisque la famille royale offrait
une multitude de candidats au poste. La faute vint, une fois de plus, du parti
de l'étranger et du goût des armes. Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II, qui
fut l'ami de Voltaire, d'Alembert et même de Condorcet, se garda d'intervenir
tant que le risque de contagion n' existait pas. Quand celui ci apparut, le
Kaiser fut soumis à la forte pression du lobby militaro-sidérurgiste. Le
maréchal de Brunswick partit avec des canons derniers modèles vers Valmy. La
patrie, déclarée en danger, était plus qu'en péril. Reims et Paris étaient
proches. Kellermann rassembla tous les anciens poilus des troupes royales.
Dumouriez recruta dans le ban et l'arrière ban de nos campagnes les miliciens
des anciennes forces municipales. Saint Quentin et la Fère apportèrent les
meilleurs artilleurs du pays et la
Picardie comme les provinces avoisinantes enverront des cohortes en guenilles
innombrables. La troupe portait l'habit des paysans, quelle coïncidence
!
L'importance du nombre fut déterminante car
les Prussiens se voyaient submergés par la piétaille. Ils donnèrent du canon.
Mais, depuis les frères Bureau, et les essais
de tir courbe en Picardie, la Fère maintenait intact un savoir que la haute
noblesse avait toujours dédaigné. Aussi, la partie de boulets entre les
Prussiens et les Picards montra vite la
supériorité de nos artilleurs .L'assaut des fantassins fut de pure forme car la
décision prudente des assaillants était déjà prise. Ils rebroussèrent chemin et
demandèrent à M Krupp du matériel plus puissant pour la prochaine. Le plus bel
esprit, que l'Allemagne ait porté assista au spectacle. Goethe écrivit ;
"
d'aujourd'hui et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire du monde
"
.La phrase a la certitude et l'emphase du
style germanique en omettant toute notre histoire. Elle exprime,
toutefois, une secrète angoisse. Goethe
entrevoyait des malheurs. Ceux-ci furent prompts à apparaître et touchèrent au
paroxysme chez nous en 1917/ 1918 soit 125 ans après.
Les sans culottes revinrent au pays, couverts
d'une gloire prodigieuse et devinrent la proie facile de traditionalistes qui
rappelèrent le droit des vainqueurs au pillage et à la confiscation. Les biens des nobles et de l'Eglise
devenaient vulnérables. Les châteaux furent pillés. La basilique vit apparaître
des profanateurs qui coupèrent les têtes des statuettes, méticuleusement comme
sur ordre. L'hystérie n'eut certainement pas les débordements de violence
auxquels nous sommes habitués en ce vingtième siècle car la brisure de la tête
n'atteint pas le reste des corps. Il s'agissait d'un acte symbolique.
L'histoire ne nécessitait pas de réécriture. Seul le mental figurait au
changement.Les pages de la révolution recèlent une
foultitude d'actes de piété et de courage anonymes. Les reliques des saints,
les portraits de familles des châteaux, les livres pieux comme les vieux
grimoires rassemblant les généalogies, titres et rentes, furent souvent sauvés
par des servantes ou des mécréants.
Ces objets sortaient dépréciés, invendables,
inutiles et souvent mutilés. Ils avaient été aimés pourtant et ce seul élément
justifiait leur résurrection.


L'église, la mairie et
l'école.
Le Vermandois coupé en
trois.
Napoléon.
Riqueval. La betterave. Tilsit.
Le tremblement de terre qui frappa la tête du
pays et fit tomber tant de chefs et couvre-chefs arriva affaibli à nos
latitudes. Le tribunal révolutionnaire de Laon ne prononca que six condamnations
à mort parmi les 22 détenus que Saint Just et Lebas firent incarcérer. Les
prêtres, religieuses et nobles qui avaient quitté le pays reprirent le chemin
du retour dès 1793. Ils retrouvaient des villages et des villes où l'ignorance
avait été la seule gagnante. Les biens de l'église avaient été vendus sur la
base de 22 fois les baux et l'inflation avait rapidement réduit cette quotité,
avantageant une nouvelle classe de paysans qui aspiraient plus que tout à une
élévation sociale et culturelle. Où trouver des bribes de ce savoir qui
pouvait changer le monde ?
Pas du côté des révolutionnaires
démolisseurs, la "
bande noire" qui ététa les statues et brisa les
vitraux, pas aux presbytères des églises souvent fermés depuis plusieurs années
!
Les anciens frères des écoles, les anciens
précepteurs des grands familles exilées combleront les premiers le vide en
créant des " boutiques d'instruction "dont les boîtes à bac sont les
vestiges. Dès que le Concordat sera
signé par le Pape Pie VII, réautorisant les cultes et rétablissant l'autorité
de Rome, des communautés nouvelles émergeront, souvent à but pédagogique.
Les soeurs de la Providence , les soeurs de
Saint Joseph de Cluny, les dames du Sacré-coeur, forment le beau chapelet d'
ordres féminins nés en ces temps troublés. Dans une humilité totale, telle
qu'aucune des fondatrices ne figure dans nos dictionnaires usuels, les soeurs
réussiront l'éducation de la planète femme, en essaimant sur les cinq
continents. Plus timidement les ordres masculins surgiront également souvent
avec les habits anciens mais des idées neuves. L'école des Jésuites de Saint
Quentin fut reprise par deux prêtres séculiers. La machine était relancée. Elle
fera de la France au XIX siècle, la pépinière principale des missions.
Ce renouveau spirituel découlait
naturellement de l'ascension sociale de nouveaux promus. Il s'appuyait aussi
sur une modification complète des données. Deux indices témoignaient d'un changement.
Les "
feux" n'existaient plus comme base d'imposition et de recensement.
L'unité de base de l'assiette fiscale ne comprenait plus l'individu dans sa
complexité familiale et patrimoniale. L'impôt transperçait l'habit pour
atteindre le portefeuille en plein coeur de chacun des citoyens. L'autre
bizarrerie sortit des esprits échauffés des députés réunis à Versailles. Pour
simplifier l'administration de la France, il avait fallu la redécouper. Tâche
impossible qui obligea les parlementaires à discuter des nuits entières.
Parce qu'il fallait faire table rase de tout
ce qui distinguait les Français entre eux : coutumes, parlers, habits, histoires, le pays fut découpé selon son
hydrologie. Idée de scientifique du Sud, elle posa un casse-tête dans le
Vermandois baigné par quatre rivières souveraines. Un coup de crayon tracé dans
l'abrupt d'une décision indéfendable remplaça la raison. Le Vermandois
merveilleusement dessiné par son relief et ses fleuves disparut. Avec lui,
petit à petit s'estompa non pas le sentiment d'une identité mais sa mémoire.
La division des archives, des chefs-lieux et
des juridictions imposera lentement une aberration économique, contre laquelle il est néanmoins encore temps de
réagir !
Laissée à elle même, la région retrouva vite
les voies d'une relative prospérité. L'administration nouvelle n'eut guère à forcer
la mesure tant les charges paraissaient soutenables. Le fut moins l'enrôlement
militaire décidé par le nouvel Empereur. Le tiers état d'avant 1789 n'avait pas
imaginé que l'égalité devant l'impôt entraînerait le devoir pour chacun de
payer sa citoyenneté au prix du sang. L'Aisne de 1802 à 1814 fournira 20000
soldats. Chaque village avait ainsi son grognard, qui mieux que les professeurs
de géographie, obligeait les jeunes à situer précisément des principautés
minuscules et exotiques. Le sentiment national grossissait de l'évocation des
batailles et des nombreuses victoires. Dans l'euphorie bonapartiste, une
administration carolingienne reprit de nouvelles couleurs et s'incrusta
définitivement : les préfets. Ils ne portaient pas seulement l'uniforme, tous
leurs actes seront empreints d'une indélébile manière de faire, fondus dans un
même moule, expressions parcellaires d'un code rationnel, sans équivalent
historique.
L'Administration avait posé ses fondations
dans tous les coins et recoins du pays. Les juristes qui rédigeront le Code Civil :
Lakanal, Cambacérès, etc seront plus des gens du Sud que des ressortissants du
parler d'oil. La clarification de la notion de personne et de propriété des
biens confinait à la caricature pour les habitants de chez nous. L'apport valut
quand même pour sa valeur théorique. Plus concrète fut l'oeuvre de
Napoléon en matière économique et
culturelle. Il souhaita ardemment un crédit ouvert à tous et instaura la Banque
de France, le Crédit Foncier et la Caisse des dépôts et consignations. Il
voulut par dessus tout une égalité des chances dans le secondaire et une élite
pour son administration . A cette fin, furent posées les bases de l'éducation
républicaine: les lycées et l'école polytechnique.
Malheureusement, en dépit de bonnes
intentions, il échoua dans la mise en place d'un régime démocratique. Celui-ci
passait dans l'esprit de nos concitoyens du Vermandois par la restauration
d'une assemblée provinciale. Pour Napoléon, il n'en fut jamais question ! Il
devait son pouvoir à son frère Julien, qui tenant l'assemblée nationale, lui
avait ouvert la voie, mais Bonaparte n'aimait pas ce frère-là et donc, aucune
représentation populaire non plus.
Il força le pape à le désigner comme
successeur de Charlemagne en compensation du maintien de ce dernier sur un
trône temporel et en lui promettant des gardes français. Puis, à l'identique
d'un processus déjà connu, il fit de ses vaillants compagnons d'armes des
barons. De nombreuses terres venaient d'être abandonnées par leur seigneur, il
les donna à Caulaincourt, Lefèvre, Savary, Foy, Lauriston ......... en
remerciement des brillants services rendus. Avec des domaines importants,
Napoléon ne put cependant faire ce qu'il chercha à obtenir pour sa parentèle :
donner un droit de haute justice à ses barons, comme au début du moyen-âge.
Montesquieu, Condorcet et les autres avaient eu le temps de faire inscrire dans
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le principe fondamental de
"
l'Esprit des Lois": la séparation de l'exécutif et du judiciaire.
Ces dignitaires d'Empire ne regrettèrent pas trop de n'avoir reçu que des
avantages matériels, car plusieurs continueront une vie politique soucieuse de
l'intérêt général et perdureront bien après la fin de l'Aigle.
Le général Foy est un de nos personnages
illustres. Apparenté à la famille Vinchon, il réussira superbement sa carrière
militaire. Présent à Jemmapes avec la troupe du Vermandois, il passera
capitaine d'artillerie à cheval après cette victoire. Puis ce sera Huningue,
Diersheim où Bonaparte le choisit pour aide de camp, Boulogne-sur-Mer, Zurich,
puis Ulm, Austerlitz et jusqu'aux Dardanelles où il arrête Russes et Anglais.
En couvrant la retraite de l'armée d'Espagne, il gagnera son grade de général
de division. A Waterloo, luttant jusqu'au bout, il sera blessé.
A l'heure des élections de la monarchie
parlementaire, il devint député libéral de Ham de 1819 à 1824. Bon orateur et
très représentatif de la pensée libérale de nos concitoyens, il fut un
personnage très en vue et se retrouva même, par alliance, lié à la famille du
grand chirurgien Cabanis, lui même proche de Condorcet.
Parmi les autres grands serviteurs de
Napoléon et de la France, un personnage est resté peu connu et mérite une place
dans notre chronique. Natif de Saint Denis, il fut l'exécuteur testamentaire de
Gracchus Babeuf ( au figuré) et instaura le projet que tout le monde
considérait comme fumeux du " cadastre perpétuel".
Ce grand commis de l'Etat fut un homme de
confiance de l'Empereur et fonda le service du cadastre en 1807, afin d'assurer
la perception de l'impôt foncier. Il s'appelait Martin Gaudin et se donna les
moyens de connaître notre région mieux que personne. En outre, sans arme, il
gagna une bataille qui ne figure pas dans les livres d'histoire: celle du
franc.

En une époque, où le monde était coalisé
contre nous, il assura la stabilité de
la monnaie et des budgets équilibrés, malgré les besoins de la grande armée.
Son mérite fut tel que, dès que la monarchie connut ses premières difficultés
financières, elle le nomma gouverneur de la Banque de France, où il resta en
poste de 1820 à 1834.

Par le cadastre, l'impôt foncier et la Banque
de France, il fut l'initiateur de la plus grande banque de données sur notre
région, étalée pourtant sur trois départements.
Cette connaissance approfondie ne s'opposait
pas à la pensée libérale de Foy. L'un et l'autre voulait un France forte,
s'appuyant sur des citoyens entreprenants et aidée par une administration
efficace.
Dès 1803, le goût d'entreprendre, sortant d'une
longue torpeur, rejaillit. A Roupy, M
Arpin crée la première filature de Coton du département de l'Aisne. Peu après,
une seconde est mise en route à Saint Quentin. La famille des filatures
comptera en 1810, 7 membres occupant 1500 ouvriers et utilisant 230 000 kilos
de coton. En 1825, l'arrondissement verra tourner 34
filatures dont 25 à Saint Quentin. La repousse du textile, facilitée par un
terreau fertile, n'eut pas que des causes naturelles. Le blocus de l'Angleterre
n'entravait guère les arrivages de coton brut mais avait complètement cessé
celui des cotonnades travaillées. Tous les ports de la Manche et de
l'Atlantique n'étant plus sûrs, le trafic fluvial récupéra les tonnages. Napoléon et ses préfets, les Saint-Simoniens,
les lecteurs des écrits de Condorcet sur les canaux, les fluides, la chambre
consultative des manufactures, arts et métiers née à Saint-Quentin en 1795,
tous s'accordèrent pour continuer le Canal de Crozat. En reliant l'Escaut, la
grande France serait sur le même bateau ! De plus, cette voie d'eau doublerait
le Rhin indomptable dans une région incontestablement plus fertile et plus
peuplée.
Le canal fut ainsi poursuivi et Napoléon
viendra personnellement l'inaugurer en 1810. Un tunnel de 5, 67 km, pour des péniches, n'avait jamais été creusé
depuis le début de l'humanité. Les chevaux de halage deviendront fous dans
l'obscurité, les hommes manqueront d'air ! Des craintes du fond des âges
allaient arrêter le trafic devant le trou noir béant rentrant sous terre. Ni
l'homme, ni l'animal n'oserait franchir
le Styx ! Les ingénieurs, pour vaincre l'obstacle psychologique, conçurent une
machine inédite et absolument pacifique: la machine à touer. Les embarcations
seront tractées à l'aide d'un dispositif mécanique enfoui dans le chenal, connu
sous le nom de touage. Par Riqueval, la
science convainc deux fois : elle transperce l'obscurantisme et apporte la
richesse. Avec son installation technique prodigieuse pour l'époque, la région
rentrait de plain pied dans le vingtième siècle. Les prodiges vivant par
osmose, en moins de dix années, les mines de Denain-Enzain seront mises en
exploitation, l'industrie cotonnière drapera tout un réseau de filatures aux
quatre coins de la contrée, enfin l'industrie sucrière sera née.
Le transport fluvial, tué par les syndicats
de la SNCF, est mort aujourd'hui et a laissé place au nautisme fluvial et à la pêche à la ligne. Le charbon n'est plus
qu'une énergie du passé ; les cotonnades viennent d'ailleurs, l'industrie
sucrière, elle, subsiste !
Grâce en soit rendue à Olivier de Serres,
Achard ( son nom n'indique pas qu'il était allemand mais rappelle que nos
huguenots furent nombreux à fuir vers ce pays), Delessert et surtout au blocus
continental que les Anglais infligeront après Trafalgar. En 1812, le même Arpin de Roupy fera construire la première
fabrique à sucre.
Comme pour les filatures, la multiplication
des sucreries fut rapide. M
Privat-Théry fondera la première société de sucrerie du Vermandois à Athies en
1826, puis une autre à Grugies en 1832, puis Montescourt-Lizerolle, Douchy,
Monchy-Lagache sous forme de société en commandite entre M Perdrix de
Montescourt et des financiers parisiens. Guizancourt-Quivières,
Flavy-le-Martel, Marteville etc, etc, suivront.
Chaque village ressentait les effluves fortes
de la saison et personne ne se plaignait. Avec les pompes, les wagonnets
souvent mus par la vapeur, la France devint le pays producteur de la moitié de
tout le sucre mondial. A Paris qui vivait de cette prospérité, la bourgeoisie
allait au spectacle voir les opérettes où s'extériorisaient souvent des
Brésiliens, rois du sucre, avec gros cigares et manières de campagnards.
On peut rire encore de ces stupidités !
La rumeur des coulisses s'étonnait parfois
que ces rois du sucre parlaient singulièrement bien le français et étaient peu
prolixes sur leur pays d'origine. Avec un canal, dont la seule vision
rapprochante est celle d'une autoroute, des filatures et les sucreries, la
population fit un bond prodigieux. Là où les villages rassemblaient mille
personnes, on en compta 1400 en moins de trente années. A tous ces gens qui hélaient, binaient,
étêtaient les betteraves, chargeaient les chaudières, il fallait des aliments
roboratifs : la charcuterie et la
biscuiterie dépasseront vite le stade artisanal et la petite industrie alimentaire vendra bientôt ses productions
jusqu'à la capitale. L'Empire impulsa un prodigieux décollage
économique à notre région qui aurait dû valoir à Napoléon une reconnaissance
visible parmi les monuments ou les noms des cités. A la médaille de la réussite
industrielle, il y eut un revers. Les citoyens prospéraient, la monnaie était
forte mais, au contre-jour, le crédit de la France, bâti par la sagesse de rois
chrétiens, rapetissa comme peau de chagrin.
Lorsque, exilé sur l'île de Saint Hélène,
Napoléon fera le bilan de sa vie, il dira que le moment où il se sentit le plus
heureux fut à Tilsit. Ce bourg se trouve aujourd'hui en Lithuanie. Mais, si la
carte a souvent changé, le bourg est toujours au bord du fleuve Niemen. C'était
alors une terre de la Prusse-Orientale, conquise par les chevaliers teutoniques, et berceau d'une ethnie
germanique marquée par une double ascendance, viking sans l'amour des bateaux
et mongole sans les chevaux. Le mélange donna les Prussiens.
Les rois de Prusse progressèrent rapidement
dans le classement des Princes-Electeurs après la guerre de trente ans où ils
prirent le parti des protestants. La seconde avancée de ce peuple fut l'oeuvre
d'un certain Frédéric-Guillaume, le "Roi-Sergent "qui constituera un
modèle d'armée, avec des fantassins de deux mètres et une musique soufflante, à
vous soulever la jambe tendue jusqu'à l'horizontal.
Les généraux de cette force présentaient
l'originalité de ne jamais discuter un ordre et d'être fidèles, ce que jamais
ni l'ost, ni l'armée d'Empire et, a fortiori, celle de la République ne sauront faire. Après une position enviée
dans les compétitions militaires, ce pays se qualifia aussi dans un domaine où
la France croyait en ses atouts : la culture. Frédéric Guillaume II, en
subventionnant les grands penseurs français dont Condorcet, Voltaire,
d'Alembert et bien d'autres, donna à son pays la respectabilité qui lui
manquait. Il fit de Berlin la première ville d'Allemagne et un phare pour le
siècle des lumières à retardement.
Avant d'arriver à Tilsit, l'armée
napoléonienne avait profité de sa supériorité pour défaire la Prusse à Iéna. Le
jour de cette bataille (14/12/1806), le Duc de Brunswick, qui avait pavané à
Valmy, mourut. L'appellation de
Brunswick a une consonance anglaise, qui rappelle que notre pays ignorait
énormément sa voisine et que la seule presse qui parlait de ces potins de cours
venait d'Angleterre. Le nom allemand de la province est celui de Braunschweig,
c'est une vaste plaine du nord, riche entre Hanovre et Magdebourg, dont la
place sur la carte de l'Allemagne n'est pas sans rappeler celle du Vermandois
et du Santerre chez nous.
La Prusse étant à terre, la victoire fut
célébrée à Berlin avec une astuce cousue de fil blanc. Napoléon décréta le
blocus continental ou plutôt l'inverse, qui laissait à penser que la France
pouvait décider du mouvement des navires en haute mer. Depuis longtemps, le
pavillon anglais dictait sa loi mais un bon décret annoncé dans l'euphorie
d'une victoire fardait une capitulation avec des couleurs de solennité
chevaleresque.
De Iéna à Tilsit (14/6/1807), les troupes
impériales furent encore victorieuses à Friedland, cette fois sur les troupes
du tsar Alexandre. Napoléon était le maître de l'Europe et Friedland portait le
poinçon d'une Europe définitivement en paix.
Napoléon à Tilsit atteignait son zénith. Lui,
le républicain, recevait les
embrassades de deux empereurs et, ayant
déjà programmé un mariage royal, se crut définitivement admis dans le cercle le
plus fermé du monde.
C'est bien connu, on ne fait pas d'omelette
sans casser des oeufs ; la Prusse fit les frais. Elle fut démembrée.
Alexandre de Russie reçut le morceau qui
l'intéressait, puis une volée de reproches de son épouse. La reine de Prusse,
Louise, était une petite cousine qui
perdait le plus gros de son domaine. La diplomatie fit savoir à l'empereur
français que son homologue russe souhaitait que sa parente soit reçue avec les
honneurs dus à un monarque régnant.
L' entrevue eut lieu à l'heure du souper.
Louise, élevée à 120 % en française de bonne famille, passa une soirée
plaisante et, dans le brillant enjoué de la conversation, usant de son charme féminin, offrit, après
les liqueurs, à son hôte une rose . "
Une rose pour Magdebourg "
dit-elle !
C'était un marché de femme. Je vous fais don
de ce qu'une reine a de plus cher au monde et laissez moi la ville de Magdebourg !"
Il était vital pour ce royaume de garder
cette possession la plus à l'Ouest, porte vers l'occident et contrepoids
culturel de Berlin. Napoléon préférait Madame Sans Gêne aux intrigantes qui se
mêlent de la politique.
Il refusa la fleur..... alors que Magdebourg
n'était qu'une bourgade et que la rose
lui assurait l'amitié d'une famille
royale très respectable.
Le geste n'eût pas coûté beaucoup et le
Vermandois aurait gardé tous ses châteaux magnifiques. L'erreur fut faite. Le petit caporal venait de faire disparaître
de la carte le Saint Empire germanique et de faire perdre la face à une rose.
Le contentieux de Canossa contre Guiscard et les rois francs se doublait d'un
ressentiment beaucoup plus sérieux : le pays du roman de la rose ne
trahissait-il pas sa propre culture ?
Un ruffian pouvait-il prétendre donner
impunément des leçons au pays des rustres ?
Dès la défaite de Waterloo, la Prusse
récupéra Magdebourg, mais surtout les provinces que Napoléon destinait à son
frère Jérôme et à d'autres : la Poméranie, la Ruhr, la Saxe, la rive gauche du
Rhin. Toutes passèrent sous le gouvernement musclé des rois prussiens.
Le Kronprinz et les canons de la Ruhr se
rapprochaient de chez nous...
Il n'y avait plus besoin de respecter les
belles manières puisque le maître de cérémonie venait de se comporter en
cuistre !

La Campagne de Russie.
Les Missions.
Badinguet
70,
La calèche de
Blérancourt.
Faidherbe et les autres.
Le chapitre épineux de la rose de Magdebourg
ne tarda pas à avoir des répercussions surprenantes. Napoléon n'avait pas fait
attention à la valeur de la fragilité des plantes et récidiva en faisant fi des
grenouilles qui indiquent clairement les bulletins métérologiques. Non,
vraiment, cet individu n'était pas d'ici ! Ce fut l'échec pitoyable de la
grande armée devant Moscou, puis la plus longue débâcle de l'histoire, que Napoléon, qui était frileux,
écourta en rentrant précipitamment à Paris, avec une petite escorte.
Poursuivant les troupes napoléoniennes exténuées, l'armée des cosaques
s'annonça vers le début janvier de l'année 1814 aux limites de la région. Les préfets avaient adressé des appels
énergiques pour, comme autrefois, monter sur les remparts. Par comble
d'imprévoyance, l'empereur, en venant de Riqueval en 1810, avait donné suite à
la demande de la municipalité de Saint Quentin de démolir les fortifications
pour récupérer du terrain à bâtir. Le discours de "
France, garante de la
paix du monde " entonné par les partisans du petit caporal était devenu
suspect. Les hommes mariés ne vinrent pas s'enrôler. Les volontaires traînèrent
la patte, comprenant qu'avant la canonnade, il faudrait rebâtir les murailles
éventrées. La municipalité, sans doute tancée par l'administration, placarda,
dans l'espoir de remplir les listes d'enrôlement, le texte suivant :
"
Habitants de Saint-Quentin, les puissances coalisées ont formé le gigantesque projet de marcher vers
la Capitale et de se partager la France. De tous côtés on vole à la défense
des pays attaqués.Des secours sont accordés à vos femmes et à vos enfants; balancerez-vous
pour prendre part à la défense commune ? Ne serez-vous donc pas les descendants de vos ancêtres dont le corps était un rempart impénétrable
aux efforts de l'ennemi ? "
Sans vergogne, l'appel au sacrifice, en
offrant son corps, était reconnu au
seul bénéfice de la capitale. Tout au plus, des " secours " pour les
veuves et les enfants, le cynisme de l'administration parisienne se montrait au
grand jour. Les paysans d'ici ne virent pas malice et rejoignirent la troupe
levée à la hâte. Quatre à cinq mille soldats se retrouvèrent dans la place avec
un détachement du 29ème RI, la garde nationale et des munitions du dépôt de La
Fère. Le 13 février, la cavalerie légère cosaque
arriva de Guise avec le Baron de Guesmar à sa tête et somma la ville de se
rendre. Trente mille hommes avec 80 pièces de canon cheminaient derrière sur l'axe Vervins-Laon. Comme, en même
temps, le retour des Bourbons à Paris faisait planer un doute sur la nécessité
d'un affrontement, la ville se mura dans le silence, garda les portes fermées
et répondit par un silence-radio au plénipotentiaire. Le chef de l'armée russe n'insista pas et
éperonna son cheval en direction de Chauny. Les troupes prussiennes de la Saxe
avaient débordé le Vermandois par le nord et bouclaient ainsi la région. Chauny
puis Saint Quentin ouvrirent leurs portes sans combattre. Il fut fait mention dans le Moniteur, qui
était l'organe de presse officiel de la France, d'une résistance héroïque.
Selon un auteur de l'époque, la reddition du 9 mars ne comporta qu'un coup de
main de la part des Russes sur la porte d'Isle où ils essuyèrent des coups de
feu. Ils reculèrent "
; mais la
résistance ne pouvait continuer longtemps sans exposer la ville à la colère
d'un ennemi, dont les forces, grossissant sans cesse, triompheraient bientôt
d'un rempart en mauvais état et d'une garnison insuffisante ". Aussi, le 11 mars 1814, la ville fut
occupée par 800 hommes, vite rejoints par d'autres troupes qui restèrent
jusqu'au 7 Juin. Pendant trois mois, la région vécut sous
l'administration tsariste !
Les officiers s'installèrent dans les belles
maisons de la ville et purent discuter d'industrie et de commerce, matières
nouvelles pour ces cavaliers et paysans et merveilleuses à tous points de
vue. Le colonel, commandant de la place, Ougrimoff
II, reçut , lors de la restitution de la ville à ses édiles et du départ du
régiment Yakowtsky, un honorable
cadeau, en reconnaissance des bons soins prodiguées à la population. Les indemnités de cette occupation furent
payées rubis sur l'ongle par les services de l'efficace Gaudin. Saint -Quentin
toucha un million de francs d'indemnités, Ribemont 800 000 Francs. Chauny, La
Fère, Origny, Péronne autant, soit un total approximatif d'une dizaine de
millions de francs
L'arrivée des Russes fut le prologue d'une
autre occupation étrangère, qui se produisit 12 mois après. Du 24 Juin 1815 au
15 décembre, c'est la coalition de Waterloo qui prit la relève, comprenant,
pêle-mêle, Prussiens, Bavarois, Saxons, Hollandais, Anglais.La mémoire ne garda
le souvenir que d'une occupation prussienne et leurs manières ne vaudront pas aux occupants de cadeau de départ, et ce
d'autant que le départ du 15 décembre ne concernait que les troupes et non
l'administration. La région, comme une grande partie de la France, resta sous
les férules étrangères pendant trois années jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle
en octobre 1818. Depuis les premiers tremblements de la
révolution, jusqu' au retour de la région dans la monarchie française, sous le panache blanc-cassé du dernier des
Bourbons, une génération entière avait
été ballotée comme dans un sac de billes, à en perdre tous repères, voire la
raison. Il fallut du courage à Foy et à d'autres pour s'engager dans la vie
publique. La génération montante chercha plutôt dans l'industrie et l'éducation, un avenir moins chaotique.
Les activités cotonnières, sucrières et de
transport fluvial virent monter du sud la locomotive et son panache de fumée.
Dès 1833, la municipalité s'intéressa au projet. La concession fut, elle,
signée en 1845 à la compagnie Rothschild et le premier train rentra en gare de
Saint Quentin le 9 Juin 1850.L'enseignement, qui avait survécu au
nihilisme révolutionnaire, reprit de plus belle sous l'effet de la poussée
démographique et l'appel au concret. Comme nombreux étaient les jeunes
réticents aux imprécations de Guizot et du banquier Laffite au slogan de supermarché,
" Enrichissez vous", ils se tournèrent vers une religion teintée
d'humanisme et de pédagogie. Ce fut le démarrage des missions françaises à
travers le monde. L'importance du phénomène ne fait, encore de nos jours, guère l'objet d'études objectives. L'intelligentsia
parisienne a incorporé le travail des prêtres missionnaires dans le processus
"colonialiste" et peu nombreux sont ceux qui osent s'opposer à
ce penser correct. Et pourtant, en manière de boutade, l'évangélisation des
peuples et le colonialisme ne peuvent pas être liés...... puisque le
Vermandois, longtemps après l'Afrique et la Patagonie redevint au vingtième
siècle une terre de missions. Entre la vapeur des machines et la conquête
des âmes, nos concitoyens écoutaient les grelots des politiciens qui
recommençaient à parler et à promettre.Lorsque des signes de ralentissement de la
croissance envoyèrent les citoyens vers leurs élus pour obtenir des aides et
finir leurs projets, rien ne vint ; ni argent, ni idées, ni déclarations de
solidarité. Les seules publications remuantes provenaient des scientistes, des
Saint-simoniens, de Proudhon, Fourier, Blanqui, Barbés et d'un mouvement dont
l'existence semblait ancienne, les francs-maçons. Ham figurait encore parmi les cités
importantes du pays en raison de son fort superbe dont le donjon se classait en
circonférence et majesté juste après celui de Coucy. Un petit neveu de Napoléon
y fut incarcéré pour avoir tenté une incursion en France . Il distribua assez
largement autour de lui les propos d'un ouvrage qu'il était en train de rédiger
et qui sonnait comme un programme ; il s'agissait, ni plus, ni moins, que de
"
l'extinction du paupérisme ".Le bouche-à-oreille rapporta le titre du
livre et toute la population fut subjuguée. N'était-ce pas la réincarnation de
l'Empereur, qui avait fini le canal, crée les sucreries, instauré des rentes
solides ?
Alentour, les intentions du prisonnier se
diffusèrent plus vite que le son, c'est-à-dire sans bruit.
Sans difficulté, le prisonnier demanda, un
jour, à un maçon qui travaillait là, sa blouse et sa vareuse et, déjouant
l'attention des gardes, sortit par la grande porte sans être remarqué, ni dans
la prison, ni dans la cour, ni dans les ruelles étroites de la ville, ni sur
les routes découvertes menant aux frontières. L'incognito du promeneur
rencontra un singulier consensus ! A son retour, un plébiscite fut soumis au
peuple de France pour le rétablissement de l'Empire. Le Vermandois vota pour
massivement. Après tout Badinguet était fils de chez nous et c'est lui qui
demandait le titre d'empereur. Pouvait-on refuser à ce voisin une telle
promotion ?
Magnifiquement plébiscité, Napoléon III vint
à Saint Quentin pour inaugurer la ligne de chemin de fer, dernière prouesse de
l'ère moderne. Cet empereur-là n'avait plus qu'une faible
sanguinité corse et se garda de commettre les erreurs de son aïeul : il
entretint les meilleures relations du monde avec les reines et particulièrement
avec Victoria et promit que l'empire serait la paix. Il tint globalement ses promesses et la
prospérité repoussa avec vivacité. Que l'on songe aux travaux que réussit
Haussmann à Paris jusqu'au phare Napoléon qui éclaire toujours le chenal menant
au port de Nouméa en Nouvelle Calédonie !
Son règne se termina mal pourtant pour deux
raisons peu explicitées. La première fut l'excès de libéralisme. Un
symbole résume toute la problématique. L'empire fit le choix de se symboliser
sur toutes les tentures, sous-mains et documents par des myriades d'abeilles
identiques..........toutes ouvrières sans distinction de fonction
.... ni de syndicat......
L'emblème était original mais personne ne s'était posé la question
de savoir si les abeilles avaient une âme ?
Une conscience s'éleva pour déclarer
"
Filles de Lumière, Abeilles. Enlevez vous de ce manteau ". L'auteur
de l'appel,
Victor Hugo, fut longtemps le seul opposant de Napoléon III et
troubla beaucoup de consciences souvent résignées. Travailler, travailler, pour
quoi ?
La seconde raison plonge aussi dans l'esprit
du temps et éclaire sur l'école de pensée du travaillisme, si proche du
socialisme. L'obsession de la paix, se doublait de la
conviction que l'armée populaire était infidèle et que l'armée de métier était
ruineuse. Certes la France avait été condamnée à réduire
ses effectifs, mais ce type de clause ne dure pas plus de six mois après les
défaites. Napoléon III pensait comme Victoria qu'une armée de métier était
suffisante et que les exploits contre les chameaux du désert suffisaient à
occuper les généraux avides de gloire. Cette idéologie proprement travailliste
souffla aussi dans l'oreille de l'empereur une fâcheuse décision. Un jour de novembre 1865, il reçut la visite,
en son palais de Biarritz, d'un certain Bismarck, Junker prussien que son roi
avait désigné comme premier ministre. Louis Napoléon était déjà un peu
souffreteux et sa femme avait de plus en plus voix au chapitre. La reine
d'Angleterre recommandait le grand gaillard. Bismarck qui dut rappeler à
Napoléon l'épisode de Magdebourg vint solliciter l'accord tacite de la France
d'attaquer l'empire austro hongrois qui avait profité de Tilsit et ne voulait
pas rendre les terres. Louis Napoléon donna un blanc-seing à ce
Junker. Le reste est connu, la Prusse battit l'empire austro-hongrois à Sadowa. Cette victoire porte un nom sinistre car la
destruction programmée de nos belles maisons s'enchaîne depuis cette
date-là !
Pour la forme, un traité fut envisagé et les
diplomates français eurent leurs ronds de serviette autour de la table. Pour notre ministre plénipotentiaire, l'enjeu
était simple : faire reconnaître une Germanie à trois têtes: Prusse, Empire
Autrichien, confédération d'états au sud.
Le traîté de Nikolsburg fut un camouflet pour
notre pays. L'Empire autrichien, vaincu, perdit pied en Allemagne. La Prusse
devint protectrice de toutes les terres du Nord. Les Etats du Sud restaient
indépendants et divisés, incapables d'entraver l'irrésistible ascension.
La France avait enfanté un monstre politique
et économique. Le naïf Napoléon croyait avoir affaire à un peuple de commerçants,
boutiquiers, sportifs et idéalistes comme nos voisins britanniques. Malgré une
certaine culture, notre élu ignorait l'ethnologie des peuples que les monarques
anciens connaissaient par atavisme.Cette bévue va, avec la guerre de 70, se transformer
en catastrophe.Que ce soit à Paris, Lille , Amiens, les noms
de Faidherbe, Bourbaki, Niel, Bazaine, Chanzy, Mac Mahon figurent sur nombre de
plaques de rues comme des généraux victorieux. Une majorité de contemporains
est convaincue de leur courage et de leur génie. Soixante-dix, pour les élèves
de l'école de Jules Ferry, ressemble à un tour de magie. Voilà une défaite
humiliante dont nous honorons les acteurs !
Pourquoi siègent-ils encore au pinacle ?
L'armée de Napoléon le petit, n' était qu'une
pâle imitation de l'autre. Le service national n'était plus obligatoire et la
durée minimum de l'engagement était de sept années. Une troupe encasernée de cette manière ne
peut avoir qu'une vue très déformée de l'intérêt national, même si elle excelle
dans les défilés et les manoeuvres de routine. Certes, nos troupes et leurs
vaillants généraux avaient apporté des rapports élogieux sur leurs hauts-faits,
mais les médias n'étaient pas là. Ces victoires étaient à mettre à la dimension
de quelques poursuites de fellous et de brigands mexicains.Quand les premiers
heurts diplomatiques apparaîtront avec l'Allemagne et que surtout le bruit se
répandra en Europe de l'efficacité du fusil à aiguille des Prussiens, Napoléon
III invita l'Etat-major à une "
réflexion". Lui-même ordonna (en 1866) la mise en service du fusil Chassepot,
inventé depuis quinze ans mais décrété impropre à rendre des services en
campagne par le sérieux comité technique.L'empereur imposa aussi l'adoption du canon
rayé et la fabrication de mitrailleuses, avec la précipitation de ceux qui
s'aperçoivent du temps perdu. Il demanda aussi le rétablissement d'un service
obligatoire à court terme tout en sollicitant, au préalable, l'avis des
généraux constellés d'étoiles. Mais l'armée fonctionnarisée, "
ennemie
du changement de l'ordre où elle avait l'habitude de vivre", dit le
général de Gaulle, fit adopter le projet du Maréchal Niel. La triomphante
armée, si vaillante contre les rezzous et si courageuse contre les moustiques,
ne sera pas modifiée ! A ses côtés, serait constituée une Garde Nationale
mobile, qui, en cas de nécessité, serait versée dans les troupes actives !
Tout fut méticuleusement organisé pour que
cette garde mobile n' existât que sur les registres, ne soit pas opérationnelle
et qu'ainsi, aucun des anciens privilèges de la vieille hierarchie ne soit
écorné.De toutes façons, l'Etat-major assurait que
nous étions les plus forts ; des troupes mieux aguerries, plus de canons, plus
de fusils et surtout plus de médailles sur les poitrines des chefs.
L'impératrice Eugénie, du fait de la faiblesse physique de Napoléon,
n'entendait que ces propos rassurants.Une petite victoire militaire consoliderait
l'empire et permettrait le sacre du prince encore âgé de quatorze ans ! En
outre, Eugénie, l'espagnole, pense qu' en attaquant la première , la prétention
des Hohenzollern-Sigmaringen au trône
d'Espagne serait étouffée dans l'oeuf. Elle veut la guerre. Napoléon hésite et
laisse E. Ollivier lancer la déclaration aussitôt après la réception de la dépêche d'Ems.
La bêtise redevenait maîtresse du monde.
La Prusse agressée n'attendait que l'ordre de
marche, étant déjà prête depuis longtemps. L'été soixante dix, commença par la
défaite de Sedan et l'empereur fut fait prisonnier. Aussitôt, Paris bascula
dans une révolte de délire comme celle de mai 1968 nous en a rappelé
l'existence. La commune cumulait des ressentiments ambigus, un soulèvement
d'abeilles ouvrières et une manifestation d'hostilité contre l'armée et le
pouvoir. L'impératrice ayant emprunté, pour fuir, la calèche qui est toujours
visible au musée franco-américain de Blérancourt, la France n'était plus
représentée que par des parlementaires, souvent mal élus, et l'armée.Une connivence complice naquit de la
complexité de la situation. La république de Thiers et de Gambetta avait contre
elle, Paris, tous les travailleurs de France, l'Europe et une seule planche de
salut la présence de généraux opportunistes mais incompétents aux choses de la
guerre moderne. Pour légitimer son abus de pouvoir, la III ème République prit le parti d'aduler
des soldats incapables. Toute la conscience civique du pays sera bâtie sur ce
mensonge qui, aujourd'hui encore, pavane à chaque coin de rue.Alors que Paris a faim, que l'armée allemande
est à Laon depuis le 9 septembre, Gambetta va trouver le soutien de l'armée qui
osera soutenir qu'elle n'a pas encore capitulé. Elle est repliée très à
l'intérieur et quasiment exsangue, et nos généraux continueront à tenir le
langage de l'autosatisfaction et de la compétence. La faute revient au gouvernement précédent, à
Ollivier, à Eugénie, à Cousin Montauban mais pas à nous, nos médailles
attestent de notre vaillance !
Nos positions sont des positions de repli,
l'assaut est encore possible, il faut plus d'hommes, c'est tout. Le
gouvernement, trop fragile pour oser critiquer les incapables, leur accordera
des promotions et la guerre continuera encore quatre mois, entretenant
l'illusion et alourdissant la note. Dès qu'il est parlé de somme et de facture,
le Vermandois n'est jamais bien loin.L'armée du Nord, sous le commandement de
Faidherbe, fut appelée à la rescousse et s'empressa de ramasser dans la
population de Saint-Quentin, tout ce qui pouvait tenir gachette, mais laissa le
gros des troupes hors de la ville "ouverte", c'est-à-dire hors du
champ de bataille. On coupa les ponts sur la Somme et les vigies
surveillèrent vers l'est. Dès le 7
octobre, les colonnes allemandes passaient Ribemont et étaient à portée de tirs
du faubourg d'Isle. Le lendemain, l'Allemand pénètre dans le faubourg et est
accueilli par une vive fusillade. Il se replie. Le 9 octobre, le préfet adressa
la proclamation suivante:
" La date du 8 octobre 1870 prendra
place dans l'histoire de la cité, à côté de la glorieuse défense de 1557. La
France, si douloureusement éprouvée, verra que les défenseurs de Saint-Quentin, ville ouverte, n'ont pas dégénéré.
"
Dégénéré, toi-même, auraient dû crier nos
ancêtres !...
Le 21, les Prussiens sommèrent la ville de
reddition. La ville paya et repaya mais resta ouverte, c'est-à-dire sans
pénétration de l'armée ennemie. Elle
repaya encore, puis les Saxons rentrèrent dans la ville le 25 décembre avec
2500 hommes.
A Péronne, la résistance armée tiendra
vaillamment jusqu'au 10 janvier malgré un bombardement qui dura 52 heures.
Gambetta supplia de marquer au moins un but même si la défaite était déjà
consommée. L'armée de Faidherbe fut gentiment invitée à
intervenir et, venant de Péronne, reprit la ville que l'ennemi après de
multiples pillages avait abandonnée momentanément pour chercher du bois de chauffage, sans doute.
C'était le 18 janvier 1871 et le fond de
l'air était carrément glacé.
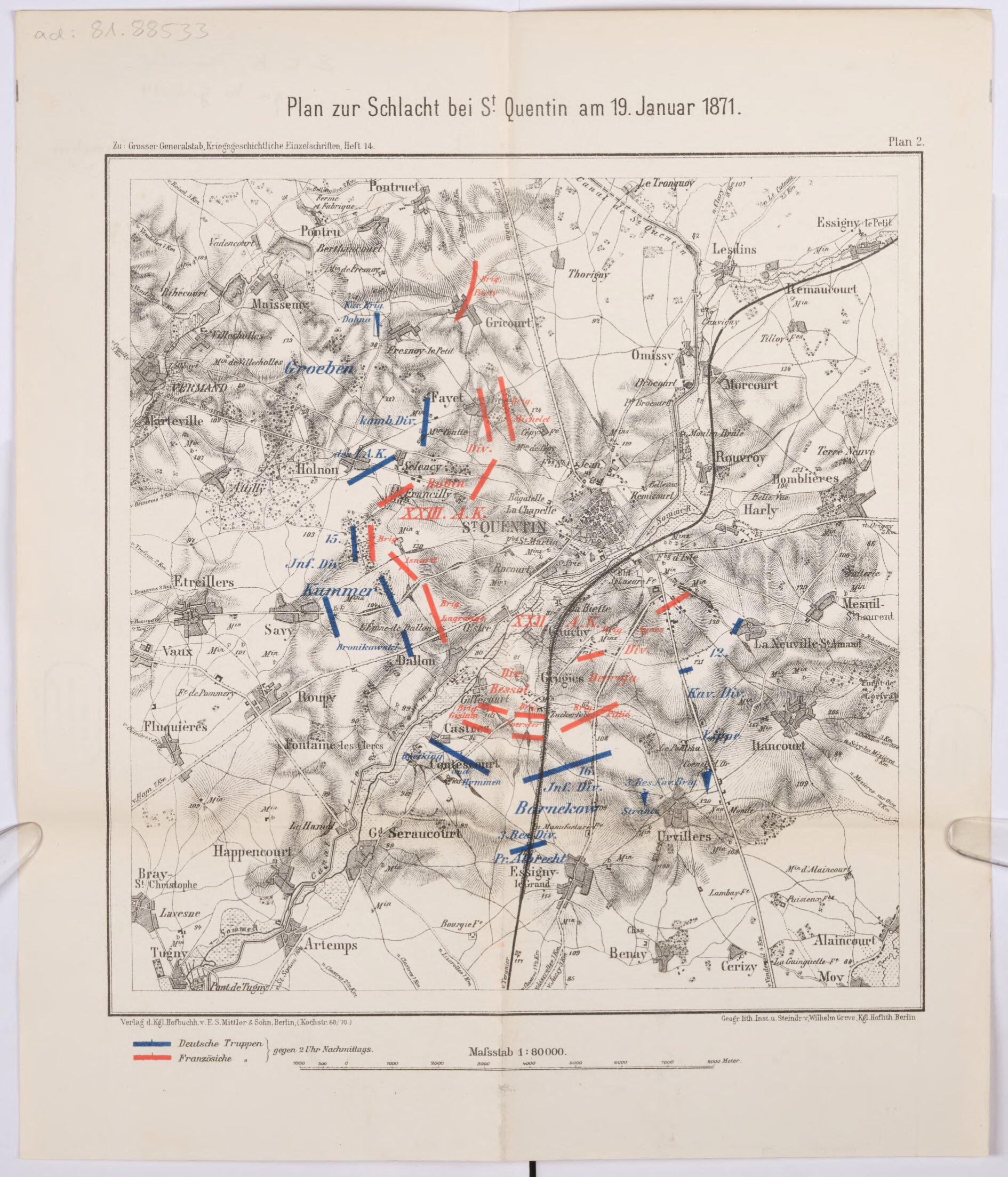


Sans illusion, il déclara au conseil
municipal qu'il livrerait bataille, puisque Gambetta le voulait, mais qu'il
serait battu.....Tout son challenge serait de tenir un journée
entière. L'armée comprenait 25 à 30 000 hommes, avec
peu de cavalerie et peu de canons, répartis des deux côtés de la Somme et du0
canal. L'ennemi du nord arriva par le sud avec un dispositif contraire, de la
cavalerie commandée par le prince de
Hesse et trois divisions bien dotées en artillerie. Les batteries françaises et les fantassins
furent placés sur les hauteurs de Gauchy et fixèrent l'ennemi permettant un
débordement par le nord de la Ière brigade de la première division. L'armée
prussienne, barrée par cette ligne de
relief dut contourner jusqu'au nord de
Neuville Saint-Amand. L' élargissement du front obligea, en milieu de journée,
à resserrer le dispositif en revenant sur les hauteurs du faubourg d'Isle.
Reculer ne veut pas dire cesser de combattre. Une retraite bien faite alterne
deux pas en arrière et un pas en avant. Dans ce mouvement chaloupé, le
commandant Tramond s'illustra en reprenant un assaut intermédiaire à la
baïonnette. Sur les pentes de Gauchy, la pression commençait à devenir
intenable. Par six fois, les fantassins descendirent de leurs positions pour
pourfendre l'ennemi. Déjà le soir tombait et les vigies signalaient l'arrivée
d'importants renforts chez l'ennemi alors que rien ne s'ajoutait à la vaillance
de nos troupes. Faidherbe ordonna la retraite vers le Cateau d'un côté et de
Cambrai de l'autre. Les dernières fusillades partirent des barricades du
faubourg Saint-Martin, lardant l'obscurité de la nuit. La protection des
ténèbres facilita le repli des Français mais égara beaucoup de jeunes recrues,
peu familiarisées par le combat de nuit en atmosphère sibérienne. Le lendemain,
l'ennemi ramassa près de 4000 traînards français hébétés et compta près de 6000
morts et blessés dans ses rangs. Pour les Français, le bilan totalisa 2000
victimes, et les 4000 égarés. Comme ces derniers trouvèrent, dans les trois
jours suivant la bataille, la poudre
d'escampette, les comptables consacrèrent une très brillante victoire de la république.
Faidherbe écrira: "
Les Prussiens ont
trouvé dans de jeunes soldats, des gardes nationaux, des adversaires capables
de les vaincre. Qu'ils ramassent nos traînards, qu'ils s'en vantent dans leurs
bulletins, peu importe, ces fameux preneurs de canons n'ont point touché à une
batterie. Honneur donc à vous tous !...."
Le compliment valait pour les soldats qui avaient combattu sur notre sol et un peu sur le plan militaire.
Sur le plan de l honneur Faidherbe faisait les soldes .
Saint Quentin fut à nouveau sous administration
étrangère pendant un an, soit jusqu'en octobre 1871.
Le traîté de Versailles signé le 21/1/ 1871,
soit deux jours après la belle réaction de l'armée du Nord, accrut encore les
clauses humiliantes infligées à la nation. Un pays, qui ne sait pas arrêter à
temps un conflit perdu, s'expose à des agios de retards usuraires. Tel fut le
cas. La France accepta des clauses honteuses: la perte de l'Alsace-Lorraine,
cinq milliards de francs d'indemnités, le désarmement de son armée.
Laissons le Général de Gaulle dresser le
bilan de ce conflit.
"
Dans cette guerre sans consolations,
nous ne manquâmes, ni d'hommes puisqu'on en leva 1 900 000 contre 1 300 000
Allemands, ni d'armes, car le total des fusils distribués à nos troupes
dépassait celui des Dreyse, et nous fîmes tirer 3000 canons de campagne, alors
que l'adversaire n'en eut jamais plus de 2 000, ni de courage, dont les preuves
multiples attestaient le trésor intact de nos vertus militaires. Nous ne fîmes
même pas d'économies de sacrifices : si l'ennemi eut 165 000 hommes tués et
blessés, nous en perdîmes 280 000. Et pour combien faut-il compter les pertes
de territoire, d'argent, de prestige, que coûta la défaite ? L'idéologie,
l'insouciance, portaient leurs fruits amers et sanglants."
Ce constat amer, le général de Gaulle en
connaissait le prix véritable. Sa défiance pour la troisième République, les
notables, les partis, tout viendra de là. Et pourtant les sirènes du pacifisme et de
l'universalisme revinrent vite chanter, à l'oreille de nos concitoyens, leurs mortelles mélopées.

L'abbé Dehon. Matisse. La belle époque.
L'automobile. Des cloches pour tous
les clochers.
Le Kulturkampf.
Le chapitre de notre histoire intitulé
"la guerre de soixante dix " n'émerge, dans la plupart des manuels
d'histoire, pas plus qu'un épisode ordinaire dans une longue liste de conflits
incessants. Ces combats de type tribal ne secouaient-ils pas l'Europe depuis toujours ?:
Pourquoi
s'émouvoir, pourquoi chercher à comprendre ?
Tout le débit fut porté sur le dos des
absents..La nation française ne fut nullement invitée
à une autocritique. Un manichéisme primaire s'installa, affirmant que tous les
torts étaient du même côté, rien n'était donc à améliorer !.
En consacrant l'échec, la politique de notre
pays va ouvrir une brèche à un autre désastre. Le Général de Gaulle tira, à sa façon, la
"leçon" de la situation :
" Grandir sa force à la mesure de ses
desseins, ne pas attendre du hasard, ni des formules, ce qu'on néglige de
préparer, proportionner l'enjeu et les moyens :l'action des peuples, comme celle des
individus, est soumise à ces froides règles. Inexorablement, elles ne se
laissent fléchir ni par les plus belles causes, ni par les principes les plus
généreux. Mais pourquoi faut-il qu'on ne les voie bien
qu'à travers les larmes des vaincus ?"
Le général mit cette pensée au propre après
la première guerre mondiale. Bien qu' inspirée par le désastre de 70, elle est
prémonitoire de tous les conflits mais, rédigée trop tard, elle n'infléchira
nullement la marche inexorable du destin. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, 14-18 sera la prolongation des batailles de Sedan et de Saint Quentin
et le conflit le plus meurtrier de l'histoire ; un abîme de douleurs pour notre région ! Il faudra beaucoup de
larmes pour panser les plaies dues à l'imprévision de nos politiques. L'histoire de la période de 1870 à 1914
semble se réduire à quelques '"affaires" : l'affaire Dreyfus,
l'anticléricalisme, les emprunts russes !
Ne pas attendre du hasard, ni des formules !
Et pourtant, avec la nouvelle République, la démagogie se mit à gouverner la France. En 1902, le parti coalisé
entre radicaux et socialistes obtiendra 200 000 voix de majorité, mais avec les
règles électorales , la représentation nationale sera de 350 sièges, d'un
côté, contre 238. Le mode de scrutin
trichait autant que les médias officiels mentaient sur le comportement des
généraux de 70. Au nom de la démocratie, l'extrêmisme occupera désormais le
coeur du système, l'uppercut deviendra le geste ordinaire de la vie politique,
le KO en devenant le triomphe. La croissance économique ainsi que la sécurité
de l'Etat et des citoyens, problèmes trop sérieux, seront délégués à des
fonctionnaires du tableau B. Toute la
politique se focalisera sur l'art de diviser pour multiplier les sièges et mettra sous le boisseau tous ceux qui
réfléchiront hors du cadre conventionnel du droite-gauche de la boxe française.
Saint-Quentin, vingt fois meurtrie, souffrira
aussi de cette division en son sein maternel. Nombreux adhèreront aux jeux des
partis alors que d'autres chercheront ailleurs. La veine apolitique menait, en ces temps
incertains, sans espoir d'amnistie et de sécurité, inéluctablement à la prison,
ou à l'entreprise ou à la mission, à moins que ce ne soit à l'art .Les deux premières catégories rassembleront
la multitude des sceptiques de la politique, tandis que le bagne connaîtra ses décennies de gloire et
que l'économie placera la France à la tête des nations. Les frères Pathé de
Compiègne aideront les frères Lumière à lancer le cinquième art. Toutes les
industries feront des progrès fulgurants à côté desquels les "Trente
Glorieuses" sont une potion amère.
Les années 1874 à 1914 afficheront des taux de croissance indiscutablement plus
probants pour la France que les trois décennies de 1945 à 1975. La troisième voie, juste avant l'art, jouxte
le domaine du paranormal. La mission religieuse reste avec l'amour le
dernier domaine de l'authentique. Le prix à payer est celui de sa vie ; aucune
récompense n'est promise ici-bas. Si l'abeille a le comportement de l'ouvrière,
le missionnaire est issu, dans le bestiaire humain, d'une génération spontanée;
aucun animal ne pratique cet art et personne, dans l'humanité, ne joue de rôle
plus utile ........ni plus contesté.
Notre région participa à ce mouvement comme
toutes les régions françaises, qui, le fait est trop occulté, fourniront la
moitié de l'effectif mondial des prêcheurs expatriés.
L'abbé Dehon, curé de notre région, après
avoir pris part à plusieurs mouvements qui prôneront l'engagement du religieux
dans la vie sociale, fondera la congrégation des prêtres du Sacré-Coeur de
Saint-Quentin. Elle comptait, en 1965, 3000 membres sur douze provinces. Elle a
eu l'immense grâce d'évangéliser le pays Bamileke au Cameroun. Ce pays, qui est
la Suisse de l'Afrique, est depuis une terre chrétienne, remarquable par sa
situation, par la richesse de son sol, l'intelligence de ses habitants et son
dynamisme. Les Français, qui ne sont là-bas que des visiteurs parmi d'autres,
reçoivent pourtant un accueil particulier, ineffable de gentillesse et de
fraternité.Sur la voie encore plus étroite de l'art pour
l'art, le Vermandois présentera quelques personnages non négligeables.
Henri Matisse sera de ceux-là. Jusqu'à 18
ans, il vivra à Bohain en Vermandois dans un entourage pragmatique, son père est commerçant, mais aimant les
belles choses. Ce n'était pas incompatible en cet âge d'or où la norme logeait
en haut de l'échelle et non à des
barreaux intermédiaires. Après le secondaire effectué au lycée de
Saint-Quentin, Matisse est orienté vers
une profession d'auxiliaire de justice. Par curiosité, il s'inscrivit également à l'école de dessin de Quentin la Tour.
Sa vie en fut bouleversée et l'histoire de la peinture
aussi. Il osera comme de la Tour aller plus loin dans le trait et la couleur.
En faisant scandale au salon de Paris en 1904, il atteindra la célébrité qu'il
attendait après 15 années de galère.Classé parmi les "fauvistes", c'est
un peintre original :
un peintre du bonheur ! Sa cote, forcément, n'atteindra pas les
sommets vertigineux de ses confrères torturés et désespérés. Qu'il nous suffise
de voir l'image du bonheur qui prit forme à la pointe du pinceau d'un
adolescent de chez nous, simplement doué pour voir ce qu' aucun appareil de
photo ne saisira jamais !
Au voisinage des religieux et des peintres,
mais demeurant à l'écart du tohu-bohu de la politique, gravitent d'autres
illuminés honorables.
Henri Martin est de ceux là. Sa notoriété
provient aujourd'hui de son Lycée à Saint-Quentin et de plusieurs boulevards
dans les grandes villes ; celui de Paris les surpassant tous en allure et en
valeur sur le carton du Monopoly. Peu nombreux savent qu'il fut historien et
natif du Vermandois. Il fut classé parmi les visionnaires et les rêveurs par
les docteurs des académies gauchisantes du vingtième siècle, parce qu'il osait
mettre à mal le dogme de "nos ancêtres les Gaulois" en le substituant
par un "
Notre père qui était celte " Son "Histoire de France" ne repose,
il est vrai, sur aucune dialectique historique et nulle part n'est évoquée la
lutte des classes. Notre concitoyen parle des buttes et des Celtes, ce qui
était déjà, en son temps, matière à scandale puisque tous les pontes de
l'Université ne parlaient que de Latins, de Grecs et de matérialisme
historique. Si, lecteur, ton courage t'a mené jusqu'à ces
lignes, l'oeuvre de Henri Martin te séduira totalement ; une commune vision du
monde réunit, à un siècle et demi de
distance, ceux qui aiment la terre autant que les hommes.
Un voisin prendra la suite de l'historien de
la France et s'intéressera à la Prusse.Quand, natif du Nouvion en Thiérache, et
écolier à Saint Quentin, la guerre de 7O est venue troubler votre conception
chauvine du monde, une analyse historique des relations entre les pays s'impose
!
Ernest Lavisse se penchera sur cette Prusse, mal connue. Pas plus qu'Henri
Martin, Ernest ne trouvera auditoire auprès de l'intelligentsia parisienne !. Paris, à l'origine de nos maux, pouvait-il
s'abaisser à reconnaître ses erreurs ? Cet ostracisme coûtera cher ! Un peu
d'attention et un brin de compréhension eussent retenu les tirs roulants des
machines de mort. La capitale, vivait, pour notre malheur, un
autre psychodrame. Lorsque la République aura été consacrée une et indivisible
avec une petite voix de majorité, les notables de la bourgeoisie, détenteurs
d'un rameau de législatif et d'un soupçon d'exécutif reprirent, pour leur
compte, de vieilles recettes de tous les monarques : mobiliser contre un ennemi clairement identifié les énergies en hommes
et chercher l'onction nécessaire aux chefs.
Plaque célébrant l'amitié Franco-Russe à Péronne
 L'ex-voto figure bien l'alliance de la Bourgeoisie avec la Monarchie et la coalition .
L'ex-voto figure bien l'alliance de la Bourgeoisie avec la Monarchie et la coalition .
En termes courants : le service national
obligatoire fut mis en place avec une dose réduite d'exemptés et la République
se dota d'une religion propre :
la laïcité. Préparer Dieu à intervenir dans la prochaine
guerre était une vieille astuce politique très rassurante et motivante.
Loin de ces rêveries politiciennes, la corne
de la fortune déversait ses bontés à profusion : les arts, les voies de la
transcendance, une "res publica " avec sa propre "
spes
publica", et tout un peuple conscient d'appartenir à la première nation du
monde, voire à la seconde, en tout cas
à la plus prospère. Dans de nombreux villages de la région, les
années 1910 furent des années de félicité à peine gênées par l'arrivée
pétaradante des premières automobiles. Comment remercier le ciel, alors que les mairies
auront déjà des écoles communales bicéphales : Entrée des Garçons, Entrée des
Filles, et que chaque village entretiendra une clique, pompeusement appelée
" harmonie municipale " ? .Nombreuses seront les fêtes qui, en ces
années, rassembleront les bambins des écoles , la clique et toute la population
pour accueillir de nouvelles cloches pour le clocher de l'église. Toute une symbolique se retrouvait autour de
ces massives pièces de bronze qui parlaient à tous sans distinction et
chantaient les heures de la vie quotidienne avec, à chaque fois, un clin d'oeil
à l'être suprême qui, grand horloger, domine la plaine et actionne les
aiguilles du temps qui passe.Il est vrai, que le spectacle des ateliers de
broderies, des tissages et l'animation des rues commerçantes donnaient de la
vibration au ventre.En été, il fallait sonner fort pour appeler
les bineurs de betteraves et les faucheurs disséminés à travers champs. En automne, les vapeurs de la sucrerie et les
brouillards donnaient aux tintements une importance particulière. C'était, en
quelque sorte, le phare du naufragé menacé de s'égarer.Les nombreuses cartes postales de cette
époque ont aujourd'hui acquis des valeurs inestimables tant à à cause de la
représentation des immeubles d'antan que par cette activité sereine qui animait nos rues si tristes aujourd'hui.
Parmi les fonctions multiples des cloches, le
tocsin n'avait pas été oublié. Pouvait-il l'être dans notre région d'abonnés
payants ?
Ce chant sinistre réveillera bientôt le
peuple de la région, naïvement persuadé de l'existence du bonheur perpétuel et
du droit à la paix permanente. A l'heure de l'angélus, avant que le tocsin ne sonne et que la
sirène ne hurle, les premiers aéroplanes, survolant le Vermandois, découvriront, avec stupéfaction, une région
transpercée de canaux, de voies de chemins de fer et de grossières routes. Les
bourgs tisseront un écheveau touffu abritant une population dont le nombre aura
été multiplié par près de sept en un siècle. Tous ceux, qui ont pu évoquer avec
leurs grands parents cette période de notre histoire, ont entendu
l'appréciation émue de " dure mais heureuse" qui résumera, en deux mots, la "
belle époque", pour les gens
du terroir.
Le qualificatif de dur ne conviendra pas à
l'époque suivante. On dira laconiquement "
pendant la guerre".
Selon un adage fameux, la guerre n'est que
la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens. Aussi convient-il de
s'interroger sur la finalité des diplomates dans un monde où l'apparition de
républiques avait supprimé le rôle d'origine de ces fonctionnaires, lesquels
n'étaient que des entremetteurs pour l'organisation de beaux mariages, joutes et fêtes !
La France assignera à ceux-ci une fonction de
vecteurs de la diffusion de la théologie républicaine :
Révolution, Egalité et
Laïcité.Les diplomates anglais ne se posèrent guère
de question, étant depuis longtemps les représentants de commerce d'un empire
marchand. Les Allemands, eux, édifièrent en doctrine les réflexions du maître à penser de la monarchie prussienne
: Bismarck, lequel voyait dans la dialectique française une agression
culturelle à laquelle il fallait riposter avec un armement plus lourd. Peu de
Français prêtèrent attention à ce mouvement dit du
Kulturkampf et ceux, qui en connurent l'existence, le traitèrent avec dérision.
A la révolution, s'opposait la tradition, à
la fraternité populaire le sentiment d'harmonie, à la liberté débridée le
respect de l'entreprise, ainsi l'impérialisme des idées dites nouvelles buta
sur les murailles toutes spirituelles d'une culture xénophobe.
Ce qualificatif
choque énormément dans le langage convenu d'aujourd'hui mais il s'agissait bien de la défense de sa propre culture et
de rien que cela ! Pour les agents français, c'était la mission universelle de
la République, pour nos voisins c'était une infiltration perverse et dangereuse
qu'il fallait combattre comme telle. Les pays qui osaient, à l'instar de la
France, prétendre à une supériorité cuturelle ou intellectuelle devaient être
mis au ban ! : la papauté osait faire la morale à tous, de quel droit ? les
Polonais étaient fiers de leur langue incompréhensible ! Les Anglais n'avaient
aucun don musical !Pour compléter le tableau et asservir les
consciences, l'histoire sera également réécrite : les Francs deviendront de
race germanique et Charlemagne natif d'Aix la Chapelle. Très rares furent les observateurs qui
entrevirent ce que la manipulation des esprits pouvait engendrer : la
France s'affirmait mère des libertés
alors que l'Allemagne se proclamait fière de sa culture ; ça, un casus belli,
vous voulez rire !
Hélas, encore de nos jours, les professeurs
de philosophie oublient de rappeler à nos enfants que c'est bien, partout et
toujours,la bêtise qui tue !.
